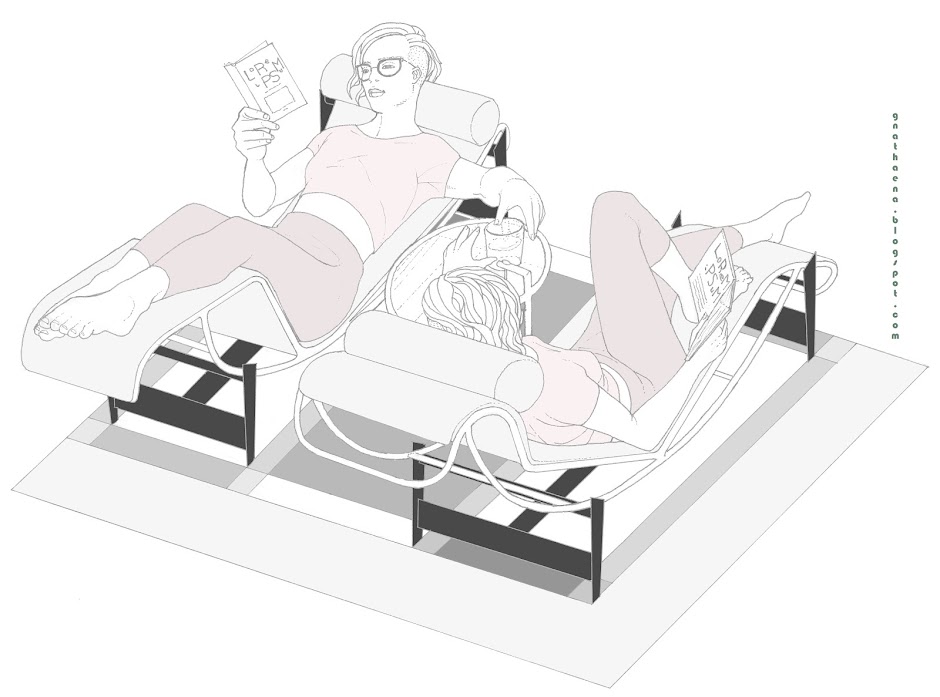|
|
Illustration
: Cesare Maccari, Cicéron dénonce Catilina, XIXe siècle
|
La
première Catilinaire n'est pas d'un accès facile, du fait de
l'ancrage du texte dans la réalité historique des institutions
romaines.
Le
contexte du discours de Cicéron est celui de la dernière
séance du Sénat en présence de Catilina, pendant laquelle
Cicéron invective ce dernier et après laquelle Catilina quittera
Rome. Cicéron met tout en œuvre dans l'écriture de son discours
(qui, rappelons-le, a été entreprise après la mort de Catilina),
pour faire de cette séance son acte politique majeur. Il se
met notamment en scène lui-même (les Catilinaires
transcrivent ses principales allocutions relatives à cette affaire
d'État) comme un homme à la hauteur de sa fonction de consul de la
République romaine, et comme un consul capable de faire de
l'exercice de sa fonction un exemple à suivre pour les consuls
futurs, pour ceux qui seront amenés à exceller non pas dans les
affaires militaires aux confins de l'empire, mais dans les affaires
civiles, tout aussi périlleuses.
Ces
deux motifs (l'aptitude de Cicéron à remplir sa fonction de consul
et le caractère innovant de son interprétation de cette fonction
dans un contexte de guerre civile imminente) sont largement
entremêlés dans la première Catilinaire, et cela sans
aucune confusion : chacun des deux motifs obéit à ses propres
registres discursifs et c'est leur alternance qui conduit le discours
de son commencement à sa fin.
➤
Le
consul comme juge arbitre suprême
Le
premier motif est à apprécier à la lumière de l'analyse de
Benveniste du terme latin « arbiter » (chapitre 3 du livre 5 du
Vocabulaire des institutions indo-européennes), qui désigne
l'un des aspects de droit
de la fonction de consul, celui par lequel
L'arbiter
décide non d'après des formules et des lois, mais par sentiment
propre et au nom de l'équité : l'arbiter est
un iudex qui agit en tant qu'arbiter, il juge en survenant entre les
parties, en venant du dehors comme quelqu'un qui a assisté à
l'affaire sans être vu, qui peut donc juger librement et
souverainement du fait, hors de tout précédent et en fonction des
circonstances.
Le
statut de consul confère à celui qui s'en trouve investi ce pouvoir
magique et divin d'avoir été là au moment et au lieu de
la naissance d'un projet criminel qui dépasse les bornes du droit
coutumier.
Certes
l'investiture au consulat prend la forme d'un rituel, par lequel le
nouveau consul est amené à adopter l'attitude souveraine de
quelqu'un qui a changé de nature, qui, de simple citoyen, est devenu
le premier magistrat de la République, dépositaire d'un pouvoir
divin.
Pour
autant, dans les faits, l'omniscience à laquelle il est censé
accéder, c'est au consul de se la construire, en s'entourant d'un
réseau de personnes privées, comparable aux Renseignements généraux
français, qu'il lui revient d'organiser, ce qu'il ne peut envisager
de faire qu'à partir de sa clientèle personnelle. C'est la qualité
de celle-ci, et la compétence de ses membres, qui sont la mesure de
fait du pouvoir omniscient de droit du consul.
Il
s'avère que sur ce point Cicéron était suffisamment bien entouré
pour qu'il puisse non seulement prouver sa valeur en déjouant une
conspiration, mais encore en savoir suffisamment sur elle pour jouer
avec le chef des conspirateurs et l'acculer à un silence coupable.
Une bonne partie de la première Catilinaire
peut être lue sous cet angle : à la fois comme une démonstration
de la qualité du réseau d'espionnage
de Cicéron et comme la mise en œuvre d'une stratégie visant à
fermer toute porte de sortie à Catilina
(autre que celle que Cicéron lui proposera).
Le
consul n'est pas seulement arbiter,
il est aussi iudex. Comme le rappelle Benveniste, le droit pénal
romain est un droit régi par la proportion. Le juge qui détermine
la faute, détermine aussi le montant de la réparation du préjudice.
Ces deux moments n'en font qu'un dans le droit romain, qui exprime,
dans ses formules toutes faites, la jurisprudence coutumière de la
proportion de la peine à la faute. Dans les cas où il ne s'agit
plus de juger selon le droit coutumier, où il s'agit d'une affaire
que la coutume n'a pas prévue, le iudex arbiter qui est sollicité
est appelé à innover en matière pénale.
De
là, arbitrari étend son
emploi et prend le sens d'aestimare, fixer souverainement le prix de
quelque chose : en effet, le juge arbitre était amené à apprécier
le prix d'un objet en litige, de fixer une peine, un dommage, une
amende.
Quand
le iudex arbiter est un consul, c'est que l'affaire est une affaire
d'Etat, donc une affaire suffisamment grave pour que la peine la plus
dure puisse être envisagée (à savoir, chez les Romains, la
réduction au statut de sacer, « sacré », qui correspond à la
perte non seulement de tous ses droits, mais de son humanité et de
toute valeur, même marchande : le sacer est assimilé à une bête
sauvage que tout un chacun a le devoir d'éliminer s'il le croise).
Or
les Romains, passionnés de proportion et d'équité, sont beaucoup
plus méfiants envers l'usage qu'un consul peut faire de son pouvoir
de définir souverainement une peine, qu'envers son omniscience, dont
l'utilité n'a jamais, quant à elle, été remise en cause. De là
les limites institutionnelles mises à l'exercice par le consul de sa
fonction complète de iudex
arbiter, conditionné par un acte particulier du Sénat : le senatus
consultum ultimum.
Par cet acte, le consul dispose effectivement de tous les moyens (et
de toutes les peines) qu'il estime nécessaire pour résoudre de bout
en bout une affaire que le Sénat a de son côté estimé être une
affaire d'État, mais dont il ne détient précisément ni les
tenants ni les aboutissants. Sans le senatus consultum ultimum, le
consul est omniscient sans être omnipotent ; dès qu'il l'obtient,
son pouvoir est à peu près sans limite. Les Romains n'ont jamais
accepté le senatus consultum ultimum qu'à la condition
supplémentaire que le consul rende des comptes et montre qu'à tout
moment de l'affaire, il a su proportionner les mesures prises
(policières et pénales) aux risques encourus.
Il
me faut sur ce dernier point ouvrir une parenthèse. On ne juge pas
seulement à Rome des crimes qui ont eu lieu, mais aussi des
intentions criminelles qui passeraient aux actes, si des mesures
n'étaient pas prises pour l'empêcher. Une conspiration entre
évidemment dans ce second cas de figure. Les Romains n'avaient pas
la même réticence que nous à juger des individus pour des crimes
qu'ils n'avaient pas commis, mais qu'ils avaient l'intention et les
moyens de commettre.
Une
énorme partie de leur liturgie consistait à consulter les oracles
et à agir en conséquence : faire bon accueil aux biens mais
détourner les maux qu'ils annoncent (par des mesures prophylactiques
ou au contraire apotropaïques). Le consul disposait de la
prérogative de consulter les oracles regardant l'avenir de la
République et de proposer au Sénat des mesures destinées à
accueillir les biens et à détourner les maux politiques à venir.
Pour un Romain, l'oracle annonce l'avenir souhaité à un instant t
par les dieux ; il s'agit alors de les influencer pour qu'ils
modifient leur décret s'il conduit à des maux, ou de leur rendre
grâce pour qu'au contraire ils le maintiennent s'il conduit à des
biens. Lorsque Cicéron accuse Catilina d'avoir eu l'intention et les
moyens d'assassiner la moitié du Sénat, cela revient à l'accuser
de l'avoir fait dans un monde où Cicéron n'aurait pas pris les
mesures apotropaïques qui s'imposaient. Voilà pourquoi les Romains
exigent de Cicéron qu'il montre avoir proportionné les mesures aux
risques et non pas seulement aux crimes éventuellement déjà
commis. La première Catilinaire est à lire
sous cet angle comme une longue justification des mesures prises ou à
prendre ou qui devraient être prises par le consul Cicéron face aux
risques croissants que représentent les agissements de Catilina,
mesures apotropaïques qui sont simultanément des peines calculées
au prorata du crime qui aurait lieu en leur absence. En cela
Cicéron s'attache à prévenir les critiques sur son honnêteté, et
sur l'impartialité que réclame la détention du senatus consultum
ultimum.
Quand
Cicéron se met en scène selon ce premier aspect de la fonction de
consul, la salle où se réunit le Sénat se transforme en tribunal,
le tribunal du iudex arbiter dont l'équivalent français actuel est
la séance d'interrogatoire du juge d'instruction. Plutôt que d'un
interrogatoire, il s'agit dans la première Catilinaire
d'une longue accusation qui a pour but premier de réduire Catilina
au silence, de lui ôter toute possibilité d'argumenter contre les
faits, pour but second de prouver que Cicéron dispose effectivement
du pouvoir d'omniscience que sa fonction de consul lui assure
magiquement pour autant qu'il s'en montre digne (par la qualité et
la compétence de sa clientèle), pour but troisième de montrer que
Cicéron est sensible à l'exigence de modération que recèle
l'usage du senatus consultum ultimum.
➤
Le
consul comme médecin politique
Le
texte de la première Catilinaire serait déjà très dense
s'il s'en tenait à cette ligne au fond très traditionnelle de la
fonction consulaire. Il s'avère que Cicéron complique les choses en
décidant d'innover face aux contraintes posées par l'usage du
senatus consultum ultimum. Et pour mieux mettre en avant son
innovation, par laquelle il entend être célébré par les
générations futures comme un exemple à suivre, Cicéron ménage un
certain suspense. Quelle sera la peine infligée à Catilina eu égard
à ses agissements ? C'est-à-dire : quelle sera la mesure prise pour
éviter que se réalise le projet de la conspiration que dirige
Catilina ?
En
prenant pour fil directeur ce thème, Cicéron modifie
progressivement l'angle d'attaque de son discours. Car il vise à
changer de scène, de façon à ne plus avoir à accuser et à punir.
Prenant appui sur un autre aspect de la fonction de consul, Cicéron,
par le biais d'une figure de sens, se transforme de iudex arbiter en
médecin politique.
Pour
bien le comprendre, il faut encore lire Benveniste (chapitre 4 du
livre 5 du Vocabulaire des institutions indo-européennes) :
*med-
c'est approximativement « prendre avec autorité les mesures qui
sont appropriées à une difficulté actuelle, ramener à la norme –
par un moyen consacré – un trouble défini ».
Telle
est en l'occurrence la nature de l'exigence liée à l'usage du
senatus consultum ultimum : l'exigence de mesure, de modération, à
l'égard de l'affaire dont le consul a dénoué les fils. Or la
mesure est la prérogative du médecin, au sens où guérir c'est
«
traiter selon les règles une maladie, soumettre un organisme troublé
à des règles prévues, ramener de l'ordre dans une perturbation ».
Lorsque
Cicéron passe de la posture de juge arbitre à celle de médecin, la
scène se transforme. En tant que juge arbitre, il identifie la
partie lésée de l'affaire qu'il instruit à la République
elle-même : il confirme ainsi qu'il s'agit d'une affaire d'État qui
justifie le senatus consultum ultimum. Mais en tant que médecin, il
identifie la République à une personne malade. Dans le même
mouvement, Catilina accusé par le juge arbitre d'être le chef d'une
conspiration, devient le vecteur premier d'une maladie dont souffre
la République et que le médecin doit traiter par des mesures
appropriées. Catilina se trouve en quelque sorte déchu de son
humanité, traité de sacer par Cicéron, mais non pas selon la
procédure normale pour rendre quelqu'un sacer. Catilina est sacer
parce qu'il est réduit au statut de suppôt humain, et même
authentiquement romain, d'un mal qui agite Rome et qui touche de
nombreuses autres personnes que Catilina, mais pas au point où
Catilina est atteint, car il n'est plus lui-même que le mal romain
incarné. Comme c'est un médecin et non pas un juge arbitre qui
déchoit Catilina, Cicéron ne peut être accusé de démesure en
prononçant le verdict le plus dur.
Mais
puisque c'est le médecin qui parle et non le juge arbitre, ce
verdict doit être entendu comme médical : en identifiant le vecteur
premier du mal romain, le médecin identifie du même coup la cause
du mal et les moyens de s'en défaire. Il ne s'agit donc plus de
Catilina lui-même, mais de tous les conspirateurs, et de tous ceux
qui, activement ou passivement, les ont soutenus, jusqu'au peuple
romain qui s'est laissé aveugler par le mal. Catilina n'apparaît
plus que comme le représentant du mal, celui sur qui l'action du
médecin peut soit conduire à une guérison totale de la République,
soit seulement à une guérison partielle.
C'est
en tant que médecin que Cicéron livre ses hésitations sur le sort
à donner à Catilina. C'est en médecin hippocratique qu'il prend le
temps de la méditation (autre dérivé de la racine indo-européenne
*med-) qui doit lui permettre de découvrir la voie la meilleure pour
guérir la République malade. Sur ce point Cicéron n'est pas un
médecin qui prescrit à son patient des remèdes éprouvés, il
prend le temps de travailler son ordonnance, comme le ferait un bon
politicien de nos jours, en jaugeant les pour et les contre. Mais
d'un autre côté, Cicéron emprunte la figure d'un médecin très
traditionnel, un médecin-magicien qui guérit son malade en
s'adressant à son mal.
La
première Catilinaire serait largement incompréhensible sans
cette référence à la médecine magique traditionnelle. On ne
comprendrait pas en particulier pourquoi Cicéron s'adresse à
Catilina pour lui exposer sa stratégie à son égard ! On a tendance
à voir les deux protagonistes comme deux joueurs d'échec qui
cherchent à se débarrasser l'un de l'autre dans une partie où ils
incarnent l'un et l'autre le roi blanc et le roi noir. Si c'était le
cas, Cicéron éviterait soigneusement de donner à Catilina le
moindre indice sur sa stratégie. Cette incongruité disparaît si
l'on se souvient des leçons de Lévi-Strauss sur l'exercice de la
médecine primitive.
La
médecine pré-hippocratique s'exerce sous la forme d'un rituel, lors
duquel le médecin engage un dialogue avec le mal, conçu comme un
être personnel doté d'une volonté malfaisante. Le dialogue a un
début et une fin : il s'agit pour la ou le médecin de localiser et
de nommer le démon malin puis de le pousser à sortir du corps qu'il
essaye de dominer par une série de formules dont l'efficacité est
croissante. À l'écoute de ce discours la ou le malade réagit et
finit par surmonter son mal par des mouvements plus ou moins
convulsifs qui scandent en quelque sorte le discours médical adressé
au mal. Au final, la ou le malade a guéri par la performance orale
de la ou du médecin.
C'est
à cette médecine que Cicéron se réfère, dans sa version
purgative : il s'agit en effet pour Cicéron de purger Rome de son
mal. Sa patiente est la République romaine, et s'il s'adresse en
effet par moment à elle, il concentre son discours sur Catilina qui,
en s'expulsant de lui-même, attirera à lui toute trace d'infection
des autres membres de la communauté. La première Catilinaire
est à lire sous cet angle comme un discours magico-médical adressé
par Cicéron à Catilina pour le faire sortir de Rome. Ce qui se
passera par la suite, Cicéron juge que cela ne posera jamais
problème : prenant la tête de l'armée qu'il a soulevée, Catilina
sera défait, avec tous ses complices, à la première escarmouche.
Cicéron médecin n'a qu'un but, que Catilina sorte de lui-même
du corps de la République, sous la pression de son discours scandé
par les sursauts républicains du peuple et du Sénat romains. La
première Catilinaire est ainsi centrée sur une longue
argumentation (13 paragraphes sur 33) visant à ne laisser comme
porte de sortie à Catilina que de choisir de partir de Rome.
En
centrant son discours sur son rôle médical, Cicéron entend mettre
en avant l'innovation qu'il introduit dans l'application mesurée du
senatus consultum ultimum. Il n'en fait pas une panacée, il la
cantonne à la résolution des problèmes intérieurs. Rome possédait
en l'occurrence deux consuls, l'un étant normalement basé à Rome,
et l'autre parcourant les franges de ce qui était déjà un empire.
À l'époque des faits, c'est Pompée qui exerçait la fonction
militaire du consulat. Cicéron quant à lui en exerçait la fonction
civile. C'est en tant que consul civil romain que Cicéron entend
innover et devenir exemplaire, car l'histoire de la République a
déjà livré ses héros militaires consulaires, dont Pompée est
d'ailleurs le digne avatar.