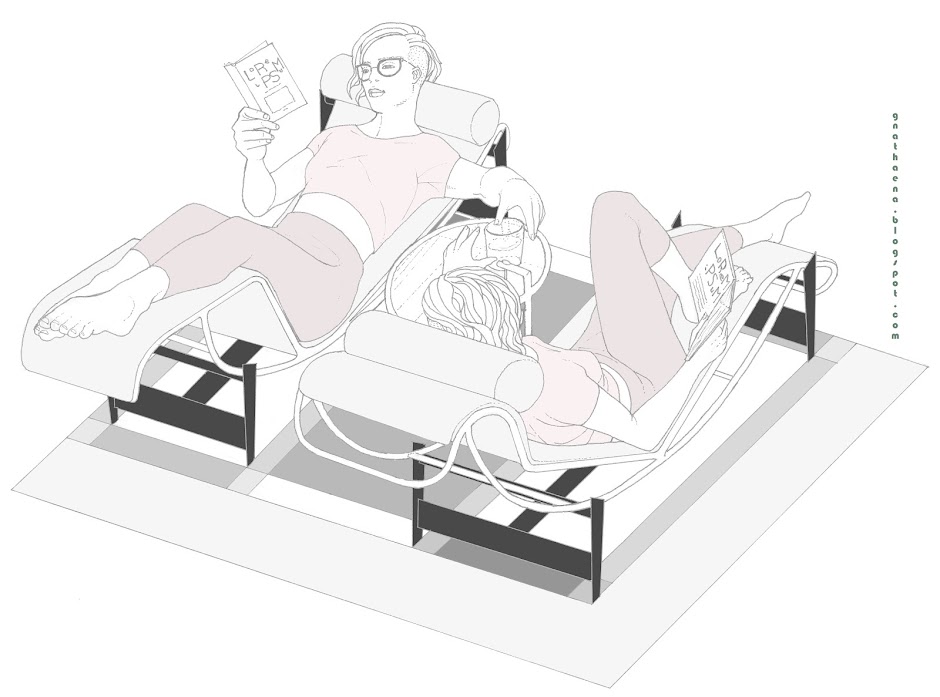|
| Le cercle magique de John William Waterhouse, 1886 |
Dans
l'un de mes articles consacrés à la culture masculine chez les
Indo-européens (ici),
je vous parlais de la notion de créance. Voilà ce que
j'en disais :
«
La notion de créance, économique à l'époque moderne, sociale dans
l'Antiquité et magique chez les Indo-européens de l'époque
pré-historique, dérive de celle de fidélité. À l'origine, elle
est donc liée à un échange en deux temps entre un homme et un
dieu. Le premier temps est celui du placement du *kred-, unité
individuelle de force que fournit un homme à un dieu de façon à
augmenter ses chances de vaincre dans ses combats célestes. Le
second temps est celui de l'assistance du dieu à l'homme qui a placé
en lui son *kred-, tout comme dans la fidélité est attendue du chef
un retour. Le créancier apparaît ainsi à l'origine comme le fidèle
d'un dieu. Mais lorsque le champ économique s'empare de la notion de
créance, l'accent est mis sur la dette qu'elle implique, sur
l'obligation qui résulte du crédit, obligation juridique placée
dans l'ombre du châtiment. L'économie marque en cela sa différence
avec la religion, puisqu'il est inconcevable qu'un dieu soit l'obligé
d'un homme. »
(...)
il est inconcevable qu'un dieu soit l'obligé d'un homme : et
pourtant ! Il me vient à l'esprit plusieurs exemples de dieux «
obligés », forcés à l'obéissance, certes pas à cause d'une
créance qu'ils auraient contractée envers un mortel et
qu'ils seraient tenus d'honorer, mais par quelque obscure contrainte.
Et comme ce type de rapport est inimaginable dans le cadre de la
religion officielle indo-européenne, il s'établit forcément à sa
marge, régie par des femmes et des hommes exclu.e.s de la culture
dominante du monde gréco-romain : sorcières et sorciers, mages et
magiciennes, enchanteresses et enchanteurs, nécromanciennes et
nécromanciens.
La
réalité sociale et historique de ces marges n'est plus guère
perceptible aujourd'hui qu'à travers ce qu'en ont retenu quelques
écrits philosophiques et poétiques de l'époque, bien évidemment
partiaux, qui lui ont surimposé une image dépréciée, le plus
souvent strictement féminine, construite sur les bases de la
théologie officielle de l'époque. Son caractère contradictoire est relevé, soit pour en dénoncer le
charlatanisme, soit pour pimenter un récit.
C'est
ainsi qu'au travers de trois célèbres figures de sorcières nées
sous le calame d'auteurs romains non moins célèbres, je vais...
- m'attacher à illustrer l'immense étendue des pouvoirs communément attribués aux sorcières et sorciers dans l'Antiquité,
- montrer comment la nature de ce pouvoir les met à l'écart du champ de la religion civile et de la Cité, ce qui, dans une société où tout est religieux, aboutit à les rejeter à ses marges et à leur faire endosser le rôle anti-social et abhorré de l'impi.e,
- questionner la source de leur pouvoir,
- et étudier parallèlement la figure littéraire de la sorcière, dont l'importance dans l'imaginaire européen, de l'Antiquité à la Renaissance, a contribué à rejeter sur les femmes la faute religieuse que constitue la pratique de la sorcellerie dans le monde chrétien.
➤
Érichto
l'Hémonide dans le livre VI de La
guerre civile ou La
Pharsale de Lucain (Ier siècle)
La
Pharsale est une épopée retraçant la guerre civile qui oppose
le parti du Sénat (ou de Pompée) à celui de César (– 49 à –
45). Au livre VI, la scène du conflit se déplace d'Italie en Grèce,
plus précisément en Thessalie, terre des enchantements et de la
sorcellerie, dont Mme de Créquy, dans ses Mémoires, disait
plaisamment que c'était un pays « dont la moitié de la population
se croyait sorcière, et dont l'autre moitié se croyait ensorcelée
». L'un des fils de Pompée, désireux de connaître l'avenir qui
lui est réservé, va consulter l'effrayante Érichto, consultation
qui va permettre à Lucain de déployer tout son talent d'écrivain
dans la création d'un personnage parmi les plus mémorables de la
littérature antique. Dans l'univers très viril de La Pharsale,
Érichto est également, à côté de Cléopâtre et de Cornélia,
l'épouse de Pompée, l'une des rares figures féminines
individualisées, caractérisées et tenant le premier rôle.
L'épisode où elle apparaît est certes mineur dans l'économie
générale de l'œuvre, mais il est essentiel d'un point de vue
littéraire, puisqu'il s'agit ici pour Lucain de tenter d'égaler
l'épisode de nécromancie de l'Odyssée, où Ulysse
interroge, grâce aux formules magiques apprises de Circé, l'ombre
du devin Tirésias.
Parmi
tous les personnages de sorcières qui hantent la littérature
gréco-romaine, on peut distinguer la princesse magicienne, jeune et
séduisante, telle Médée ou Circé, et la vieille sorcière
repoussante, risible et marginale. D'emblée l'Hémonide affirme sa
différence, puisqu'elle n'appartient ni à l'une ni à l'autre de
ces catégories. Si la question qui se pose à propos de la princesse
magicienne ou de la vieille sorcière est celle de leur humanité
(sont-elles humaines ou plus qu'humaines ?), Érichto ferait plutôt
se demander si elle est vivante ou morte.
- Son apparence est celle du cadavre : « Sur le visage de cette femme impie, qu'un jour serein n'éclaira jamais, une maigreur hideuse se joint à la pâleur de la mort. »
- Elle demeure dans un cimetière : « Elle s'était interdit la demeure des vivants, et pour être plus chère aux dieux des morts, elle habitait parmi des tombeaux dans l'asile même des ombres chassées de leurs couches. »
- Elle ne vit que de morts, qu'elle dépèce comme un charognard : « Mais a-t-on conservé dans la pierre ces corps dont le principe humide est tari, et dont la substance est durcie et desséchée, elle exerce sa fureur sur eux, plonge ses mains dans leurs yeux, arrache leurs prunelles glacées, ronge la pâle dépouille de leurs mains décharnées ; elle rompt avec ses dents le nœud fatal et le lacet des pendus ; dévore les cadavres, ronge la croix, déchire les chairs battues par l'orage ou brûlées par les feux du soleil. Elle arrache les clous des mains des crucifiés, boit le sang corrompu qui dégoutte de leurs plaies, et si la chair résiste aux morsures, elle s'y suspend. Si on laisse étendu sur la terre un mort privé de sépulture, elle accourt avant les oiseaux, avant les bêtes féroces ; mais elle n'a garde d'employer ses mains ou le fer à déchirer sa proie ; elle attend que les loups la dévorent, et c'est de leur gosier avide qu'elle se plaît à l'arracher. »
Érichto
a cependant en commun avec les autres sorcières de la
littérature antique, sa toute-puissance, son pouvoir de « faire
violence aux dieux », d'obtenir ce qu'elle désire « en dépit
d'eux-mêmes » :
«
Ces dieux qui ne daignent pas écouter les vœux du reste des
mortels, obéissent aux enchantements de la Thessalienne
maudite. Ses accents magiques pénètrent seuls au fond des demeures
célestes. Les Immortels n'y peuvent résister... »
Tout
comme elles, elle s'attaque à l'ordre même de la nature, où elle
introduit le dérèglement
et le chaos. Ce faisant, elle montre un pouvoir supérieur à celui
des dieux, garants de cet ordre. L'extrait suivant, qui se rapporte
aux sorcières de Thessalie en général, énonce tous les lieux
communs, reposant sur des paradoxes ou des impossibilités, que l'on
trouve dans la plupart des évocations de la sorcellerie antique :
«
À la voix d'une Thessalienne, l'ordre des choses est renversé,
les lois de la nature sont interrompues ; le monde, emporté
par son cours rapide, reste tout à coup immobile, et le dieu qui
imprime le mouvement aux sphères est tout étonné de sentir que
leurs pôles sont arrêtés. Par ces mêmes enchantements, la terre
est inondée, le soleil obscurci ; le ciel tonne à l'insu de
Jupiter. L'Hémonide, en secouant ses cheveux, remplit l'air de
noires vapeurs et répand au loin les orages ; la mer s'irrite
quoique les vents se taisent ; les flots sont retenus dans un calme
profond, quoique les vents soient déchaînés ; les airs et les eaux
se combattent, les vaisseaux voguent contre les vents ; les torrents
qui tombent du haut des rochers demeurent suspendus au milieu de leur
chute ; les fleuves remontent vers leur source ; l'été ne soulève
plus le Nil ; le Méandre court droit vers son embouchure ; l'Arare
presse le Rhône paresseux ; le sommet des monts s'aplanit ; l'Olympe
s'abaisse au-dessous des nuages ; les neiges de Scythie fondent au
milieu de l'hiver sans que le soleil y darde ses rayons ; la mer
repoussée loin du rivage résiste au poids de l'astre qui la presse
; la terre est ébranlée sur son axe incliné, sa masse pesante est
poussée hors du centre de son repos et laisse à découvert le ciel
qui l'environne. »
Même
ce qu'il y a de plus irrémédiable, je veux parler de la mort, ne
constitue pas une limite à l'« art puissant » de notre
enchanteresse :
«
Si elle eût voulu relever à la fois toutes ces troupes égorgées
et les renvoyer aux combats, les lois de la mort auraient fléchi,
et par un prodige de son art puissant, un peuple rappelé des rivages
du Styx aurait reparu sous les armes. »
(L'image d'Érichto qui veut / pourrait lever une armée de morts,
revient à plusieurs reprises dans ce passage ; elle
évoque celle des gardiens des Enfers mésopotamiens, les Gallu, qui,
à la suite d'Ishtar, s'élancent hors des profondeurs de la terre à
la poursuite de Dumuzi ; la version qu'en donne Lucain, plus proche
de la horde sauvage des guerriers morts conduits par Odin et
dévastant tout sur son passage, me semble cependant nouvelle et
originale.)
Sa
façon de s'adresser aux divinités infernales délaisse la
supplication et la louange au profit de l'injure et de la menace.
Imaginez qu'elle appelle les Furies « chiennes d'enfer » et somme
Pluton de lui obéir sous peine de faire pénétrer la lumière du
jour dans les enfers !
Enfin
Érichto est jugée impie et sacrilège.
- Elle viole l'intégrité des cadavres, particulièrement sacrés et intouchables dans le monde gréco-romain (rappelons, par exemple, l'interdit de la dissection dans la médecine hippocratique, du fait même de cette sacralité du corps mort).
- Elle arrache les morts à leur dernier sommeil.
- Elle prononce ses prières et accomplit ses sacrifices aux dieux en étant souillée du sang de ses victimes (le meurtre fait de l'assassin un être impur, qui doit pratiquer divers actes de purification avant de pouvoir retrouver une vie normale, où la réalisation des devoirs religieux tient une place centrale).
➤ Méroé
la Thessalienne dans les Métamorphoses d'Apulée
(IIe siècle)
Les
Métamorphoses appartiennent au genre antique « milésien »,
qui rassemble des récits littéraires en prose, plaisants, légers
et volontiers amoraux. Dans cette œuvre, Apulée recherche avant
tout le plaisir et l'amusement de son public au moyen d'une grande
variété dans la narration et les registres littéraires utilisés.
Il multiplie, à l'intérieur de son récit-cadre, les digressions
narratives, qui relèvent de registres aussi divers que l'épouvante,
le conte merveilleux, le récit initiatique et mystique ou les
histoires criminelles.
Ce
qui va m'occuper ici est un récit fantastique, qui relate la
mésaventure du marchand Socrate, tombé sous la coupe d'une femme
qui le terrifie, et pour cause, car c'est une sorcière et, comme il
le dit lui-même, « [i]l y a quelque chose de plus qu'humain dans
cette femme ». Méroé, tel est son nom, est pour Apulée, comme
l'est Érichto pour Lucain, l'occasion d'illustrer son talent
d'écrivain, non plus dans le style noble et sérieux de l'épopée,
mais dans deux registres qu'il fait alterner avec brio : l'horreur et
le comique.
Tous
les clichés liés à la figure de la vieille sorcière sont
convoqués pour décrire Méroé : elle est vieille, elle a une
sexualité débridée qui la fait identifier à une prostituée, elle
est cupide et avare, elle est méchante et ridicule... Mais une
lecture plus fine montre que tous ces clichés sont ambivalents et
réversibles : elle est vieille, mais désirable, elle a une
sexualité libre et dominatrice, elle n'est pas cupide, mais gère
ses biens et ceux de son amant comme le ferait un homme, elle n'est
pas ridicule, mais ridiculise et humilie la gent masculine (il y a
une récurrence, dans cet épisode, du motif de la castration). De
plus, elle est certes extrêmement méchante, mais chacun de ses
actes de méchanceté (qui sont toujours de l'ordre de la vengeance,
soit contre un amant infidèle, soit contre une rivale en amour ou un
concurrent en affaires...) constitue une bonne plaisanterie, qui met
les lecteur.rice.s de son côté. La profession qu'elle exerce
(cabaretière) mérite que l'on s'y attarde :
- Il est rare pour une Grecque ou une Romaine d'avoir un métier (je ne dis pas de travailler) et de posséder son affaire : Méroé n'est donc pas assujettie aux mêmes conditions socio-économiques que celles de son sexe.
- Le cabaret, dans l'Antiquité gréco-romaine, est un lieu de danger et d'épreuve pour les citoyens qui le fréquentent, puisqu'ils y courent le risque, en cas de consommation d'alcool mal maîtrisée, de trahir les secrets de leurs affaires et de leur foyer à leurs compagnons de beuverie, susceptibles d'en tirer avantage sur un plan professionnel ; régir ce lieu de sociabilité masculine, où l'homme sort de son self-control habituel et remet en jeu son statut de dominant, c'est bien évidemment tenir une position de pouvoir.
Méroé
se démarque donc des autres femmes. Quoique, par bien des aspects,
son comportement et son mode de vie puissent être qualifiés de «
masculins », elle se distingue aussi des hommes, en ce qu'elle est
parfaitement seule. Dans une société composée comme un oignon, où
le citoyen grec ou romain appartient à une famille, qui appartient à
une tribu, qui appartient à une cité, elle semble ne faire partie
d'aucun cercle, pire : elle est l'ennemie de toutes et de tous (au
point que la ville où elle habite décide de la proscrire, dans
l'espoir d'en finir avec ses persécutions continuelles). On lui
découvre une sœur à mi-récit, Panthia, également sorcière, son
double en quelque sorte, qui ne diminue en rien sa singularité et
son isolement. Elle est par ailleurs dépourvue de tout état civil :
elle n'est ni mère, ni épouse, ni fille de citoyen, elle n'est ni
esclave, ni étrangère : elle ne possède aucun des statuts qui
définissent les individus de sexe féminin à l'intérieur de la
cité. Elle semble antérieure à la cité, antérieure à la
société, et faire partie d'un monde plus ancien.
Si
Méroé n'a pas grand-chose à voir avec Érichto, les mots qui vont
servir à décrire ses pouvoirs sont pourtant exactement les mêmes :
«
C'est une magicienne, dit-il ; elle sait tout : elle peut,
à son gré, abaisser les cieux, déplacer le globe de la terre,
pétrifier les fleuves, liquéfier les montagnes, évoquer les mânes
de bas en haut, les dieux de haut en bas, éteindre les astres,
illuminer le Tartare. »
➤ Pamphile
d'Hypata dans les Métamorphoses
d'Apulée (IIe siècle)
Pamphile
apparaît au livre II des Métamorphoses. Elle est l'hôtesse
du jeune Lucius, narrateur et personnage principal du roman. Elle
habite Hypata, capitale de la Thessalie. Voici son portrait :
«
Gardez-vous, mais gardez-vous sérieusement des fatales pratiques et
des détestables séductions de cette Pamphile, la femme de Milon,
que vous dites être votre hôte. C'est, dit-on, une sorcière du
premier ordre, experte au plus haut degré en fait d'évocations
sépulcrales. Elle peut, rien qu'en soufflant sur une pierre,
une baguette ou quelque autre objet aussi insignifiant, précipiter
les astres du haut de la voûte éthérée dans les profondeurs du
Tartare, et replonger la nature dans le vieux chaos. Elle ne
voit pas un jeune homme de bonne mine sans se passionner aussitôt.
Dès lors, ni ses yeux ni son cœur ne peuvent se détacher de lui.
Elle l'entoure d'amorces, s'empare de son esprit, l'enlace à jamais
dans les chaînes de son inexorable amour. À la moindre résistance,
elle s'indigne ; et les récalcitrants sont tantôt changés en
pierres ou en animaux, tantôt anéantis tout à fait. Ah ! Je
tremble pour votre sûreté. Gardez-vous de brûler pour elle ; ses
ardeurs sont inextinguibles, et votre âge et votre tournure ne vous
expose que trop à la conflagration. »
Plusieurs
points méritent d'être soulignés dans ce portrait, qui puise dans
les éternels lieux communs sur les sorcières :
- la toute-puissance de Pamphile (Elle peut, rien qu'en soufflant...) ;
- le lien entre cette toute-puissance et le chaos, qu'elle peut introduire à volonté dans l'ordre naturel et qui atteste l'étendue de ses pouvoirs (replonger la nature dans le vieux chaos) ;
- l'appétit sexuel, qui peut être, on l'a vu avec Méroé, un motif de moquerie, mais qui suscite ici bien plutôt l'effroi. Il y a, dans ce personnage de séductrice qui piège et enlace* à jamais dans les chaînes l'objet de son désir, un souvenir de la déesse suméro-akkadienne Inanna-Ishtar, déesse de l'amour (sexuel) et de la guerre, qui porte dans l'amour la force de destruction qu'elle apporte dans la guerre, et dans la guerre l'ardeur qu'elle porte dans l'amour. La langue anglaise possède un mot qui la qualifie parfaitement : maneater, la « mangeuse d'hommes ». Pour les nombreux beaux jeunes gens dont Inanna-Ishtar s'éprend successivement, la fin sera nécessairement tragique : son désir détruit ceux qui lui cèdent, sa vengeance frappe inexorablement ceux qui se refusent à elle (Gilgamesh n'y échappe qu'au prix du sacrifice – différé – de son cher Enkkidu). Pour établir ce rapport, qui surprendra peut-être, entre la plus grande déesse du Croissant fertile et une simple magicienne habitant une ville subalterne de l'Empire romain, entre deux figures que de nombreux siècles séparent, je m'autorise de l'analyse de Propp à propos de Baba Yaga (Morphologie du conte) : ce personnage, assimilé à tort à une sorcière, serait en fait la forme dégradée et syncrétique de plusieurs anciennes déesses (la mésopotamienne Ishtar, l'anatolienne Cybèle et Isis l'Égyptienne).* En relevant dans ce passage l'importance du champ lexical de la chasse (amorce, chaîne, enlacer...), il me vient une autre pensée que vous voudrez bien ne pas juger anachronique : je vois dans l'hôtesse de Lucius, dans la redoutable Pamphile, une sorte de Lovelace en stola, la version féminine du célèbre libertin mis en scène par l'anglais Richardson dans son roman épistolaire Clarisse Harlove, et dont le nom (le lac d'amour) annonce sa manière d'agir auprès des femmes qu'il veut conquérir : le piège et la ruse.
➤ Pistes
d'interprétation
Certes
Érichto, Méroé et Pamphile sont des personnages tout droit sortis
de l'imagination d'écrivains de langue latine, marqués par le genre
littéraire auquel ils appartiennent (l'« enflure » et
l'exagération inhérentes au style épique pour Érichto, le genre «
milésien » pour Pamphile et Méroé, qui aime à faire alterner et
même coexister le rire et l'effroi, et recherche avant tout à
faire effet sur son public), mais, loin de n'être qu'un moyen de
donner du piquant au récit, elles ne laissent pas de dire quelque
chose de la réalité sociale des sorcières et des sorciers.
Car
sorcières et sorciers ont, dans l'Antiquité, une existence
effective et se prévalent des pouvoirs et des tours de force dont
j'ai déjà parlé. J'en veux pour preuve La maladie sacrée
(chapitre I), où Hippocrate évoque la magie et celleux qui la
pratiquent :
«
En effet ils [celleux que
l'auteur appelle les mages, les expiateurs, les charlatans, les
imposteurs] prétendent savoir les moyens de faire
descendre la lune, d'éclipser le soleil, de provoquer l'orage et le
beau temps, la pluie et la sécheresse, de rendre la terre et la mer
infécondes, et tant d'autres merveilles. »
Cette
critique de la sorcellerie résonne à notre oreille de façon
familière. On y retrouve nombre de thèmes présents dans le
portrait de nos trois sorcières : la toute-puissance, l'inversion du
cours des choses et la destruction de l'ordre établi, et surtout
l'impiété de celleux qui prétendent pratiquer cet art :
«
Ils ne m'en paraissent pas moins être dans l'impiété et ne pas
croire qu'il y ait des dieux, ou, le croyant, penser que ces dieux
sont sans force et dans l'impuissance d'empêcher
aucune de ces merveilles suprêmes qu'ils promettent. Or, exécutant
de pareilles merveilles, comment ne seraient-ils pas redoutables
aux dieux mêmes ? Si un homme, par des arts magiques et des
sacrifices, fait descendre la lune, éclipse le soleil, provoque le
calme ou l'orage, je ne vois là rien qui soit divin ; bien au
contraire, tout est humain, car la puissance divine est surmontée
et asservie par l'intelligence d'un homme. »
Deux
choses sont constantes à propos des sorcières et des sorciers dans
l'Antiquité : leur supériorité sur les divinités olympiennes,
garantes de l'ordre, et leur relation au chaos en opposition avec
l'ordre. Pour rendre compte de ces constantes, il faut s'intéresser
à l'état et l'évolution de la pensée cosmographique antique.
Les
Grec.que.s (et les Indo-européen.ne.s en général) ont développé
et partagé une certaine conception du monde, où l'ordre l'a peu à
peu emporté sur le chaos, au fur et à mesure que les générations
de déesses et de dieux se succédaient, jusqu'au moment où, en
s'imposant définitivement, le panthéon jovien s'est débarrassé
des dernières traces de l'origine chaotique du cosmos. C'est sur
cette base que s'est construite la grande réforme culturelle du
monde gréco-romain, dont la philosophie, la médecine et les
sciences « naturelles » (géométrie, arithmétique, musique,
astronomie, logique, rhétorique, poétique, mécanique, zoologie,
géographie, ethnologie) furent le fer de lance. On doit à
Xénophane, au – 6ème siècle, la première harangue philosophique
sur la supériorité absolue des dieux sur les hommes ; un siècle et
demi plus tard, Platon condamnait les poètes pour leur légèreté à
l'égard de la représentation qu'ils proposent des dieux à leur
public. De même, la médecine hippocratique, en concevant la maladie
comme une défaillance dans l'équilibre du corps humain et non plus
comme l'intrusion d'un démon dans celui-ci, rompt avec la médecine
traditionnelle, celle des sorciers et des sorcières en premier lieu
(il lui est plus difficile de s'attaquer de front à la médecine
liée au culte d'Asclépios-Esculape) qu'elle dégrade en
charlatanisme. Il en est de même de l'astronomie, héritage
mésopotamien, dont les Grecs ne retiennent rapidement que le
principe de régularité rationnelle du mouvement des sphères
célestes. Les sorcières et les sorciers, héritières et héritiers
de l'autre versant, mantique, de l'étude mésopotamienne des astres,
sont encore une fois accusé.e.s de charlatanisme. Et ainsi de suite
: on assiste dans le monde gréco-romain à une « rupture
épistémique » du même ordre que celle qui a eu lieu à partir des
Lumières en Europe et qui exclut toute transgression des lois de la
nature. Les premières victimes en sont les médecins, astrologues et
autres magicien.ne.s, qui vivent de l'exercice traditionnel de leur
art et qui se trouvent notamment transformé.e.s en effrayantes
sorcières dans les productions des littérateurs.
La
persistance de la magie et de la sorcellerie à travers les siècles
dans le monde gréco-romain tient moins de la lente diffusion de la «
culture moderne » de l'époque et des réticences des populations
rurales à l'adopter, que de sa confrontation directe avec les
grandes cultures de la Mésopotamie et de l'Égypte, dont la Grèce a
toujours revendiqué l'héritage et qui ne partagent pas du tout ses
principes. C'est tout particulièrement le cas de l'Égypte.
Chez
les Égyptien.ne.s, le chaos n'appartient pas à un passé révolu :
il est tout à fait actuel et menaçant. Ordre et chaos sont en lutte
perpétuelle, et l'ordre ne l'emporte que dans une sphère limitée
et précaire. Si le soleil se lève chaque matin, si le Nil fait sa
crue tous les ans, si l'on peut observer des phénomènes de
répétition dans la nature permettant de définir des lois
naturelles, c'est parce que l'ordre triomphe actuellement du chaos,
mais il pourrait en être tout autrement et la religion égyptienne
prévoit un avenir où le chaos régnera.
Dans
ce système, l'ordre a ses divinités et son clergé, le chaos a les
siennes et s'il n'a pas de ministres, un certain nombre de
professionnel.le.s prétendent pouvoir en solliciter la force
perturbatrice pour bouleverser l'ordre des choses au profit de leurs
client.e.s. Ces professionnel.le.s sont ces sorcières et sorciers,
mages et magiciennes, enchanteresses et enchanteurs, nécromanciennes
et nécromanciens, dont leurs collègues grec.que.s et romain.e.s
sont les héritier.e.s. Lutter contre ces dernier.e.s, c'est
fatalement combattre les premier.e.s, ce que Rome s'attachera à
faire à de nombreuses reprises sans y parvenir, tant était grand le
prestige des rites égyptiens, ce à quoi le christianisme s'engagera
à son tour pendant des siècles, sans plus de succès. Les poètes
quant à eux, tout en s'inscrivant dans cette entreprise de
dénigrement, en ont surtout profité pour agrémenter leurs récits
de personnages fascinants.
La
sorcellerie et la magie gréco-romaines sont une adaptation de la
vision religieuse égyptienne à la pensée indo-européenne. En soi,
ces deux arts ne sont pas genrés : les hommes comme les femmes
peuvent les pratiquer. Mais la religion « officielle » étant
d'essence masculine, car fondée sur les notions de créance et de
fidélité, développées dans les sphères de sociabilité
masculine, la notion d'ordre étant structurellement masculine, celle
de désordre féminine, l'on va les décliner davantage au féminin :
si Hippocrate, décrivant leur réalité sociale, en parle plutôt au
masculin, dès que la littérature, lieu où s'expriment fortement
les représentations et les phantasmes d'une société donnée,
s'empare de cette même réalité, ils deviennent l'apanage exclusif des femmes. Par ailleurs, celles-ci vont investir davantage des
champs qui leur sont abandonnés,
parce que considérés comme dévalorisants pour les hommes.
Ce
processus de féminisation de la magie et de la sorcellerie est
toujours à l'œuvre aujourd'hui : séries, films, littérature et
même essais ne cessent de développer et d'explorer la figure de la
sorcière, fort éloignée de celle de l'Antiquité. Ainsi l'idée
d'une gentille sorcière, courante aujourd'hui, n'y aurait point fait
sens, de même que l'opposition entre magie blanche et magie noire.
Il n'y a pas de bonté ou de méchanceté dans la sorcellerie
antique, ce qui en ferait une expression propre à l'individu de ses
mœurs et de sa psyché. Le sorcier et la sorcière antiques sont
plutôt des marginales et des marginaux, puisqu'iels sont exclu.e.s
de la société, conçue comme le reflet humain de l'ordre et de la
permanence cosmiques. Iels sont craint.e.s et fascinent, parce
qu'iels dépendent de puissances rivales des puissances du bien,
sachant que la contrepartie de cette fascination et de cette crainte,
c'est la dépréciation sociale, la réprobation morale et
l'isolement réservés aux ennemi.e.s de l'ordre social.