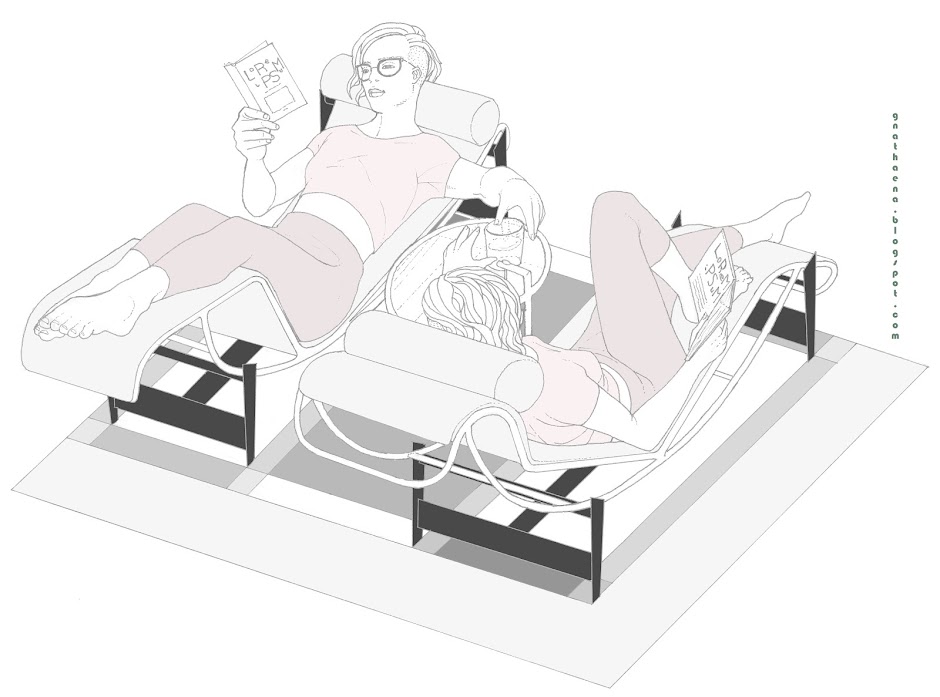Sainte Élysabel, mystique canonique
Élysabel, fille du roi de Hongrie, fut la première de ce XIIIe siècle à avoir connu la conversion mystique dont Angèle nous a laissé un si précieux témoignage et dont le conte sacré de Marie l’Égyptienne nous livre par ailleurs la structure. Elle n’a pas vécu longtemps (1207-1231 : soit 24 ans !) mais, par sa canonisation papale (1235), a eu une influence notable sur les femmes de la haute noblesse… française. Saint Louis aurait-il été saint s’il n’avait été le fils de Blanche de Castille qui l’admirait ? Selon Jean de Joinville en effet :
« Le service de la reine était assuré par le comte de Boulogne, qui fut depuis roi de Portugal, et le bon comte Hugues de Saint-Pol, et un Allemand âgé de dix-huit ans, dont on disait qu’il était fils de Sainte Élysabel de Thuringe ; on disait que la reine Blanche lui baisait le front par dévotion, en pensant que sa mère le lui avait bien souvent baisé. » Vie de Saint-Louis, Chapitre 96
La scène décrite pourrait dater de 1239, dernière année d’exil du fils de la sainte (né en 1222), avant son accession officielle au landgraviat de Thuringe, sous le nom de Hermann II, qui n’y régna d’ailleurs que deux ans, victime sans doute de son oncle paternel qui lui a en l’occurrence succédé. Les histoires de famille à ce niveau supérieur de l’échelle sociale ne sont pas banales. Elles ne diffèrent cependant pas dans leur structure de celles des familles de moindre noblesse (celle d’Angèle).
De l’expérience mystique d’Élysabel, ne subsiste que ce qui transparaît dans les actes de sa canonisation, qui incluent les témoignages des « filles » de la sainte, témoignages intimes mais limités du fait de l’orientation particulière de sa direction spirituelle, j’y reviendrai. Ces archives « mortes » ont alimenté un certain nombre de productions littéraires au XIIIe siècle : un commanditaire souhaite offrir à un dédicataire le récit de la vie d’Élysabel, il passe commande à un lettré qui part les consulter (elles ont rapidement migré de Rome à Paris) et qui produit sur leur base un poème ou un récit en prose. C’est ce qui s’est passé pour Rutebeuf, qui a écrit la Vie de sainte Élysabel après avoir parcouru les actes de sa canonisation sur la demande d’Érart de Lezinnes, chanoine d’Auxerre, qui voulait la faire connaître, pour son édification, à Isabelle de Navarre, fille de Saint-Louis, mariée à 13 ans à Thibaud V de Champagne.
Choisir aujourd'hui la version de Rutebeuf pour lire le récit de la vie d’Élysabel, c’est ainsi privilégier en arrière-plan un lignage original partant d’Élysabel elle-même, se transmettant à Blanche de Castille et d’elle à Saint-Louis, puis de lui à Isabelle de Navarre qui, lisant Rutebeuf, retrouve Élysabel et donc elle-même (au XIIIe siècle, Élysabel = Élisabeth = Ysabeau = Isabelle) dans un cercle mystique où ses dispositions à la charité et à l’humilité peuvent trouver toute leur légitimité (face aux pressions de son entourage, que connaissait Érart).
Rutebeuf reprend la division canonique de la vie de la sainte :
l’enfance, marquée par la pureté / chasteté (de 4 ans, date de ses fiançailles, jusqu’à 13 ans, date de son mariage avec le landgrave Louis IV de Thuringe, de 7 ans son aîné),
le temps du mariage, de 14 à 20 ans, période où elle conçoit trois enfants de Louis (dont le fameux Hermann II accueilli à Paris par Blanche de Castille), marqué par la double vie dans le siècle et dans la foi,
la pénitence, pendant sa 21ème année : à la mort du landgrave en Italie, sur la route de l'outre-mer, Élysabel est chassée par son beau-frère et son douaire non restitué ; elle est prise en charge par son directeur spirituel Conrad de Marbourg, mais aussi, de plus loin, par le pape Grégoire IX, qui la canonisera après sa mort,
l’entrée en religion, de 22 à 24 ans, période de pleine maturité spirituelle de la sainte.
Dès 4 ans, Élysabel est pieuse par imitation : ne sachant pas lire, elle emporte à l’église son psautier, ne sachant pas prier, elle se tient de longs moments auprès de l’autel, n’ayant pas péché, elle s’y mortifie. Elle fait aussi semblant de jouer et en son cœur reste auprès de Dieu. Elle se lie très tôt à Saint-Jean par qui elle cultive les deux vertus de chasteté et de pardon. Cette enfance très heureuse est entachée d’une souffrance, causée par ses précepteurs, « les pires chevaliers de la maison de son père ». Mais elle en tire la vertu de patience. Une menace se profile pour autant à l’horizon : chez Louis IV de Thuringe, dont l’entourage l’invite à répudier son épouse dès qu’iels seront marié.e.s sans restituer le douaire (objet véritable du mariage : le roi de Thuringe est pauvre et le douaire de Hongrie doit lui permettre de garantir son endettement croissant).
À 14 ans, Élysabel est mariée, Louis IV, qui en a 21 et qui l’aime, ne l’a pas répudiée. Elle passe le plus clair de son temps en oraison à l’église du château de Wartburg (qui est la sienne, car le château relève de son douaire) et le reste elle le donne aux lépreux, qu’elle héberge jusque dans son verger privé (jardin clos où la châtelaine peut se réfugier quand elle ne veut voir personne, elle seule en ayant les clés, et où elle peut recevoir courtoisement son amant : ici, le contraste lépreux / amant, indique déjà le type d’amour, purement spirituel, qui guide Élysabel). Apparaît alors un nouveau personnage : Conrad de Marbourg, Franciscain entendant diriger cette âme qui pourrait être sauvée si elle était protégée du siècle, mais qui risque de chuter tant elle est exposée dans ce haut lieu du complot politique. Avec l’accord de Louis IV, il obtient qu’Élysabel se retire à l’abbaye d’Eisenach si celui-ci devait mourir avant elle. Il tâche de la maintenir pure dans le siècle : il lui interdit notamment de consommer tout aliment ou boisson provenant de rapine. Louis apprend ainsi par une de ses suivantes qu’Élysabel est loin de manger à sa faim et de boire à sa soif tant le château s’approvisionne des voies de la rapine. Il en est désolé, mais avoue la pauvreté de ses domaines et son incapacité à interdire une pratique que tous jugent honorable. Son époux l’appuie ainsi jusqu’aux limites de ce qu’impose sa position : lorsqu’elle se fait réveiller la nuit pour aller prier et se faire mortifier (ses suivantes sont chargées par Conrad de la battre régulièrement), il ne lui dit rien mais s’en plaint : « à endurer sans cesse, on ne peut durer longtemps ». Mais Élysabel vise plus haut : « je veux que la chair pâtisse de n’être pas capable de ce que l’âme doit faire ». Et finalement, Rutebeuf écrit : « elle vivait ainsi nuit et jour comme si elle n’avait pas de mari ». Ses enfants n’ont pas de valeur particulière pour elle, ils valent comme enfants, et elle les mène à l’église à l’imitation de Marie conduisant Jésus au Temple. Si sa vie privée se passe en oraisons et en mortifications, sa vie publique consiste à faire filer des toiles pour les frères mineurs, à visiter les malades, à faire ensevelir les morts et à racheter les dettes des pauvres, liste éminemment suggestive de sa position de femme dominante en Thuringe. Le couple de Louis et Élysabel montre sa solidité à l’occasion de la famine qui sévit à Crémone : le landgrave envoie les aliments de ses fermes et son épouse s’occupe des malades et des enfants. Se vêtant souvent de hardes, Élysabel prophétise sur la fragilité de sa position : « Quand je serai dans la misère, je serai dans cette tenue ». Son prêche aux pauvres et aux lépreux est typique des doctrines franciscaines :
« Vous devez, chers seigneurs, souffrir votre martyre en faisant bon visage. Vous ne devez en avoir ni souffrance ni colère, car je crois fermement pour ma part que si vous prenez en patience l’enfer qui est le vôtre en ce monde et si vous savez en remercier Dieu, vous serez quittes de l’autre enfer : sachez-le, c’est une grande grâce. » (vv. 892-900)
Louis IV part en terre sainte et y meurt de la peste. Élysabel est chassée avec ses suivantes du château de Wartburg par ses chevaliers, son beau-frère ne fait rien contre. Une nuit à l’auberge du bourg, quelques autres chez un de ses bergers, Élysabel envoie ses trois enfants chez son oncle paternel.
« Je n’aime guère plus mes enfants que les enfants de mes voisins. À Dieu je les donne, à Dieu je les laisse, qu’il les traite à son plaisir désormais. Je n’aime que Dieu seul, mon créateur, mon sauveur. » (vv. 1259-1264)
Elle-même est recueillie par sa tante qui souhaite lui trouver un nouveau mari. L’arrivée des ossements de Louis IV à Wartburg lui donne l’occasion de retourner en Thuringe, sa tante essaye sans succès de monnayer la venue d’Élysabel contre la restitution du douaire. La sainte est tout de suite prise en main par Conrad qui lui fait quitter le château pour rejoindre, elle et ses suivantes, une masure en ruine du domaine franciscain de Marbourg. Là Élysabel reçoit 2000 marcs de ses partisans, qu’elle « donne » immédiatement aux pauvres, c’est-à-dire qu’elle dépense pour construire un hospice. Ses partisans l’abandonnent définitivement. Conrad l’oblige à mener une vie de vraie pauvreté, ses plus chères amies sont éloignées : d’où le caractère partiel des témoignages sur Élysabel, Conrad renvoie en effet chacune de ses compagnes qui, se rapprochant d’elle et recueillant ses confidences et enseignements, lui apporte un certain réconfort terrestre. Telle est la discipline monastique la plus traditionnelle, et il ne faut pas y voir une expérience sadienne sur la sainte. Du réconfort, Conrad ne peut éviter que le pape lui-même en donne à Élysabel, par l’intermédiaire de lettres d’encouragement et d’enseignements. L’affaire de la fille du roi de Hongrie est en l’occurrence devenue « politique », du moins au sein de l’Église : le pape y voit l’occasion d’exercer lui-même son pouvoir de canonisation, pouvoir jusqu’ici exercé par les évêques, qui tirent des reliques une part importante de leur prestige et de leur fortune. Avec Élysabel, le pape lui-même prend la main, par-dessus les évêques.
Au bout de cette année importante, Élysabel entre enfin, avec ses suivantes, chez les frères mineurs. C’est une période spirituellement faste qui va durer jusqu’à sa mort. Elle est marquée par de longs récits édifiants. L’un d’eux est intéressant, Rutebeuf qui aime les figures circulaires l’a bien mis en valeur. Élysabel rencontre une femme en train d’accoucher, elle l’aide mais la femme s’enfuit avec son mari et les cadeaux de la sainte ; tandis qu’Élysabel fait rechercher le couple, celui-ci revient de lui-même pour demander pardon ; un jugement exemplaire est prononcé par la cité. Cette histoire en apparence anodine est en fait un conte de la maternité choisie d’Élysabel, où elle prend tour à tour les rôles d’accoucheuse, de marraine, de bienfaitrice et de protectrice. L’histoire montre aussi comment elle a su ne pas recourir à la prière pour obtenir justice, mais au scandale et au jugement des hommes. Il y a aussi l’histoire du roi de Hongrie, enfin réveillé de sa torpeur, qui la fait quérir par un comte bien armé, mais celui-ci renonce bien vite après qu’il l’a vue et qu’il s’est convaincu que son mode de vie était pleinement choisi. Conrad ne cesse en arrière-fond de lui ôter tout confort terrestre et elle finit par en mourir, heureuse. Car Élysabel a eu une vie spirituelle riche, que les témoignages ne sont pas parvenus à rendre : « ses extases étaient son secret » écrit Rutebeuf. Son corps ne se putréfie pas, on constitue des reliques en découpant son vêtement, le bout de ses cheveux et de ses seins, ainsi que les doigts de pied. Elle est enterrée dans une église construite à cet effet par l’ordre teutonique.
La conscience du péché théologique n’explique pas la rudesse de la vie d’Élysabel : c’est son statut de femme qui pose problème, et sa vie mortifiée est à la hauteur de l’écart avec la vie qu’elle aurait menée si elle avait été un homme (elle aurait sans doute été évêque quoique de famille royale). Si la voie est rude et semble opposer Élysabel à sa féminité (soumise), la fin, une vie d’extases (chèrement conditionnées par les coups) et une mort librement choisie, semble au contraire réconcilier la sainte avec sa féminité (libérée).
Sainte Douceline, première béguine du Languedoc
Alors qu’Élysabel et Angèle ont dû supporter les contraintes du mariage et de l’enfantement forcé, Douceline a pu quant à elle les éviter. Ses parents, riches marchands provençaux, habitant à Digne au moment de la naissance de leur fille, trouvent en effet en elle un moyen de rachat devant Dieu, similaire à celui des nobles qui placent dès leur plus jeune âge certaines de leurs filles dans des abbayes. Cet évitement, Douceline le paiera de toute façon le prix qu’Élysabel et Angèle ont payé pour se libérer de leur mariage. La structure est identique malgré la différence des situations.
Le récit de la vie de Douceline (1214-1274) semble être dû à Philippine de Porcellet (ou Felipa Porcelleta), témoin proche de la sainte (sanctifiée par la ferveur populaire et l’évêque d’Orange), pas au point de pouvoir dire quelque chose de très précis de l’intimité de celle-ci, mais dont le talent littéraire est indéniable et rend très vivant le tableau qu’elle en fait. Il est intéressant de noter que c’est de l’entourage féminin choisi de Douceline qu’elle tient de pouvoir être connue aujourd’hui.
La vie de Douceline peut être divisée en quatre séquences :
l’enfance, marquée par son engagement dans les œuvres de ses parents en faveur des pauvres,
la mort du père et l’appui du frère pour la fondation des béguinages de Hyères et de Marseille,
la ferveur populaire et l’exhibition à la noblesse, marquée par ses ravissements mystiques et les épreuves subies à cette occasion,
la maturité mystique de la fin de sa vie.
Il me faut dire quelques mots de la famille de Douceline, et de son lien à Saint-Louis, par lequel l’histoire de Douceline vient rejoindre celle d’Élysabel. Ses parents étaient de riches marchands sans attache locale : ils habitent successivement à Digne, à Barjols, à Hyères, suivant une trajectoire résidentielle nord-sud. Douceline vivra de son côté entre Hyères et Marseille. Ils ne sont pas pour autant coupés des cités qu’ils habitent successivement. Ils les servent en secourant les pauvres, qui absorbent ainsi une part importante de leurs revenus. Leur charité les sauve en tant que riches. L’éducation de leurs deux enfants va dans le même sens. À aucun moment ils n’exigent de leur fils qu’il reprenne les affaires. Leur lignage s’éteindra après eux. Tel est le prix qu’ils veulent payer pour être sauvés. On peut dire que leurs enfants ont été victimes de leur choix, mais en même temps iels l’ont très bien vécu. Le fils, Hugues, s’est rapproché de la communauté franciscaine de Hyères, il leur met à disposition la (vaste) demeure familiale pour des séminaires édifiants, où l’œuvre de Joachim de Flore est lue, discutée, interprétée. De nombreux philosophes passent par Hyères (Robert Grosseteste, Roger Bacon), Hugues est célèbre pour ses sermons. Il est très proche de Jean de Parme, qui deviendra ministre de l’ordre des frères mineurs de 1247 à 1257. Hugues deviendra quant à lui ministre provincial de l’ordre pour la Provence. En 1254, Saint-Louis rentre de Terre sainte et accepte de débarquer à Hyères, quoique la cité relève de la seigneurie de son frère le comte de Provence.
« Le roi entendit parler d’un cordelier qui s’appelait frère Hugues ; et à cause de la grande renommée qu’il avait, le roi envoya chercher ce cordelier pour le voir et l’entendre parler. Le jour où il vint à Hyères nous regardâmes vers le chemin par où il venait, et nous vîmes qu’une très grande foule d’hommes et de femmes le suivaient à pied. Le roi le fit prêcher. » (Hugues attaque les clercs qui entourent le roi, puis invite celui-ci à faire preuve de justice envers son peuple, s’il veut garder son trône. Le roi veut qu’il demeure à ses côtés, il refuse catégoriquement. Ndlr) Jean de Joinville, Vie de Saint-Louis, 657-660
Quant à la fille de la famille, Douceline, elle suit un chemin original, puisqu’elle fonde les deux premiers béguinages du Languedoc. Hugues l’aide activement. Frère et sœur suivent chacun.e sa voie mais iels sont remarquablement coordonné.e.s chacun.e selon son genre, avec de nombreuses passerelles, y compris dans la mort puisqu’iels seront enterré.e.s dans le même caveau d’une église de Marseille et y produiront des miracles, chacun.e selon son genre. Une histoire bourgeoise très édifiante pour une famille exemplaire dans la cohérence intergénérationnelle de son projet de sacrifice de soi sur l’autel social et culturel languedocien.
L’enfance de Douceline, vouée à seconder ses parents dans les œuvres pour les pauvres et les malades, est marquée par quelques histoires édifiantes, où Douceline apprend à surmonter la barrière des genres et des âges (laver le corps d’un adulte malade pour une petite fille) et se convainc de la grâce de Dieu à l’égard de celleux qui souffrent jusqu’à en mourir.
Lorsque leur père décède, Hugues doit partir à Paris. Douceline prend temporairement l’habit de pénitence en rejoignant les frères mineurs de Gènes. Hugues de retour, devenu maître provincial, Douceline le rejoint à Hyères et y fonde l’institut des dames de Roubaud (du nom de la rivière au bord de laquelle est établi l’institut). Hugues lui en donne la règle. Il s’agit d’un béguinage, lieu de rassemblement de dames continuant à vivre dans le siècle mais se vouant, elles et leur fortune (elles sont souvent veuves, nobles ou bourgeoises, rassemblées autour de la même « religion »), à des œuvres de charité. Douceline y a fonction de « mère » et les dames en sont les « filles ». Devant le succès de la maison Roubaud, Douceline ouvre un institut similaire à Marseille. Cela ne se fera pas sans qu’entre en scène le comte de Provence. Toute cette période de grande activité est marquée par une personnalité qui s’impose par sa sensibilité, signe d’une intimité épanouie.
« Si grande était la naturelle tendresse de cœur de la Sainte qu’elle ne pouvait entendre parler qu’on tuât oiseau ni bête. Alors elle frémissait toute d’un sentiment de compassion, à propos de ces créatures, surtout, qui représentent le Christ en leur semblant et en sont, suivant l’Écriture, l’Image. Maintes fois, quand on lui apportait des oiseaux vivants pour lui faire plaisir, elle ne les laissait pas tuer. Mais après s’être un peu égayée avec eux, parlant de Notre Seigneur qui les avait créés, elle élevait son esprit vers Dieu et les lâchait en disant : « Loue le Seigneur, ton créateur ». À la vue des agneaux et des brebis, elle était dans l’enchantement et toute remuée d’un merveilleux amour pour le véritable Agneau Jésus Christ qui lui revenait vivement en mémoire. Cette vertu l’inclinait à partager toutes les afflictions qu’elle voyait ou dont on lui parlait. (…) Cela même qui était éloigné d’elle, le zèle de sa charité le lui rendait proche. (L’exemple donné est celui des religieuses d’Antioche, mises en servitude par les Sarrasins, ndlr). Elle disait : « Il ne faut pas rester étrangèr.e aux tribulations qui arrivent outre mer. Car en vérité, quiconque ne sentira pas les maux survenus au loin, Dieu les lui amènera sur la tête. » (Chapitre 7 – Tendresse et innocence de cœur)
Cette sensibilité est poussée jusqu’à la capacité à s’extasier devant la beauté de chaque chose en tant que créée par Dieu et devant l’harmonie divine de leurs rapports naturels. Vis-à-vis des pauvres et des malades, Douceline agit en militante : elle entretient des femmes, qui parcourent la ville pour les débusquer et les ramener à elle et à ses filles. « Mes filles, ne pensez point que ceux que vous servez soient des hommes. Non, mais bien plutôt la propre personne du Christ. » Pour autant, les œuvres sont peu de choses si elles ne sont produites par une foi bien entretenue. « Sachez-le, tant que vous continuerez l’oraison, votre institut durera et vous persévérerez en tout bien. Mais que vous l’abandonniez et qu’elle disparaisse d’entre vous, et tout est perdu. Car c’est elle, la colonne inébranlable de notre institut ». Et en l’occurrence, la maison Roubaud ne fermera pas avant 1414. Philippine de Porcellet succédera à Douceline à la mort de celle-ci en 1274 et de même trouvera une successeure à sa mort en 1316 et ainsi de suite pendant encore un siècle.
Avec l’intensification de sa sensibilité, Douceline aborde une période compliquée, où elle ne peut plus cacher ses extases et où viennent se croiser la ferveur populaire et la mise à l’épreuve de l’aristocratie du plus bas au plus haut de l’échelle de la noblesse. Philippine décrit ainsi cette intensification jointe à la consolidation d’une intimité imperturbable :
« Bien qu’elle ne fût qu’une femme simple et sans lettres, Notre Seigneur l’éleva au plus haut degré de la contemplation. (…) Elle avait un oratoire très secret où elle priait Notre Seigneur et où elle s’unissait plus familièrement à Dieu. (…) Elle ne pouvait ouïr parler de Dieu, ni de Notre Dame, ni même de Saint-François, ni de saints ni de saintes, qu’elle ne fût prise de quelque ravissement. Bien des fois, suspendue en une contemplation sublime, elle demeurait ravie tout un jour. Et, dans cet état, elle éprouvait quelque chose de surhumain, elle ne connaissait rien, ne sentait rien de ce qu’on lui faisait. (…) Quelquefois, elle se tenait suspendue en l’espace, sans s’appuyer sur rien, sans toucher des pieds la terre, hormis des deux gros orteils, si fort élevée en haut et soutenue en l’air, par l’effet de son merveilleux ravissement, qu’entre la terre et elle il y avait bien un empan ; aussi des gens lui baisaient-ils la plante des pieds durant ces extases. » (Chapitre 9 – Oraisons et ravissements)
La posture adoptée par Douceline dans ses extases, qui peut rappeler les pointes des danseuses classiques depuis le XIXe siècle, mais dans une version statique que peu pourraient tenir plus de quelques secondes, ne manque pas d’attirer les curieux, d’autant que Douceline est portée à se murer dans son jardin secret intime (car l’extase mystique féminine médiévale est l’équivalent immatériel du verger privé des dames où celles-ci reçoivent en secret leur amant). « Deux années entières, elle dissimula et empêcha que ses ravissements fussent connus de quiconque ». Mais elle ne le peut plus longtemps et devient une attraction populaire à Hyères, produisant à son spectacle de nombreuses conversions. Elle cesse alors de suivre les offices publics et ne va plus aux grandes fêtes sacrées. Après le peuple, la noblesse et le clergé ne manquent pas d’accourir, et les barrières dressées par Douceline ne peuvent pas les arrêter. Du côté de la noblesse, cela commence par les témoignages de Jacques Vivaud, seigneur du château de Cuges, et de Raimon du Puy, de Marseille. Ceux-ci se contentent de baiser la plante de ses pieds et le second place une de ses filles à la maison Roubaud. Quant au frère du roi, l’affaire est moins anodine : le comte de Provence a essuyé une révolte des Marseillais et accuse les Franciscains d’avoir soutenu le peuple (la bourgeoisie), il médite sur les moyens de s’en débarrasser et lorsqu’il entend parler de Douceline et de son lien avec l’ordre des frères mineurs, il ne peut s’empêcher de la sadiser sous couvert de l’éprouver (et cette fois il s’agit bien de sadisme).
« La première fois que le roi Charles la vit en extase, il voulut en éprouver la sincérité. Il était, en ce temps-là, comte de Provence (il sera, pour peu de temps, roi de Sicile, avant de se rabattre sur Naples dont il crée la dynastie angevine, ndlr), et voici de quelle manière il l’éprouva. Il ordonna de fondre une masse de plomb et, lui présent, le fit jeter tout bouillant sur les pieds déchaussés : elle ne le sentit pas. Par suite de cela, le roi la prit en telle affection qu’il la nomma sa commère. Mais après qu’elle fut revenue de ce saint ravissement, elle ressentit douleur au pied et insupportable angoisse. Elle en fut longtemps toute languissante et hors d’état de marcher. » (Chapitre 9 – Oraisons et ravissements)
Après avoir été ainsi exposée (moins cruellement) à la comtesse de Provence et au comte d’Artois, Douceline prend les choses en main : « Perfides sœurs, pourquoi avez-vous souffert cela et m’avez-vous livrée en spectacle ? ». Il y a eu encore des religieux de l’Université, impossibles à éviter, mais respectueux une fois leur visite faite. Jean de Parme, ministre général de l’ordre des frères mineurs, et grand ami de son frère Hugues, lui donne sa bénédiction : « Reste, ma fille, reste fidèle à ce que tu as bien commencé. Ne va pas chercher autre chose. Tu n’as rien à faire d’un autre ordre (celui des maisons Roubaud et de Marseille). Ne t’écarte, sous aucun prétexte, de l’état où Dieu t’a placée. Car, sois en sûre, c’est le Seigneur qui t’as mise là où tu es. »
Pour illustrer la maturité mystique de Douceline, je voudrais citer ce (très beau) passage où Philippine raconte comment la sainte fut ravie au milieu des frères mineurs lors d’une fête de Notre Dame.
« Alors, devant l’autel de Notre Dame, la Sainte mue, transportée de corps et d’esprit, se mit à chanter « Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli ». Et une joie prodigieuse était empreinte sur son visage. Tous ensemble, les frères lui répondirent, abandonnant l’antienne pour son chant à elle, dans une allégresse spirituelle extraordinaire qui les possédait tous. Ensuite, elle pénétra dans le chœur, chantant d’une voie fervente l’Assomption de Notre Dame. Et les frères, en une consolation indicible, chantaient tout ce qu’elle chantait. Et ainsi, soulevée de terre et chantant, elle parcourut tout le chœur des frères, jusqu’en dehors de la grille, toujours placée dans son ravissement et paraissant suivre la procession que les saints anges firent à la Vierge Marie quand elle monta au ciel. Et les frères, pour plus de révérence, suivaient derrière elle très dévotement et la conduisaient, ainsi soutenue en l’air, avec grande allégresse et grande vénération. » (Chapitre 9 – Oraisons et ravissements)
Marie l’Égyptienne, Angèle, Élysabel et Douceline
Les XIe et XIIe siècles avaient produit leur lot de moniales mystiques, mais il a fallu attendre que se développent les ordres mendiants au XIIIe siècle pour que l’élan mystique féminin séculier puisse à son tour se déployer. Le destin des femmes nobles et bourgeoises au Moyen Âge était fort réduit : placées dès le plus jeune âge dans des couvents, ou vouées au mariage. Leurs modes de vie n’étaient pas censés se rejoindre. Les premières étaient sacrifiées en rachat des péchés des parents, les secondes, auxquelles il fallait ajouter un douaire si l’on voulait les protéger un peu, étaient livrées aux besoins reproductifs d’une famille alliée. Il faut croire que le destin des premières était plus enviable que celui des secondes, puisque dès que cela a été possible des femmes nobles et des femmes bourgeoises livrées au siècle et supportant mal la servitude qui lui est attachée, s’en sont libérées dans la foi à l’imitation des religieuses « de naissance ».
La mystique des femmes du siècle est cependant originale.
Elle peut s’appuyer sur le « réveil » d’une conversion fondée sur la conscience du péché ultime de l’oubli de Dieu (Angèle à l’imitation de Marie l’Égyptienne), ou bien, plus généralement, sur les empêchements à parfaire son union à Dieu provenant de l’entourage immédiat (Angèle après son réveil, Élysabel) ou de l’entourage plus éloigné (toutes, y compris Douceline). Même dans les cas les plus favorables, l’horreur de l’oubli de Dieu est à la source de l’élan mystique : il y a toujours un stade d’identification, d’une manière ou d’une autre, aux assassins du Christ.
Autre originalité : en l’absence de cloître, la femme mystique se construit, au milieu du siècle, un espace intime, inviolable, où se retrancher. Il est le correspondant spirituel du verger privé de la dame qui en possède la clé et y reçoit en secret son amant. Ici, l’amant est Jésus lui-même, mais le jardin intime accueille aussi le Saint-Esprit et la Vierge Marie, ainsi que certain.e.s saint.e.s auxquel.le.s la mystique est particulièrement attachée. Il est essentiellement un lieu d’amour où l’on partage joie et peine – dans une disproportion que vient corriger Notre Dame, simple femme à la hauteur du divin Fils qu’elle a porté.
Le rapport à la maternité est en l’occurrence particulièrement marqué : d’une part le rejet de la maternité sociale forcée et d’autre part l’assomption d’une maternité dans la foi, maternité choisie où priment les « filles » sur les « fils », auxquel.le.s elle peut enseigner par « instructions » plutôt que par répétition (au Moyen Âge comme dans l’Antiquité, l’enseignement scolaire est fondé sur la répétition de modèles).
Entre ce rejet et cette assomption, il y a tout l’espace de la lutte qu’engage la mystique avec son environnement social. Des adjuvants masculins interviennent de façon décisive : en tout premier lieu la communauté franciscaine locale, avec parfois un élément qui s’en détache (Conrad pour Élysabel, son frère Hugues pour Douceline). Les opposants peuvent être la belle famille (Élysabel, Angèle) ou des membres éminents de la noblesse (Douceline). Dans tous les cas, la ferveur populaire, le soutien des cordeliers et l’appui de très hauts personnages (le pape pour Élysabel, finalement le comte de Provence pour Douceline) permettent à ces femmes d’atteindre une maturité mystique avant de s’éteindre, parfois très tôt (Élysabel).
Dans l’ensemble, la mystique séculière féminine est une réponse à la condition des femmes du siècle, mais aussi à la condition féminine tout court, car le christianisme est loin d’être clair sur le statut « ontologique » des femmes et donc sur leur place dans l’Église. Converties pour ne pas subir l’aliénation qui leur est socialement réservée dans le siècle, elles doivent encore combattre les a priori théologiques sur leur nature de femme, communément jugée plus éloignée de Dieu que celle de l’homme (cf. Saint-Paul). De la révélation de la Passion à la révélation de la gloire de la Vierge, la reconstruction d’un soi féminin se trouve immanquablement initiée dans la violence, poursuivie dans l’extase et accomplie dans la rassurance féminine. Sur ce point Angèle de Foligno demeure exemplaire.
Le contraste entre l’histoire de Marie l’Égyptienne et les vies des mystiques séculières du XIIIe siècle permet de mieux appréhender la spécificité de ces dernières.
L’histoire de Marie est celle d’une femme du siècle vivant hors mariage. Elle est très logiquement l’équivalent d’une prostituée dans sa jeunesse, d’une sorcière dans sa vieillesse. La conversion se situe dans le passage de l’une à l’autre, et la vie retirée dans la forêt s’apparente à une vie de pénitence. La vie de Douceline est aussi celle d’une femme du siècle éloignée du mariage. Mais quelle différence ! À l’opposé de celle de Marie, l’enfance de Douceline est marquée par la pureté, sa jeunesse par l’institution de la maison Roubaud, sa vie adulte par la conversion à ses vues de l’ensemble de la société languedocienne, comte et comtesse de Provence compris.e.s. Une vie entièrement positive que le négatif n’assombrit que par la mise à l’épreuve aristocratique. La différence entre Marie et Douceline tient essentiellement à l’attitude des parents et envers leur fille : Marie vouée au mariage s’enfuit de chez elle, Douceline éloignée du mariage par ses parents les seconde et reprend leur projet caritatif.
L’histoire de Marie est marquée par une crise spirituelle qui en rompt le cours. Il en va de même pour Angèle, mais là encore la différence est grande. Pour Marie il s’agit de rompre avec une vie socialement réprouvée et de se réfugier dans la solitude, pour Angèle il s’agit au contraire de se libérer des pressions de la vie sociale légitime d’une femme du siècle et de vivre un pur amour spirituel dans une intimité parfaitement étanche mais rayonnante et attirant à soi des « filles » converties à ses vues.
L’histoire de Marie est par ailleurs marquée par une violence physique telle que sa vie passée n’a plus aucune chance de la tenter à nouveau. La vie d’Elysabel est elle aussi ponctuée de séances physiquement éprouvantes, mais il s’agit pour elle de ne pas freiner son élan vers Dieu plutôt que de rompre avec un passé qui n’a jamais été que positif (enfance exemplaire, mariage relativement heureux).
Ce qui différencie le plus Marie de nos trois mystiques, c’est que l’héroïne du conte édifiant a fini sa vie sans avoir rien bâti, tandis qu’Élysabel et Douceline ont fondé de véritables institutions (hôpital et béguinages), et qu’Angèle a opéré en quelque sorte la refondation de l’ordre franciscain d’Assise en répétant sur un mode féminin la vie de Saint-François. Nos mystiques sont devenues des mères selon un mode spirituel choisi, alors que le conte n’a pas permis à Marie de renouer avec ce qu’elle avait fui.
Il est ainsi possible, en croisant une critique de Saint-Paul et l’approche de Paola Tabet sur la reproduction forcée, de saisir dans quelle mesure la mystique féminine séculière du XIIIe siècle a été une réponse à une condition féminine problématique mais disposant d’un degré de liberté suffisant pour que puisse être élaboré un modèle de féminité choisie dans la foi et bien inséré dans la société par le biais des sociétés caritatives, hôpitaux ou béguinages.
Entre ces femmes mystiques séculières avec leurs « filles » hospitalières ou béguines du XIIIe siècle et les possédées et mystiques du XVIe au XVIIIe siècle, il y a un trait d’union qui reste à mettre en évidence. Y parvenir me permettrait de transformer mon mémoire de maîtrise en mémoire de thèse.