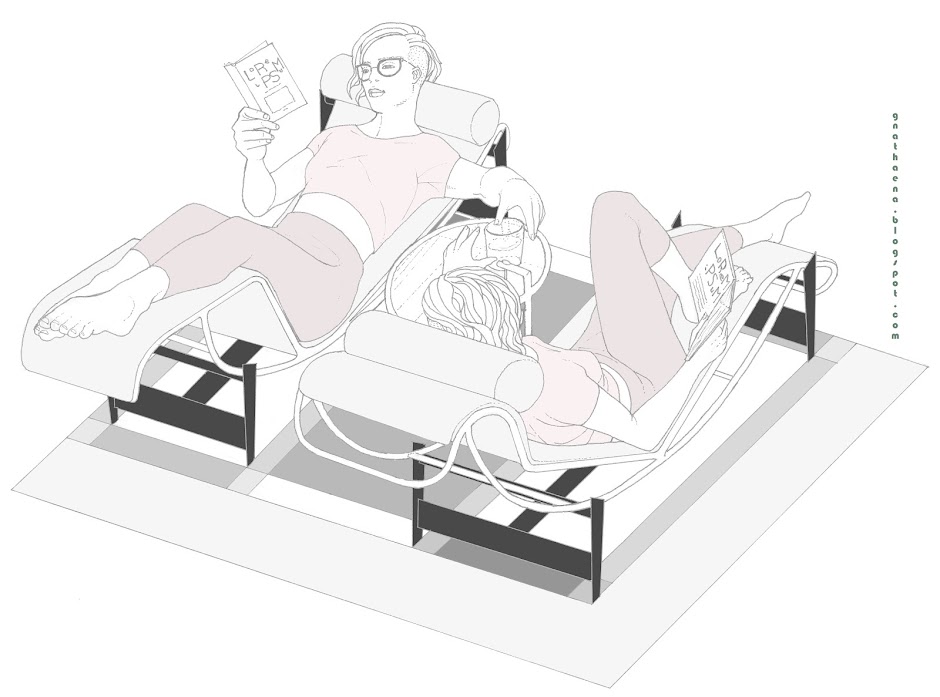Sources :
Ferro Marc, Des soviets au communisme bureaucratique, Les mécanismes d'une subversion, collection Archives, Gallimard-Julliard, 1980.
Grigorenko Piotr, Mémoires, Presses de la Renaissance, 1980.
« Citoyens, soldats, épouses et mères ! Tous à la lutte ! À la lutte contre le pouvoir tsariste et ses suppôts ! » Appel du 27 février 1917 du parti bolchevique.
En 1913, les femmes russes constituent 52 % des effectifs des usines, l'industrie russe de l'avant-guerre étant essentiellement textile, secteur employant traditionnellement une main-d'œuvre féminine. Du fait de la mobilisation des hommes, ce chiffre progresse encore pendant la guerre. Pourtant, quand le parti bolchevique s'adresse aux femmes, il les évoque par leur fonction la plus traditionnelle de soutien domestique aux hommes et de reproductrice (évacuant d'ailleurs les femmes célibataires et peut-être aussi les mères célibataires). Dans le contexte d'une révolution socialiste, où l'existence citoyenne est conditionnée par l'existence professionnelle et qui ne reconnaît pas la maternité et l'éducation des enfants comme un travail à part entière, on peut s'interroger sur la place que les bolcheviques de février 17 entendent donner aux femmes. On peut même subodorer que cette place aura beaucoup à voir avec celle que lui donnait le régime tsariste. Certes il s'agit peut-être ici de toucher une population qui se reconnaîtrait comme appartenant à ces deux catégories. Cependant cette explication ne joue pas en faveur des rédacteurs de l'Appel, témoignant d'un certain paternalisme, puisque les femmes n'ont pas attendu celui-ci pour s'emparer des questions politiques qui agitent la société russe de cette époque et s'engouffrer dans les luttes révolutionnaires, et non pas seulement en tant qu'épouses et mères, mais avec des identités sociales bien plus complexes et moins traditionnelles.
« En témoigne, lors de la révolution de 1917, l'exemple historique des ouvrières tatares de Kazan. Comment analyser leur attitude dans les luttes révolutionnaires et comment définir leur identité sans faire l'inventaire de tous ses attributs ? Musulmanes, ces citoyennes sont des persécutées de la Foi, l'Islam est leur Maison, leur raison d'être. En tant que citoyennes de la nation tatare, elles se sentent également atteintes dans une autre dimension de leur personnalité collective, que l’État oppresseur, la Russie, ignore ou combat aussi bien, par exemple en s'appuyant contre elle sur les Bachkirs : elles participent ainsi au mouvement national tatar. Ouvrières, certaines d'entre elles se considèrent avant tout comme des prolétaires, et elles militent dans des organisations de leur classe, syndicats ou partis socialistes, sinon les deux. Quelques-unes adhèrent au mouvement féministe, si actif dans l'Islam russe à cette époque. Il en est enfin, parmi elles, qui adhèrent à des mouvements de Jeunes, mettant en cause avant tout les contraintes que leur impose la famille traditionnelle. » (pages 13-14)
« Au début de la révolution, phénomène unique dans l'Histoire, les délégations de femmes réussirent à imposer le drapeau de l'émancipation féminine comme principe de la lutte des musulmans de Russie ; les premiers votes collectifs portèrent sur ces questions et définirent ainsi le statut qu'elles souhaitaient acquérir. » (page 105)
La recension, dans ces deux passages, des luttes dans lesquelles se mobilisent les femmes des minorités ethniques et religieuses de Russie, frappe par la diversité et l'exhaustivité des idéaux qui les animent : liberté de conscience et liberté de culte, anti-colonialisme et émancipation des peuples colonisés, luttes ouvrières, féminisme réclamant l'égalité de tous les droits (et non pas seulement salariaux, comme le voudraient les partis), émancipation des jeunes. Cependant ces projets politiques, qui ne se réduisent pas à la seule lutte des classes, sont très tôt écartées, voire combattues, par les révolutionnaires des partis socialistes. Pour Marc Ferro, ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans une révolution ne relève pas de la révolution elle-même ; il la précède, intervient en parallèle, s'inscrivant dans le vide provisoire qu'elle lui abandonne dans tous les domaines (mœurs, travail, arts, vie quotidienne...), et est rapidement stoppé lorsqu'elle triomphe.
Comment expliquer cette hétérogénéité, du moins à moyen terme, entre révolution et idées révolutionnaires ? Le succès d'un mouvement révolutionnaire requiert l'engagement des minorités opprimées, qu'elles soient de classe, de genre, d'âge, d'ethnie, de religion : les dirigeant.e.s de ce mouvement consolident en effet leur autorité face au pouvoir en place (à partir du 16 mars et jusqu'au 8 novembre 1917, le Gouvernement provisoire), en faisant voir que les classes populaires reconnaissent leur légitimité et suivent leurs mots d'ordre et leurs consignes. Mais dans un second temps, lorsque la révolution réussit, elle aboutit à l'établissement d'une société « nouvelle » qui emprunte largement à la société qui l'a précédée, et qui est donc réactionnaire sur bien des aspects. Ainsi les revendications anti-colonialistes appelant à en finir avec la politique de « russification » des peuples autochtones des marges de la Russie, seront très vite étouffées et deviendront même l'objet, dans les années 30, d'une répression féroce, le pouvoir communiste reprenant à son compte la politique tsariste en la matière (imposition d'une langue et d'une culture uniques). La société « nouvelle » renoue par ailleurs avec la dimension disciplinaire qui, selon Michel Foucault, caractérise toutes les sociétés modernes depuis le XVIIe siècle et qui s’accommode mal des initiatives collectives, ascendantes et décentralisées.
Ferro montre bien comment la révolution russe, comme toute révolution, est le lieu d'une lutte pour le pouvoir et comment ce pouvoir fonde sa légitimité sur la prétention à énoncer la volonté d’un peuple ému et à satisfaire ses besoins. En 1917, cette prétention était évidemment celle des partis politiques d’opposition, notamment du parti bolchevique, et des syndicats, dont les membres étaient principalement des mencheviks, mais d'autres institutions exprimaient des prétentions similaires, portant leur propre projet de société. C'était le cas du mouvement des comités d'usine, du mouvement coopératif, des mouvements nationaux, des organisations de la jeunesse et des femmes, des soviets des comités de quartier, de la Garde Rouge et autres forces armées indépendantes... qui s'étaient créés spontanément sans demander l'avis de quiconque*. Le cas des comités d'usine est particulièrement intéressant : respectueux des règles démocratiques (chaque usine choisit son propre mode d'élection), s'affirmant, face à l'inertie des instances dirigeantes et à la passivité des partis et des syndicats, comme des centres autonomes de pouvoir faisant appliquer leurs décisions (journée de 8 heures, grève et reprise du travail, séquestration de patrons et occupation des locaux, réglementation intérieure, autogestion...), ils choisissent de se fédérer à l'échelle de la capitale, avec le projet à moyen terme d'une fédération nationale : la Conférence de Petrograd est la première institution créée ex-nihilo par les classes populaires elles-mêmes. La prise de pouvoir bolchevique a non seulement eu raison des autres partis, mais aussi de ces institutions, qu'elle a progressivement détruites ou mises sous contrôle, en les vidant de leur identité et les faisant passer pour subalternes. Les idéaux révolutionnaires et les projets de société qui animaient ces institutions n'ont cependant pas totalement disparu : ils ont subsisté à l'état résiduel dans la société soviétique, digérés et régurgités par l’État bureaucratique, sous une forme atténuée et affaiblie, ou bien sous celle du pur slogan politique (sans application réelle). Le cas des luttes décolonialistes, fort bien exposé par le dissident Grigorenko dans ses Mémoires, en est une bonne illustration : très actives au début de la révolution, se considérant comme non-subordonnées aux luttes sociales avec lesquelles elles ont pu s'associer, elles sont ensuite réprimées, d'une part, parce qu’il ne faut pas préjudicier à l'empire que s'est taillé la Russie au cours des siècles, d'autre part, parce qu'elles sont jugées contradictoires avec la finalité révolutionnaire transnationaliste et la reprise, sous cette nouvelle bannière, de la stratégie d’unification sociale impériale par l’imposition de la langue et de la culture russes. Elles semblent trouver un écho, à partir des années 60, dans le folklore des nations, mis en avant par Moscou, avec leurs particularismes culturels passés au crible de la russéité. Ce constat est valable pour les luttes féministes : alors que la «Femme » soviétique est supposée jouir de l'égalité des droits et des opportunités, sans cesse invoquée par la propagande par le biais d'une abondante documentation photographique, leur sort est comparable, dans l'après-guerre, à celui de beaucoup d'occidentales : nombreuses sont celles qui sont obligées ou d'abandonner leur emploi ou, au contraire, d'en prendre plusieurs, pour pouvoir prendre soin de leurs enfants et, plus encore, de leurs parents, l'Union soviétique n’offrant aux retraitables qu’une maigre pension (à moins qu’iels ne soient cadres supérieur.e.s du parti) et refusant par ailleurs de salarier les femmes au foyer, revendications majeures des féministes d'avant 1917 ! On voit ici ce que deviennent les idées révolutionnaires au lendemain de la Révolution.**
L'un des moyens employés pour délégitimer les institutions énumérées ci-dessus a été de les qualifier d'« apolitiques ». L'appartenance à un parti ou à une organisation type Bund ou syndicat devient la condition, pendant les journées de février 17, pour accéder au pouvoir, dont la possession ne dépend pas d'une élection (qui n'est que de façade) mais d'une désignation. Les délégué.e.s des casernes et des usines insurgées (et même s'iels se revendiquent comme militant.e.s d'un parti), les représentant.e.s même des milliers de celleux qui ont réellement « fait » la révolution sont écarté.e.s au profit des seuls membres des partis, peu nombreux en comparaison et qui, pour certains, ne sont pas alors à Petrograd (Staline, par exemple, emprisonné en Sibérie). Ferro rapporte également le cas de l'exclusion progressive des instances dirigeantes de l'avocat Sokolov, qui a pourtant été de tous les périls et de toutes les décisions, mais qui est sans appartenance politique. D'un autre côté, les partis (et accessoirement les syndicats) se présentent comme l'unique instance politique, privant de cette identité les groupes divers qui se conçoivent pourtant comme tels : c'est le privilège de la bourgeoisie, où se recrute une partie notable des militant.e.s (la petite-bourgeoisie fournit le reste), de définir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. La boucle est bouclée : seuls les partis sont politiques, seuls les politiques ont droit de « représenter » le peuple qu'iels s'attachent pourtant à rejeter de leurs rangs ! L'on imagine combien les groupes de femmes, d'autant plus si, comme les ouvrières de Kazan, elles font entrer dans leurs revendications celle d'une reconnaissance nationale et religieuse, ont pu être facilement cataloguées comme apolitiques et, de là, non légitimes à s'exprimer et décider.
Allons plus loin : les militant.e.s des partis ne s'approprient pas seulement de façon exclusive la fonction politique, mais aussi l'héritage des révolutions de février et d’octobre 17. Ce sont elleux, ce sont leurs partis qui sont qualifié.e.s de révolutionnaires, qui ont déclenché, dirigé et fait la révolution, d'où le faux paradoxe, sur lequel je me suis attardée en début d'article, d'une révolution non révolutionnaire.
Le dernier acte dans ce mouvement d'appropriation est celui de l’intégration. Comme il n’y a pas de révolution hors du parti qui a pris le pouvoir, les mouvements révolutionnaires n’ont d’autre choix pour survivre que de renoncer à leur organisation initiale, de se bureaucratiser et de recevoir la direction du parti par l’intermédiaire d’un de ses membres « parachuté » à cette fin. Ceux qui ne se plient pas à ce processus de bureaucratisation sont interdits et leurs membres actifs éliminés. Les femmes révolutionnaires ont eu à faire face à la terrible alternative de la condamnation à mort ou au goulag, et de l’intégration à la bureaucratie, moyennant la complète remise en cause de leurs convictions initiales (« bourgeoises » ou « naïves »). L’intégration de la révolution sociale à la révolution politique passe en quelque sorte par la mise à mort rituelle de la première par la seconde, mise à mort qui, comme l’histoire l’a montré, se répète à chaque génération, rattachant l’histoire des dissident.e.s soviétiques à celle des acteurices de la révolution sociale de 1917.
Je conclurai ce très rapide aperçu d'un aspect méconnu de la révolution russe, par un constat un peu désabusé. Je vois souvent affirmé, sur les réseaux sociaux féministes de gauche, que les revendications féministes ne peuvent atteindre leur réalisation sans une révolution préalable, affirmation erronée, à mon sens, qui témoigne d'une méconnaissance des mécanismes révolutionnaires que j'ai décrits précédemment et, plus encore, du fonctionnement des individus qui font et tirent profit de la révolution. Le profil sociologique des révolutionnaires, tel qu'étudié par Pierre Bourdieu, permet de saisir ce fonctionnement : ils appartiennent tous à la catégorie de ceux qu'il appelle les « dominés des dominants », des hommes donc, appartenant à la bourgeoisie***, où ils occupent une place particulière, que leur confèrent la possession du capital culturel et l'absence relative de capital économique et social. Le dominé des dominants aspire à compenser l'absence de relations sociales dans la sphère des dominants par la multiplication des relations dans la sphère des dominés (ouvriers et paysans) et dans celle des dominé.e.s des dominés (femmes du peuple, minorités ethniques...). Ce faisant, il peut accéder à une position de dominant qui généralement rétablit les structures d'oppression qu'il a quelque peu ébranlées pour parvenir à se former une « clientèle ». La lutte de ces révolutionnaires est donc une lutte pour le pouvoir. Pour reprendre les mots du philosophe et théoricien communiste Karl Korsch : « le marxisme » fut « le travestissement idéologique qu'utilisa la classe montante » pour légitimer son droit à gouverner. La classe montante obtient ce droit à gouverner par l'assentiment qu'elle donne aux idées qui lui préexistent, mais les luttes pour ces idées sont écartées dès lors qu'elles diminuent ce pouvoir. Le rapport des Bolcheviks aux Soviets des comités d'usine, aux assemblées des comités de quartier et à la Garde Rouge, véritable organe d'auto-défense de la classe ouvrière face aux milices municipales gouvernementales, est, de ce point de vue, illustratif : dans un premier temps, seul à soutenir ces mouvements populaires pour contrer Mencheviks et SR, le parti bolchevique va ensuite, dès qu'il devient majoritaire dans les syndicats et les soviets de députés, s'attacher à les briser, justement parce qu’ils préexistaient à la révolution. Ce retournement montre qu'il s'agit moins de mettre en œuvre des projets révolutionnaires et de donner de la visibilité à une force véritablement populaire, que de se positionner par rapport à celle-ci contre les autres groupes politiques. Ce positionnement pour / contre est caractéristique de ce que Bourdieu appelle le champ politique, un espace fermé sans rapport avec la réalité, que l'on peut s'étonner de voir exister dans ce temps d'urgence et de péril qu'est une révolution.
* C'est ce qui ressort, par exemple, de la lecture de l'acte de naissance du soviet provincial de Saratov (texte du 5 mars 1917) : « Il y a cinq jours que le soviet des députés ouvriers et soldats s'est organisé ici. (...). Tout a changé. Les masses se sont organisées dans un élan de spontanéité remarquable. » De telles affirmations imposent un démenti formel à la théorie léniniste d'un prolétariat russe mal structuré, incapable de s'organiser, dont la « conscience de classe » ne pouvait venir que de l'extérieur. Les assemblées de village, crées par les paysan.ne.s, sont un autre exemple de création spontanée et d'autogestion d'une catégorie sociale réputée inerte et dominée : se considérant comme parfaitement légitimes et sources de droit, elles ne reconnaissaient comme fonction aux grandes institutions pan-russes (Assemblée constituante, Congrès des Soviets...) que celle de légaliser leurs décisions.
** Ferro relève d'ailleurs même, dès 1917, un écart entre les perspectives des directions des partis, quels qu'ils soient, malgré une volonté d'identification, et celles des groupes sociaux au nom desquels leurs organisations s'expriment.
*** En 1917, il n'y a aucun prolétaire, aucun paysan parmi les « chefs historiques » du socialisme, les soviets sont entièrement contrôlés par la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie, problème majeur dans la structure sociale de ces organisations, que les partis de gauche, affirmant le principe de séparation entre vie privée et vie publique, jugent subalterne et sans conséquence.