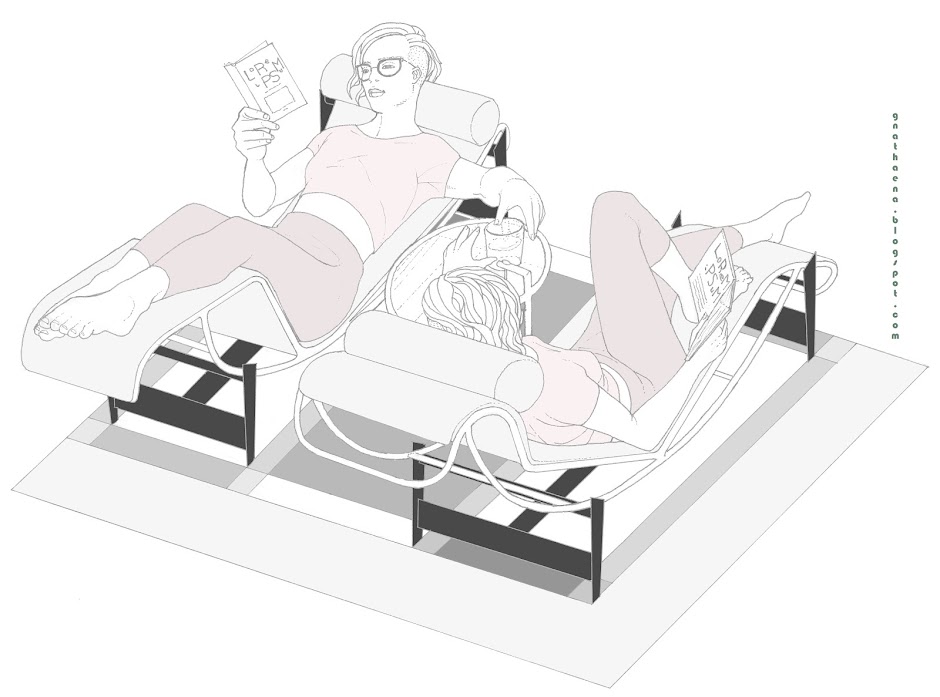Sources :
Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la rose, Collection lettres gothiques, Le livre de poche, 1992.
Christine de Pizan, La cité des dames, Série Moyen Âge, Éditions Stock, 1986.
Bourdieu Pierre, Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Éditions du Seuil, 1992.
Il est constant que la littérature, en particulier romanesque, véhicule de nombreux messages misogynes, et cela, le plus souvent, en toute impunité.
Ces messages sont facilement repérables, mais leur dénonciation se heurte inévitablement à des discours apologétiques agitant les mêmes éternels arguments : « ce n’est pas l’auteur qui est misogyne, c’est son personnage », « un roman est une œuvre de fiction, pas un traité de morale », et, plus sournoisement : « il y a misogynie et misogynie » (la « mauvaise » : celle, masculine, qui est dangereuse pour l’entourage féminin du misogyne ou celle, institutionnelle, qui est préjudiciable à l’ensemble des femmes, et la « bonne » : la misogynie littéraire qui est avant tout un moyen expressif permettant, par exemple, de donner du relief à un caractère ou de manifester la virtuosité de l'auteur dans le registre du blâme, virtuosité qu'il recherchera identiquement dans celui de la louange).
Cet article se propose d'établir une méthode qui permettra de rendre des verdicts inattaquables en matière de haine des femmes littéraire. Pour ce faire, je m'appuierai sur le premier roman européen à avoir suscité une polémique portant sur ses messages misogynes et sur la misogynie de son auteur. Je ne parlerai par ailleurs ici que de misogynie au masculin, sa version féminine étant rare, voire inexistante en littérature (Marguerite de Navarre peut-être ?).
Pour commencer, il me semble indispensable de revenir au travail de Pierre Bourdieu sur le champ littéraire, dont je retiens la sectorisation suivante :
L’avant-garde littéraire se caractérise par son « purisme » : la littérature, rien que la littérature ; elle vise à intégrer le corpus des autorités littéraires, chasse gardée de l’Université qui s'attache à construire une histoire littéraire où la littérature ne renvoie qu'à elle-même (par le jeu des références et des citations).
La littérature commerciale se caractérise par un certain « cynisme » : la littérature exprime les fantasmes de son public, quels qu'ils soient.
La littérature engagée se caractérise par son dévouement : la littérature se doit d'éclairer son public.
Chacun de ces trois grands secteurs du champ littéraire a sa façon de concevoir le lien entre l’auteurice, l’œuvre et le public. De cette conception découle une manière particulière d’aborder la misogynie :
L'auteurice d’avant-garde vit la littérature autant qu’iel la fait. Son seul code moral est celui qui régit sa conduite envers ses pairs et pairesses, vivant.e.s ou mort.e.s : soutien, rivalité, émulation, hommage. Parler de misogynie en ce qui concerne l’avant-garde est donc mal fondé : iels ne reconnaissent que le talent qui, à leurs yeux, est d'ordre spirituel et non pas matériel (et genré), ne s'intéressent pas aux questions et enjeux de société, mais uniquement à ceux de leur petite coterie. La misogynie infériorisant par définition les femmes, elle sort du champ de la morale d’avant-garde qui s'applique à des égaux / égales. Réciproquement un auteur convaincu de misogynie ne peut pas être un auteur avant-gardiste. Il peut cependant y avoir des œuvres d’avant-garde utilisant comme matière première des thèmes misogynes. Pour autant, si ce recours éveille un soupçon à propos des intentions de son créateur, c’est que ce dernier a échoué, c'est qu'il a permis au grand public d'accéder à son œuvre alors qu'il prétend en être totalement incompris. S’il est de bonne foi, il évitera de recourir désormais à ce matériau. Si par contre on le voit chercher à se défendre, à convaincre le public, il faut en conclure qu’il couvre du voile de l’avant-garde une œuvre en réalité engagée.
L'auteurice commercial.e sépare vie privée et vie professionnelle : quand bien même l’écriture occupe tout son temps, iel peut passer à une activité plus lucrative si l’occasion s'en présente. Iel sait anticiper, suivre et orienter les goûts du grand public, de la clientèle moyenne (et donc nombreuse) des grandes maisons d’édition, ce qui constitue sa principale compétence, justifie sa rémunération et lui confère le statut de « signature » attachée à sa « maison ». L'identité de l’auteurice en dehors de son statut n'importe guère. Par contre, en tant qu'auteurice, iel est soumis.e aux lois économiques du marché littéraire, notamment aux exigences liées à sa cotation : capacité à générer du chiffre d’affaire, mais aussi à évoluer selon une trajectoire vendeuse (du « one shot » transgressif à la carrière longue s’assagissant avec le temps). La littérature commerciale est misogyne lorsque la misogynie est au goût du jour, philogyne dans le cas contraire. Elle ne fait que renforcer les tendances « gustatives » du public, dont le lien avec ses mœurs effectives, quoique indirect, n'est pas nul, parce que, à défaut de provoquer des passages à l’acte, elle les favorise en banalisant les discours qui les étayent. Elle est cependant à couvert des attaques grâce à la doctrine libérale post-smithienne de l’autonomie du champ économique : centrée sur les relations d’offre et de demande, elle en suit le cours, et rien ne peut ni ne doit chercher à l’en détourner ; elle relève du seul droit de la concurrence, certainement pas du code civil. Les auteurices n’en sont d’ailleurs que les agents : si l’un.e refuse de répondre à telle demande qui lea ferait sortir de sa trajectoire vendeuse, un.e autre y répondra parce que cela lea renforce dans sa trajectoire vendeuse. Contre la misogynie portée par la littérature commerciale, il n’y a donc pas à dire mais à faire, par les moyens traditionnels d’orientation de la production par les consommateurices : boycott, désaveu, etc.
L’auteurice engagé.e est pleinement responsable de son œuvre et de son impact sur le public. Les œuvres engagées sont faites pour cultiver leur lectorat, et la forme romanesque est appréciée pour sa capacité à mêler l’agréable à l’utile ou les sentiments à la prise de conscience. Leur but est de faire évoluer « l’hexis » d’un public aussi large que possible, l’ensemble des dispositions morales de celleux qui ne sont pas satisfait.e.s de leur existence. Or en matière de morale, l’autorité est reine (la meilleure justification d’un comportement est le renvoi à une autorité morale, la Bible, les Évangiles, Socrate, Marx…). L’un des buts des auteurices engagé.e.s est de se constituer en autorité morale ou de convoquer des autorités morales amies tout en rabaissant les autorités morales ennemies. L’usage de thèmes misogynes ne peut en aucune manière être innocent dans une œuvre engagée : leur présence, sans celle de thèmes philogynes dominant au final, signe la misogynie de l’auteur et son effort pour convertir son public à sa haine des femmes en le familiarisant avec un argumentaire ad hoc. Plus solides sont les autorités convoquées, plus grande est la responsabilité de l’auteur dans cette entreprise de conversion. Cela peut paraître évident, mais nous verrons que Jean de Meun soutient le contraire.
Ces trois points de vue, très éloignés les uns des autres, sont au fondement de nos catégories de jugement des œuvres littéraires, mais comme nous ignorons leur incompatibilité pourtant évidente et que nous aimons à penser qu’il n’y a qu’une doctrine légitime sur la nature et les fins de la littérature, les débats auxquels nous pouvons prendre part sont condamnés à tourner en rond.
Il s'agit de déterminer d'abord si tous les points de vue se valent (il deviendrait dès lors impossible de juger les productions littéraires) ou si, pour une œuvre donnée, il est possible de déterminer des critères objectifs permettant de faire prévaloir un point de vue sur les autres et donc de produire un jugement définitif à son propos.
La littérature engagée prête particulièrement le flanc à la condamnation morale, puisqu'elle y invite elle-même, en responsabilisant et l’œuvre et le public et l’auteurice et la maison d’édition. Dès lors que l’on condamne la misogynie au sein de la société, il est légitime de condamner celle d’une œuvre engagée sur cet aspect et, de là, celle de son lectorat, de son auteur et de sa maison d’édition. Dans les faits, il est rare que les thèmes misogynes, quand ils sont présents, ne coexistent pas avec des thèmes philogynes : le plus souvent dans ce cas, les femmes visées par la misogynie diffèrent de celles objets de philogynie. Il n’est pas rare en outre que l’engagement de l’œuvre porte prioritairement sur un autre thème moral que celui de la valeur des femmes, la difficulté étant alors d'identifier où finit l’engagement et où commencent les discours tout faits auxquels l’auteur et son lectorat peuvent ne pas adhérer. Disposer de traits sûrs permettant d’interpréter correctement le message effectif sur les femmes est donc indispensable.
Évaluons à présent la pertinence de cette méthode, en lui soumettant le cas du Roman de la rose écrit par Guillaume de Lorris et continué par Jean de Meun à trente ans d’intervalle (vers 1265). Du débat passionné qu'il a suscité au début du XVe siècle, je veux retenir le jugement de Christine de Pizan (à savoir : le Roman de la rose est une œuvre engagée condamnable pour sa misogynie, imputable à son seul second auteur, et qui vise à en répandre le venin dans la société cultivée) mais pour le traduire dans nos catégories actuelles de jugement des œuvres littéraires et constater s’il y est toujours recevable.
Guillaume de Lorris a conçu le Roman de la rose comme un roman courtois de style allégorique. Le thème central en est évidemment l’amour, dont le style allégorique permet de ne pas s'éloigner. Dans les romans de Chrétien de Troyes par exemple, le registre guerrier, quoique indirectement rattaché à l’amour, est traité comme un thème autonome avec ses incontournables, tandis que dans les romans courtois de style allégorique, les batailles opposent des personnages symboliques représentant, à la manière des contes, les forces adjuvantes et opposantes à la relation amoureuse. De ce fait, les armes, les tactiques, les manières d’aborder le combat, prennent un double sens et traduisent la soumission complète du registre guerrier au registre amoureux. L'auteur a choisi de relater la quête d’un bouton de rose, symbole des promesses amoureuses, par le personnage principal, qui est aussi le narrateur. Un dispositif complexe en ménage autant qu'il en empêche l’accès : il se trouve au milieu d’un taillis de rosiers, entouré d’une épaisse haie, dans une partie peu accessible d’un jardin paradisiaque, clos d'une solide muraille quadrangulaire ne possédant qu'une seule entrée, appartenant au seigneur Déduit (« divertissement »), habité d'hôtes allégoriques et hanté par le dieu Amour. L’originalité de Guillaume de Lorris est d’avoir enchâssé les récits de façon relativement élaborée : un narrateur raconte à la première personne qu’il a fait un rêve dans sa jeunesse, rêve de type prémonitoire qui s’est réalisé par la suite ; un second narrateur intervient ensuite, le même que le premier, mais pris dans son rêve ; son récit est organisé autour d'une série de dialogues (qui sont le plus souvent extrêmement déséquilibrés, l'un.e des dialogueur.e.s monopolisant la parole pour traiter de quelque matière particulière) de divers personnages allégoriques qui introduisent de nouveaux.elles narrateurices : le « je » narratologique tend ainsi à se diffracter. Il ne s’agit pas là simplement d’un tour « baroque » marquant la fin de la grande vogue du roman courtois : Guillaume de Lorris se situe déjà dans la sphère du pré-humanisme et mêle la Clé des songes d’Artemidore au Livre d’Ezéchiel de la Bible pour conférer une nouvelle dimension à la « psychomachie » (la lutte des adjuvants et des opposants à la quête amoureuse) des romans courtois allégoriques, moins attachée au merveilleux des contes, plus ancrée dans la culture des clercs. Le rêve s'ouvre par une promenade du narrateur au bord d’une rivière au sein d'une belle campagne qui lui est inconnue. Il découvre alors le jardin, où il parvient à pénétrer après en avoir prié la portière, et s’y enfonce, discrètement suivi par Amour. Il y aperçoit une belle fontaine lugubre au fond de laquelle un cristal lui donne à voir le bouton de rose qui fera l’objet de sa quête. Perdu dans sa contemplation, le voilà transpercé de trois flèches qu’Amour lui a décochées en plein cœur. S’ensuit son serment d’allégeance au dieu, après que celui-ci lui a exposé les inévitables tribulations de l’amoureux, mais promis la possession de l’objet aimé, moyennant le respect de certaines règles. Sa quête commence : devant la haie qui défend le rosier, il rencontre son gardien, nommé Danger, ainsi que Bel Accueil qui l’invite à s’approcher du bouton de rose. Rapidement les choses se dégradent : après avoir pris le conseil de Raison (qu’il ne suit pas) puis d’Ami (qu’il suit, mais pas assez prudemment), il est éconduit et un château se dresse maintenant à la place de la haie, avec une tour en son centre, où se morfond Bel Accueil, coupable d'avoir exposé le bouton de rose à l’avidité du narrateur. Rencontrant sa première et majeure déconvenue, ce dernier s'afflige et… le roman se termine là, du fait du décès de son auteur.
Jean de Meun reprend la rédaction du Roman de la rose et lui ajoute 18.000 vers, soit 4,5 fois plus que les 4.000 vers de Guillaume. Dans cette vaste amplification littéraire, il multiplie les dialogues et reprend à son compte le principe narratif de l'enchâssement en le complexifiant encore : le monologue d’un personnage allégorique peut ainsi ouvrir sur les monologues de divers personnages discourant, narrant et donnant la parole à de nouveaux personnages qui vont faire la même chose. Dans l’ensemble pourtant la trame reste relativement simple : Raison reparaît et donne sa définition de l’amour : le narrateur refuse de l’écouter car elle lui demande de rompre son serment vassalique ; il retourne voir Ami qui lui prodigue de nouveaux conseils et lui présente différentes stratégies : le narrateur veut aller au plus court mais Richesse lui barre le passage ; Amour décide de venir à son secours et, avec l’aide des adjuvants, de prendre d’assaut le château tenu par Malebouche, Danger, Peur et Honte pour le compte de Jalousie ; parmi les adjuvants se trouve Faux Semblant, allié redoutable et redouté, qui tue Malebouche, son ennemi naturel ; la Vieille, qui garde Bel Accueil (personnage de genre masculin qui représente un aspect de la personnalité des jeunes filles), lea prépare alors à sa libération, en lui prodiguant des conseils à l’égard du narrateur ; le combat reste cependant indécis et Amour en appelle à Vénus qui décide de recourir au prêche du clerc de Nature, nommé Genius, qui excommunie les opposants ; tout s’accélère et le narrateur retrouve Bel Accueil qui lui offre de cueillir la rose : c’est alors qu'il se réveille. Les commentateurs ne se sont pas risqués à conjecturer sur ce qui faisait du rêve un rêve prémonitoire. Pourtant l'explication en est fournie par Jean de Meun lui-même, aux vers 10530-10682, lorsque le dieu Amour exhorte ses vassaux au combat, en leur assurant l'immortalité de leurs exploits chez la postérité grâce aux deux auteurs du roman. Ce qu'annonce le rêve est tout simplement l'écriture du livre : il devient, sous la plume du continuateur, rêve programmatique et non plus prophétique. Jean est donc parvenu, avec beaucoup d'élégance, à donner une suite au Roman de la rose. Avec lui, néanmoins, le ton change : il ne cesse, dans ses digressions, de prendre ses distances avec le roman courtois. Approfondissant le pré-humaniste de Guillaume, il multiplie les références littéraires de façon à cerner de manière encyclopédique (littéralement : en en faisant le tour) la passion amoureuse. Ovide (l'Art d’aimer, les Amours et les Métamorphoses), Juvénal et Horace (leurs Satires) sont convoqués comme autorités en la matière. La fonction initiale d’instruction des « parfaits amants » évolue nettement vers une fonction d’instruction du public de la littérature courtoise sur la nature de l’amour et des protagonistes de la relation amoureuse. Le roman prend le tour d’un traité sur l’amour comme sel de la reproduction biologique et sur les perversions où l'on tombe à s’écarter de cette courte définition. Mais au milieu se trouve un discours hors sujet, celui de Faux Semblant, à qui Amour a demandé de révéler sa véritable identité : Faux Semblant, dont l’activité consiste à prêcher la vertu pour pratiquer le vice, ne cesse de se déguiser, et son déguisement de prédilection est celui des ordres mendiants (Franciscains et Dominicains). L'auteur, qui écrit vers la fin du règne de Saint Louis, fait clairement référence ici à la querelle des ordres mendiants et du clergé séculier au sein de l’université de Paris (de 1250 à 1259). Les frères mineurs et les cordeliers en sont sortis vainqueurs, le roi et le pape leur ayant renouvelé leur appui. Pour un clerc issu de l'université, prendre parti contre les ordres mendiants après 1259 est dangereux (cf. Rutebeuf à la même époque, privé de commande), sans doute plus que proposer une vision "naturaliste" de l'amour.
Le Roman de la rose fait partie des romans comprenant à la fois des sections misogynes et philogynes. Ses six sections misogynes sont toutes de la plume de Jean de Meun :
(1) La première s'insère dans le long discours d’Ami au narrateur. Après avoir donné ses conseils sur la manière de conquérir sa dame (sur le modèle du premier livre de l’Art d’aimer d’Ovide), Ami s’apprête à le conseiller sur la manière de la retenir, une fois conquise (sur le modèle du second livre de l’Art d’aimer). Il fait alors une courte digression, en référence à Juvénal (vv 8261-8340) et en contrepoint de sa description de l’âge d’or, sur la vénalité des femmes qui fait que seul l’homme riche peut espérer garder son amie. Aristote aurait dit « seul l’homme vertueux », car il pensait que les femmes étaient attirées par les hommes de bien, et c’est bien ainsi que le concevait l’amour courtois. Recourant aux effets de rabaissement et de grossissement de la satire, Jean de Meun en arrive à prendre pour modèle explicatif du comportement des femmes en général celui de la prostituée en particulier. Bien sûr l’auteur nuance son jugement : « toute règle a ses exceptions », où ses lectrices auront soin de se reconnaître. Pour ces femmes hors du commun, la possession des sciences remplace celle des richesses et permet seule de prolonger leur amour. Aristote ne s’applique donc plus qu’aux exceptions, auxquelles l’amour courtois est également réservé.
(2) Toujours dans le discours d’Ami, la seconde section misogyne consiste en la tirade rapportée du mari jaloux de la comédie latine (vv 8459-9386 : notez l'ampleur !), adressée à son épouse, parsemée d’insultes et de références littéraires. Elle se clôt par un récit sadien de coups et blessures, que l’auteur met sur le compte d'un souci de réalisme : il s'agit du portrait d'un vilain, nécessairement brutal. Le racisme social vient ici au secours de la misogynie…
(3) La troisième section commence avec le discours que la Vieille tient à Bel Accueil sur la façon dont une femme doit agir en amour (le modèle est cette fois le troisième livre de l’Art d’aimer d’Ovide). L’enseignement féminin sur les choses amoureuses, livré aux vv 13041-13130 et 13667-13814, est réduit à l’art de tromper les hommes et de leur soutirer des cadeaux, conformément à l’accusation de vénalité de la première section.
(4) Vient ensuite le discours que Genius tient à Nature. Genius, prêtre de Nature, en est aussi le confesseur et la sermonne aux vv 16327-16710. De façon plutôt incongrue, il se lance dans une tirade sur la conduite qu’un homme doit tenir envers sa femme : ne l'impliquer que dans ses entreprises mineures, se méfier d'elle systématiquement et garder secrètes les affaires d'importance.
(5) Allant plus loin, Jean de Meun fait avouer à Nature elle-même, lors de sa confession à Genius, aux vv 18134-18156, la haute aptitude des femmes au mensonge. En apparence, il y a équilibre entre le penchant des hommes au secret et celui des femmes au mensonge. En réalité, chaque membre de l’alternative n’a qu’une cause : le vice des femmes.
(6) La dernière poussée de misogynie intervient dans le discours de Genius aux protagonistes de la psychomachie (vv 20041-20086). Il y condamne l’émasculation de Saturne par Jupiter, le pire crime qui puisse être commis contre un homme à ses yeux, puisqu'il le rend pareil aux femmes qu'il réduit à une somme de stéréotypes misogynes : « En effet ceux qui n'ont plus de couilles, nous en sommes sûrs, sont couards, pervers et hargneux, parce qu'ils participent des mœurs de la gente féminine. »
Le Roman de la rose contient par ailleurs quatre sections philogynes. Les deux premières sont de Guillaume de Lorris, les deux suivantes de Jean de Meun :
(1) La première s’inscrit dans le cadre courtois des commandements d’Amour au parfait amant, aux vv 2075-2762 : il y est question du service d’amour et de l’attitude vertueuse de l’amant vis-à-vis de sa dame. Guillaume se place dans la perspective aristotélicienne de l’attirance des femmes pour la vertu masculine et met en avant leur rôle, par l’intermédiaire de l’amour, dans l’initiation des hommes à la vie chevaleresque, éloignée de toute « vilenie ».
(2) La seconde se situe à la fin du texte de Guillaume, avec la description du château et de ses gardiens. Il est question en particulier de Malebouche (vv 3900-3906), fléau de la réputation des femmes, source intarissable de tout propos misogyne, que le parfait amant doit absolument éviter d’alimenter et qui justifie le secret qui doit couvrir l’aventure amoureuse courtoise.
(3) Jean de Meun fournit lui aussi quelques éléments de philogynie, y compris dans le discours ovidien d’Ami. Aux vv 9447-9486, celui-ci relève un renversement des rapports de domination entre femme et homme dans le mariage (auparavant, l’amour courtois l'emporte et place la dame au-dessus de l’amant, après prime l’administration domestique où l’homme s'impose en maître), ce qui conduit nécessairement à une grande déconvenue pour celles qui n'ont régné pendant la courte période de la courtoisie que pour connaître la situation inverse pendant la longue période du mariage. Jean se montre ainsi capable d’analyses sociologiques pertinentes, dont il tire la conséquence (vv 9711-9728) : un mari qui veut s’écarter de la vilenie du jaloux, doit laisser son épouse libre malgré le renversement opéré par le mariage, cette liberté concédée en étant la juste compensation. Cependant Jean retombe bientôt dans la misogynie en glissant quelques conseils pour ne pas s’aliéner son épouse que l’on vient de battre (par exemple, en couchant avec elle !), ce qui annule la portée de ce passage philogyne...
(4) Reprenant les Amours d’Ovide, l'auteur place dans la bouche de la Vieille, aux vv 14461-14541, une mise en garde, adressée aux femmes, contre la prédation des « mauvais garçons » et la prostitution amoureuse qui s’ensuit (il ne s’agit pas ici de prostitution professionnelle, mais du cercle vicieux qui pousse une femme à donner toujours plus d’argent à son amant malhonnête, qu'elle se procure en séduisant et escroquant toujours plus d’honnêtes amants, cercle d’autant plus vicieux que le système ne tient que par la maltraitance calculée de l’amoureuse par son soi-disant amant).
La première question qui se pose est de savoir si le Roman de la rose est un roman d’avant-garde, commercial ou engagé ? Reconnaissons d’abord qu’au XIIIe siècle les trois aspects étaient encore relativement confondus et qu’il est difficile de distinguer clairement une intention littéraire « pure », un souhait d’enrichissement par les lettres, et une volonté de convertir son public à certaines valeurs. Chez Guillaume de Lorris et surtout chez Jean de Meun, la dimension littéraire pure est bien présente dans la référence aux auteurs de l’Antiquité, caractéristique du pré-humanisme. Ceux-ci ne sont cependant mobilisables que pour autant qu’ils servent à l’édification des Chrétien.ne.s, notamment en montrant que des poètes et des philosophes antérieurs au Christ avaient pressenti la vérité évangélique. Un art de la référence est ainsi attaché à la citation, toujours dirigé par le souhait d’instruire. L'intention d’instruction qui préside clairement au roman courtois de style allégorique, renforcée par le pré-humanisme qui s’y greffe (selon la formule latine : « profit et délectation »), suffit à faire du Roman de la rose un roman engagé, paradoxalement du fait même de sa tendance à l’avant-gardisme. Cette conclusion est confirmée par deux autres indices : un aveu et un déni.
Jean de Meun reconnaît, dans ses excuses aux femmes, que sa continuation du Roman de la rose a pour fin d’instruire son public, en mêlant des ornements antiques à la sèche doctrine, dans le cadre littéraire divertissant du roman.
Jean de Meun dénie, dans ses excuses au Pape (qui suivent ses excuses aux femmes), toute dimension politique à ses propos. Par « politique », il faut comprendre à l’époque : les luttes de partis et les attaques personnelles qui s’y rattachent. Il est amené à distinguer engagement moral et politique par la métaphore de l’archer (aux vv 15247-15306) : l’archer tire là où se trouve le vice (en l’occurrence le vice de faux-semblance) sans chercher à savoir s’il existe ou non une personne vicieuse ; si la flèche atteint quelqu’un, c’est bien malgré l’archer. Ainsi la reconnaissance de son engagement moral coïncide chez Jean de Meun avec le déni de tout engagement politique, ce dernier étant cependant bien présent dans une œuvre qui n’hésite pas à prendre la défense de l’universitaire parisien Guillaume de Saint-Amour contre Saint-Louis et les ordres mendiants alors tout-puissants.
Instruire, moraliser, condamner, telles sont les intentions assumées par Jean de Meun et qui permettent de confirmer le caractère engagé du Roman de la rose.
La deuxième question qui se pose est celle de la teneur du message relatif aux femmes : les propos misogynes et philogynes s’équilibrent-ils ? Conduisent-ils à une « suspension du jugement » du fait de la présence d’arguments contradictoires ? Cette question se double de celle du périmètre de l’œuvre engagée, qui peut être plus restreint que celui de l’œuvre dans son ensemble : le discours sur les femmes n’est-il pas un écran de fumée déployé pour cacher le véritable engagement de l’auteur pour l’Église séculière contre les ordres mendiants ? La continuation du Roman de la rose n’est-elle pas une forme de « trolling » du roman courtois dont le scandale qui doit inévitablement suivre a pour but de couvrir celui d’un court pamphlet politique beaucoup plus risqué et inavouable ? Cette hypothèse pourrait être soutenue si Jean de Meun ne faisait pas coup sur coup ses excuses aux femmes et au Pape : la misogynie et la condamnation des ordres mendiants sont bien les deux thèmes principaux de la continuation, et c’est le déni par l’auteur de leur portée qui nous fournit le meilleur indice de son double engagement moralisateur. En ce qui concerne la teneur du message relatif aux femmes, la pièce maîtresse du discours d’excuses qui leur est adressé des vv 15199-15246, est fort éclairante. Le voici dans son adaptation « moderne » par Pierre Marteau en 1870 :
Toutes aussi, vaillantes femmes, / Daignez, damoiselles et dames, / Amoureuses ou sans amis, / Si mots y trouvés déjà mis / Qui vous semblent mordants, infâmes, / Ou pis contre les mœurs des femmes, / Daignez ne pas trop m'en blâmer / Ni mon livre trop diffamer / Qui tout est fait pour tous instruire ; / Car oncques n'eus vouloir de dire, / Et rien n'y dis par passion, / Colère, ivresse ou déraison, / Ni par haine, ni par envie, / Contre femme qui soit en vie. / Nul ne doit médire de vous, / S'il n'a cœur le pire de tous. / Si tels mots sont en mon poème, / C'est pour que chacun de soi-même / Puisse la connaissance avoir, / Car il fait bon de tout savoir.
D'autre part, dames honorables, / Si vous croyez que ce soit fables, / Pour un menteur ne me tenez, / Mais aux auteurs vous en prenez / Par qui furent jadis écrites / Les paroles que j'en ai dites. / Et quand d'autres je vous dirai, / Jamais non plus ne mentirai, / Si tous ces sages ne mentirent / Quand les anciens livres ils firent ; / À moi s'accordent ces auteurs / Quand des femmes peignent les mœurs. / Ils n'étaient fous ni certes ivres / Quand ils les mirent dans leurs livres ; / Ils les connaissaient mieux que nous, / Leurs mœurs ayant éprouvé tous, / Puisque telles ils les trouvèrent / De tout temps, quand les éprouvèrent. / Aussi devez-vous m'acquitter, / Car je ne fais que réciter, / Sauf parfois, pour l'art, quand j'ajoute / Un mot innocent, somme toute, / Comme chacun poète fait / Quand il veut traiter un sujet / Et quelque peu du sien y mettre. / Ainsi le témoigne la lettre, / Profit et délectation, / C'est toute leur intention.
La défense de Jean de Meun relève du registre comique : il était d’usage que l’auteur comique, grec ou latin, interpelât et malmenât ses spectateurices, lors des concours de comédie, pour se les concilier, en les faisant rire, et les amener à voter pour lui. Le but est ici différent : les femmes ne sont pas malmenées pour provoquer leur rire et leur adhésion, mais pour les réduire au silence et les exclure du champ littéraire (qui comprend autant la production que la réception des œuvres). Une lectrice peut en effet difficilement adhérer à la description que Jean fait des femmes, or celle-ci comme tout ce qu'il dit est parfaitement conforme aux canons définissant, à l'époque, le chef-d'œuvre, donc jugeant négativement le Roman de la rose, cette lectrice montre seulement son incapacité à émettre un jugement objectif sur la littérature. Derrière le recours au registre comique, le message est par ailleurs très sérieux : la courtoisie est une belle fantaisie qui tend à faire oublier aux femmes leur nature déficiente et ne peut manquer de provoquer leur déception une fois revenues de ce monde d'illusions. Il ne s’agit pas là d’argumenter : « je n’y peux rien si c’est vrai ! » Quel que soit donc le nombre de passages philogynes écrits par Jean de Meun, tous peuvent être relus à la lumière de ses excuses comme des variantes de sa misogynie : les rares femmes dont il fait l'éloge sont des êtres contre-nature, des créatures qui n'existent pas. La misogynie du Roman de la rose dans sa continuation est condamnable à double titre :
elle n’est pas cantonnée au seul point de vue de l’auteur (c’est la vérité enseignée depuis des siècles par les autorités littéraires),
elle n’est par cantonnée à une diffusion uniquement masculine : Jean de Meun s’adresse à son public féminin pour s’en moquer (« vous, maîtresses du mensonge, la vérité n’est pas pour vous plaire ») et pour l'exclure de la partie la plus légitime, érudite, du champ littéraire (l'avant-garde).
Les critères retenus pour condamner le Roman de la rose de Jean de Meun du fait de sa misogynie sont d’une part la gratuité de ce positionnement (rappelons qu'il se greffe sur un roman courtois philogyne), d’autre part les fausses excuses aux lectrices et leur exclusion de la « vraie » littérature.
Cette analyse du Roman de la rose paraît bien courte : il y aurait tant de choses à dire sur les multiples ressorts de la misogynie dans cette œuvre. Mon but cependant n’était pas de débattre, mais de trancher sur sa culpabilité ou son innocence à l’égard des femmes, tout en évitant le plus possible de citer des propos machistes.