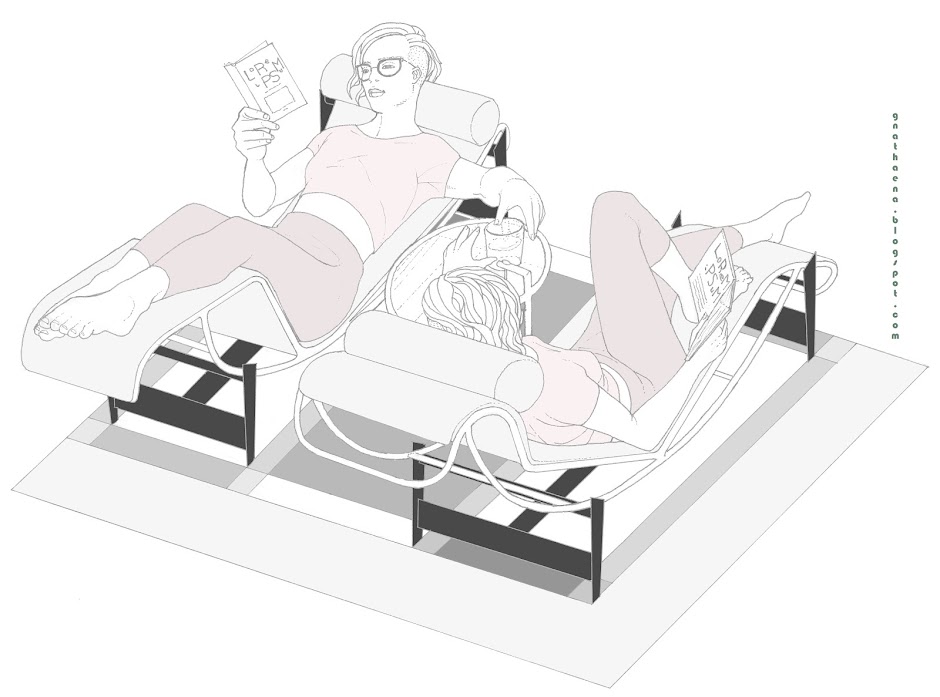Burkert Walter, Homo necans, Rites sacrificiels et mythes de la Grèce ancienne, collection Vérité des mythes, Les Belles Lettres, 2005.
Pinol Jean-Luc (sous la direction de), Histoire de l'Europe urbaine, I De l'Antiquité au XVIIIe siècle, Le Seuil, 2003.
Anonyme, Journal d'un bourgeois de Paris (1405-1449), collection Le monde en 10I18, Union générale d'éditions, 1963.
L'alimentation carnée n'est pas l'apanage du patriciat urbain : la viande (bovine essentiellement) est d'abord consommée par les travailleurs de force. Encore faut-il compter avec d'importantes variations régionales : ainsi, à Carpentras, la consommation moyenne par habitant est de 26 kilogrammes, ce qui est quatre fois inférieur à celle de certaines villes allemandes (soit plus de 100 kilogrammes, pour mémoire nous consommons en France en moyenne 85 kilogrammes de viande par an) ! Malgré tout, le Moyen-Âge constitue bien l'âge d'or de l'« Europe des carnivores » pour reprendre la célèbre formule de Fernand Braudel.
Le petit élevage est largement pratiqué par les urbain.e.s, dans les basses-cours pour les volailles, voire dans les maisons : les autorités rémoises, à la fin du XIVe siècle, doivent se résoudre à interdire l'engraissement de plus de quatre porcs par maison. Il faut imaginer les cités médiévales cernées de pâturages (les moutons paissent sur les rebords des fossés), traversées par les troupeaux que l'on mène à l'abattoir et encombrées d'animaux de toutes sortes (cochons, chèvres...). Si le gros élevage, principal pourvoyeur des besoins en viande des villes, est le plus souvent local, pratiqué dans les campagnes environnantes, il existe également des filières d'élevage internationales qui permettent l'importation de bétail nourri à des centaines, voire des milliers de kilomètres (à cette époque, les longues distances sont réservées aux « marchandises » de grande valeur ou qui se transportent elles-mêmes). On sait par exemple que des cow boys amenaient des troupeaux de bœufs hongrois et polonais respectivement à Nuremberg et à Cologne, où ils étaient abattus.
Les bouchers, très nombreux en ville, sont les acteurs majeurs du marché de la viande. À Bologne, les estimi (registres fiscaux) de 1294 en dénombrent 751 ! Dans la petite bourgade de Decize en Nivernais, ils sont une dizaine. Les riches bouchers, car certains sont misérables, figurent parmi les contribuables les plus imposés. Il s'agit de puissants entrepreneurs en boucherie, développant dans les campagnes environnantes un marché bovin spéculatif qui déstabilise en partie l'élevage paysan. Les bouchers de Lübeck, dans la seconde moitié du XIVe siècle, ont massivement investi dans l'achat de pâturages au-delà des remparts. Souvent, le monopole de l'approvisionnement de la viande accompagne celui du cuir : dans la ville d'Exeter, à la fin du XIVe siècle, un petit groupe de bouchers contrôle ainsi 95% de la vente de peaux d'animaux.
L'alimentation carnée, dans des proportions bien supérieures à celle végétale, entraîne des problèmes sanitaires que les autorités municipales s'attachent à résoudre, en développant une réglementation normative sur la sécurité alimentaire. Ce sont les épidémies de lèpre porcine (ou ladrerie) et la crainte de sa transmission à l'être humain (fondée sur une connaissance inexacte de cette parasitose) qui justifient le contrôle serré de la commercialisation de la viande. Cette crainte appartient en fait à un vaste ensemble de croyances anthropologique traduisant l'angoisse croissante d'une contamination par des aliments impurs.
Il convient d'abandonner l'idée d'une cité médiévale livrée aux puanteurs des cloaques et parcourue de cours d'eau charriant immondices et déchets issus de l'artisanat pré-industriel. Les recherches récentes ont en effet mis en valeur la précocité du souci « environnemental » dans les villes médiévales, dont la législation destinée à garantir la pureté des eaux et de l'air se fonde sur une culture médicale assez développée. Les traités hygiénistes d'Aldebrandin de Sienne sur la prévention de l'épidémie sont largement diffusés parmi les classes dirigeantes urbaines. Cette conscience sanitaire des élites a des conséquences directes sur l'aménagement des espaces. Dès le XIIIe siècle, la réglementation des métiers a contribué à limiter la pollution hydrique et à favoriser l'auto-épuration des rivières et des canaux, en distribuant rationnellement les activités artisanales polluantes au fil de l'eau et en dehors des villes. À Amiens, Auxerre, Provins ou Beauvais, les tanneurs sont enjoints de s'installer en aval de la rivière, les teinturiers sur un autre bras, les pelletiers et métiers du cuir en aval des teinturiers, profitant ainsi des restes d'alun dissous dans le jus de teinture, les « massacreries » ou abattoirs en aval des tanneurs (le tanin réduit l'effet polluant des déchets de boucherie).
À partir du XIIe siècle, les villes sont le lieu d'une réhabilitation idéologique du travail, qui recourt à la conception aristotélicienne du « bien commun » : les travailleurs doivent être célébrés, parce qu'ils sont nécessaires aux besoins humains. La compétence devient une valeur sociale, tandis que s'invente la dignité du salariat.
Tout travail, cependant, ne mérite pas célébrations : il faut rappeler ici la distinction entre (1) labor, activité rémunérée ou non, dont l'exercice est exclusivement dicté par la contrainte, imposé à l'enfant par l'adulte, à la femme par l'homme, au salarié par le maître, (2) ars (métier), inculqué par l'apprentissage, objet de reconnaissance sociale et moyen de négociations salariales, exercé par les maîtres et leurs apprentis, et (3) scientia, profession librement choisie, fondée sur un savoir acquis, située à l'échelon le plus haut des valeurs. L'ars et la scientia sont l'apanage de droit des hommes (dans les faits, les veuves de maîtres peuvent temporairement bénéficier de la maîtrise de leur défunt mari, le temps qu'elles se remarient avec l'homme qui sera le mieux placé pour lui succéder, ou bien que le fils puisse reprendre l'affaire, au terme de son voyage d'apprentissage, lui valant le titre de maître).
Tous les principaux métiers artisanaux, également utiles, ne sont pas également reconnus. Ils sont hiérarchisés selon un double principe :
Externe : corporations marchandes et artisanales sont nettement distinguées ; à l'intérieur des corporations artisanales, les distinctions continuent : selon les villes, ce sont les forgerons, les orfèvres, les pelletiers ou les maîtres de la soie qui dominent. Le rituel urbain des processions ou des fêtes civiques donne à voir cette hiérarchie, qui commande le partage du pouvoir et où les bouchers occupent le dernier degré.
Interne : chaque métier rassemble des personnes aux statuts fort variés et inégaux. Au sommet se trouve le marchand-fabricant, donneur d'ordres, qui dispose de la matière première et contrôle les circuits de distribution ; le maître est en position médiane : artisan-employeur, il possède son outillage et son ouvroir (grande salle principale de sa maison, servant d'atelier et donnant sur la rue), forme ses apprentis et emploie des valets ; les valets sont en contrebas de la hiérarchie, mais sont au moins protégés par la réglementation des métiers. Au sein d'un même métier, l'écart entre le sommet et la base de la hiérarchie sociale est souvent très important ; il en résulte une grande diversité de situations dans la classe médiane des maîtres et des apprentis. C'est particulièrement le cas chez les bouchers médiévaux du fait de leur grand nombre, ce qui les rend sensibles à des revendications touchant toutes les strates de la population citadine.
L'écart entre, d'un côté, la richesse économique et l'utilité sociale de cette corporation et, d'un autre côté, le mépris social dont elle est victime, du fait notamment du tabou qui pèse sur le sang, fait donc des bouchers des candidats privilégiés à la révolte urbaine : « révolution » cabochienne à Paris (1413), troubles politiques animés par les Knochenhauer de Lübeck en 1380, luttes de pouvoir à Bologne, au XIIIe siècle, qui se soldent par la mise en place de la seigneurie des Bentivoglio, famille qui doit sa fortune à la boucherie.
Jean Thiellay, qui présente le Journal d'un Bourgeois..., évoquant les débuts de la « révolution » cabochienne :
Aux revendications modérées des bourgeois et de l'Université succède bientôt l'agitation de la rue ; Paris est livré aux désordres des éléments révolutionnaires les plus violents, groupés autour de la corporation des bouchers, plus bourguignonne que le duc de Bourgogne lui-même [il s'agit de Jean sans Peur], et des métiers subalternes qui gravitent autour d'elle : écorcheurs, pelletiers, tripiers et tanneurs trouvent en Simon Caboche, écorcheur de vaches à la grande boucherie Saint-Jacques, le meneur de ces journées ; ce sont les débuts de la « dictature des abattoirs ».
Ici, comme très souvent dans les mouvements populaires médiévaux, la fiscalité est le ressort central : la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons qui se disputent la régence du roi Charles VI, alors affaibli par des crises de démence, a un coût financier considérable, que les princes et les grands du royaume, campés sur leurs privilèges, refusent d'assumer, et qui est à la charge des bourgeois parisiens, en particulier les riches bouchers, las de devoir payer sans que leur utilité sociale soit jamais reconnue et qu'ils puissent espérer accéder un jour aux fonctions municipales. L'insurrection commence par l'assaut donné à plusieurs sites, où se sont réfugiés les gens du parti armagnac, très impopulaires en raison de leurs nombreux pillages et exactions. Laissons la parole au Bourgeois de Paris :
« Peu après, la ville fut armée et les Parisiens vinrent assiéger le château Saint-Antoine [La Bastille] et ils jurèrent que ceux qui s'y trouvaient n'en sortiraient que prisonniers ; quand les assiégés virent une telle foule et dans une si grande effervescence – il y avait bien vingt-quatre mille personnes – vers le soir, ils se rendirent aux ducs de Guyenne [fils aîné de Charles VI] et de Bourgogne, qui répondirent de leurs personnes, car sans cela les Parisiens les auraient bien massacrés tous. (...) La semaine qui précéda l'Ascension, la ville fut de nouveau en état d'insurrection armée : les insurgés allèrent à l'hôtel Saint-Paul, où se trouvait le frère de la reine [le duc de Bavière], et là, bon gré, mal gré, ils le prirent, ils enfoncèrent la porte de la pièce où il se trouvait, et s'emparèrent également de treize ou quatorze dames et demoiselles, qui étaient au courant de ses projets, et tout ce beau monde fut emmené pêle-mêle au Louvre [qui dispose d'une prison]. »
À ces violences succède la « dictature des abattoirs » proprement dite. Des hommes du parti cabochien occupent les lieux symboliques du pouvoir urbain : tours et beffrois, marchés, portes. Dirigées en sous-main par l'habile duc de Bourgogne, adoré des « bons Parisiens », notamment parce que son armée paye (le plus souvent) sa subsistance, des négociations aboutissent à la promulgation de l'« ordonnance cabochienne », qui impose un contrôle sur la monarchie française, en particuliers en matière fiscale et monétaire. Le triomphe des Cabochiens est complet et se manifeste dans tout Paris :
« En ce mois de mai, la ville prit le chaperon blanc [symbole du ralliement au parti cabochien] : le roi en prit un aussi, et avec lui Berry, Guyenne et Bourgogne ; on en fit bien de trois à quatre mille, et, avant la fin du mois, il y en avait tant que partout on n'en voyait guère d'autres : même les hommes d'église et les marchands de légumes le prirent. »
Un passage du Journal d'un Bourgeois... montre bien les leviers actionnés pour mobiliser les masses populaires urbaines au Moyen-Âge. Il s'agit là de pousser le peuple à voter la reprise des armes pour empêcher la libération des Armagnacs toujours emprisonnés. Le choix qui est fait (laisser faire) signe paradoxalement la fin de la dictature cabochienne :
« ... aussitôt, ils [des meneurs cabochiens] se rendirent à l'hôtel de ville et y rassemblèrent la foule : ils lui montrèrent que la paix que l'on était en train de conclure n'était honorable ni pour le roi, ni pour le duc de Bourgogne, ni profitable pour la bonne ville de Paris et ses habitants, mais au contraire tout à l'honneur des Armagnacs, qui tant de fois avaient renié leur parole. Mais le menu peuple qui s'était assemblé en place de Grève, tout le monde s'étant armé comme il l'avait pu et désirant la paix, ne voulut pas les entendre ; tous commencèrent à crier, d'une seule et même voix : "La paix ! la paix !... et que celui qui ne la souhaite pas, se mette du côté gauche, et que celui qui la veut, se mette du côté droit." Alors tous gagnèrent le côté droit, car personne n'osa s'opposer à une telle foule. »
La révolte cabochienne n'aura pas de suites sociales ou politiques (l'ordonnance du même nom est cassée quelques mois plus tard) ; elle n'entraînera aucune amélioration du statut des bouchers parisiens, qui souffriront, au contraire, de la répression armagnaque et d'une série de sanctions destinées à les affaiblir (confiscation des armes, suppression des franchises...).
À partir du XIIIe siècle, la monétarisation de l'économie entraîne une différenciation sociale plus sévère. En ville, le cadre de régulation que constitue le métier ne résiste pas longtemps à cette pression économique. La limitation de l'accès à la maîtrise borne les espoirs des apprentis et casse la solidarité qui pouvait exister entre maîtres et ouvriers. Cela va s'accentuer, au XVe siècle, avec l'effacement de la frontière entre apprentissage et louage de bras, et la disparition du statut enviable d'apprenti. De là l'apparition des premières grèves, où les bouchers sont très présents aux côtés d'autres professions : grèves des bouchers à Paris en 1250, des tisserands et des foulons à Arras en 1253, des tisserands à Leicester et à York en 1248. En 1255, les travailleurs de Figeac se réunissent en une collegatio [syndicat]. Les troubles touchent l'Italie (Viterbe en 1281, Bologne en 1289) et l'Espagne (Barcelone en 1285). Les années 1280 préfigure la crise du féodalisme : c'est au cœur de cette crise et en réponse à elle, que débute ce que les historiens appellent aujourd'hui la genèse de l'État moderne.
La vie sociale des bouchers au Moyen-Âge souffre d'une double disgrâce : en dépit de leur réussite et de leur utilité, ils restent au dernier rang des métiers, et leur engagement dans les révoltes politiques de leur temps ne leur profite au final jamais. Quelle fatalité pesait donc sur les bouchers médiévaux ?
Évoquons d'abord l'infamie attachée à cette profession et l'impureté indélébile qui souille les bouchers en tant que personnes. Les bouchers et les bourreaux, mais restons-en aux bouchers. Il est question de sang, mais pourquoi, dès lors, le guerrier n'est-il pas lui aussi frappé d'infamie, même si l'on sait que le métier des armes impliquait pour celui qui l'exerçait une piété plus marquée ?
Le boucher médiéval descend en droite ligne du boucher de l'empire romain, dont la profession, centrée sur l'achat de bestiaux dans les marchés et leur préparation en amont de l'activité culinaire, était organisée en collèges (l'équivalent des corporations). En dehors des grandes métropoles comme Rome ou Constantinople, le métier perd sa raison d'être. Partout ailleurs, en effet, l'abattage et la découpe des animaux incombent au maître de maison (dominus) et au prêtre.
Reprenons les choses dans l'ordre. Il y a viande et viande : viande domestique et viande sauvage. Historiquement, la consommation de viande sauvage a précédé celle de viande domestique. La viande sauvage connaît elle aussi une distinction essentielle, entre viande sauvage banale et viande sauvage extraordinaire, celle-ci réservée aux hommes, celle-là partagée entre hommes et femmes. La tuerie des animaux domestiques, suivant ce modèle, a distingué les petits animaux, dont la possession n'entraîne ni prestige ni reconnaissance, et les animaux sources de valeur sociale et constitutifs de la richesse mobilière masculine (par excellence le bœuf chez les Grec.que.s, unité de mesure monétaire à l'époque d'Homère). Les mises à mort de la première catégorie n'imposent pas d'autre purification que la séparation du lieu de la mise à mort, du lieu (transitionnel) de la cuisine et du lieu de la consommation. Celles de la seconde catégorie, réservées aux hommes comme l'est la grande chasse par rapport à la petite chasse (mixte), imposent une purification beaucoup plus lourde, la médiation d'une divinité, plutôt masculine, la définition d'une aire sacrée et, selon Burkert, un stratagème pour faire fauter la bête, une correction administrée à la masse, l'intervention subreptice du porteur de couteau, souvent tenu de fuir rapidement les lieux avant la découpe à proprement parler, puis la distribution des parts, à la divinité d'abord, puis à ceux qui ont cautionné le rite sacrificiel (à l'exception du meurtrier). C'est moyennant l'ensemble de ces observances que la boucherie peut se perpétuer sans infamie rémanente et au bénéfice de tous (le plus souvent au masculin pluriel). Pourquoi ces précautions ? Par le meurtre et la consommation de la part mâle des troupeaux la virilité est atteinte dans sa consistance sociale. Ce mal du mâle envers son propre sexe, cette faute attachée, non pas au meurtre préalable à l'alimentation (sinon le chasseur serait tout aussi fautif que le boucher), mais à la gestion des troupeaux par élimination des mâles, faute liée à la possession de la richesse mobilière masculine, doit être exorcisé. L'Antiquité s'est montrée fort inventive à cet égard. Le fait de distinguer les prêtres du reste de la population (comme en Égypte et en Mésopotamie) permet de résoudre le problème en construisant une théocratie « vivante », la divinité réclamant quotidiennement sa nourriture, partagée avec les prêtres et les promoteurs du sacrifice (qui ont acheté les bêtes sacrifiées), même si cette solution réclame une construction idéologique complexe (que l'on pense à ces poupées géantes qu'étaient les corps réceptacles des « ka » des divinités).
Lorsque le christianisme, à la suite du judaïsme, a condamné les rites sanglants, non seulement le clergé a cessé de se nourrir de la viande des croyants, mais, plus largement et plus profondément, l'aire sacrée a dû exclure toute effusion de sang en son sein, rabattue dans la stricte laïcité. L'espace familial n'admettant plus de sacrifice aux dieux domestiques, n'a pu maintenir que la tuerie des bêtes sans valeur mobilière. La boucherie laïque s'est mise en place pour répondre à la demande de tuerie des bêtes de valeur, et elle s'est organisée en corporations dans les espaces urbains pour protéger ce marché lucratif. Cette évolution aurait pu se faire naturellement par la reconnaissance sociale d'une branche économique à part entière. Mais si l'on examine l'Islam ou le Judaïsme, on notera que la boucherie, même dans des cultures qui valorisent le commerce, ne peut être considérée comme une activité marchande neutre, qu'elle est redevenue pratique sacrificielle, qui sacrifie au nom d'un Dieu paradoxalement au-dessus de tout sacrifice et n'en agréant aucun. Le christianisme a refusé le paradoxe et a condamné la boucherie à la laïcité et à la souillure.
Le sort des bouchers n'est pas sans rappeler celui des prostituées. Celles-ci, tant qu'elles étaient rattachées à un temple (prostituées sacrées) ou à un rite de passage (du statut d'enfant au statut de fille mariable, comme à Chypre, sous le patronage d'Aphrodite), étaient d'avance purifiées d'un acte socialement déconsidéré (pour des raisons de domination masculine). Il y avait conjointement des prostituées laïques, mais, quand bien même elles pouvaient descendre au plus bas de l'échelle sociale de la clientèle, elles gardaient cette aura sacrée dans laquelle baignaient leurs consœurs mieux loties. Lorsque le caractère sacré de la prostitution a été effacé (par le christianisme encore une fois), le statut des prostituées n'a cessé de se dégrader. Prostituées et bouchers ont donc une destinée sociale similaire : professions sacrées à l'origine, dont la sacralité est liée à un tabou social attaché à leur activité, la perte de leur sacralité s'est accompagnée de leur déchéance symbolique et de la dévaluation de leur valeur sociale en dépit de leur utilité et de leur richesse économique.
Les bouchers cumulent le double défaut d'être tabous et potentiellement violents dans les crises de pouvoir. Par leur nombre, leur force et leur armement, ils permettent à de simples mouvements insurrectionnels (protestation collective, manifestation), de se transformer en révoltes et de susciter des mutations plus ou moins importantes dans l'équilibre des pouvoirs de la ville médiévale. Éléments porteurs de la violence nécessaire à la bascule des pouvoirs, une fois la paix sociale rétablie, les bouchers, loin d'être gratifiés, sont au contraire réprimés.
Ce processus se retrouve d'ailleurs pendant les révolutions françaises ou bolcheviques : terroristes de 93 et anarchistes russes seront éliminés au profit de ceux qui, de même condition, ne s'étaient pas sali les mains.