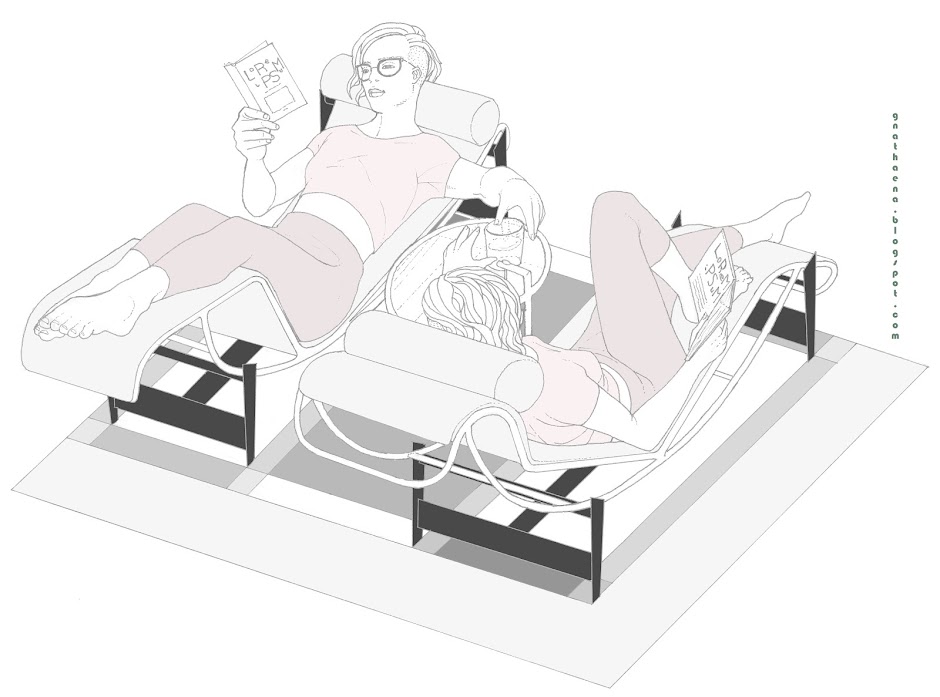Sources :
Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Seuil, 1948
Eschyle (– 525 – 456), Orestie in Tragédies, Les Belles Lettres 1925, Gallimard coll. folio, 1982
Jamais très éloignée des sciences, la philosophie fournit des outils performants pour penser le monde dans sa globalité. Les principes et les méthodes propres au discours philosophique sont-ils neutres ou sont-ils des rouages de la domination masculine ? Faut-il abandonner la philosophie parce que trop genrée, ou bien la purger de ses vices de construction et lui donner de nouvelles finalités, ou bien encore la garder telle quelle, œuvre de l’esprit humain dégenré ?
Du fait de l’influence qu’elle a eue sur la pensée occidentale, je voudrais m’intéresser à la philosophie grecque. Du – VIe siècle où ses discours se répandent à l’est et à l’ouest de la Grèce, au – IVe siècle où elle se recentre sur Athènes (et s’y développe jusqu’au VIe siècle), le statut relatif des hommes et des femmes varie notablement, les équilibres sociaux antérieurs sont remis en question, tandis que s’amorce la politisation du citoyen, qu’apparaissent les tyrans et que leur succèdent les démocraties. La philosophie, qui n’est pas restée étrangère à cette politisation (son discours est « isonomique », il s’adresse indistinctement à tous les citoyens), a-t-elle cautionné la minoration des femmes à cette époque ? Et le cas échéant, qu’a-t-elle légué en matière de misogynie ? De simples thèmes discursifs ou bien des concepts, voire une vision du monde ?
Voilà les quelques questions auxquelles je m'emploierai à répondre. Je ne prétends pas y parvenir définitivement dans cette séquence d’articles « Sexe, genre et philosophie », mais je souhaite au moins délimiter le problème.
Pour cela je commencerai par l’étude d’un auteur, Hésiode, antérieur à la philosophie hellénique en tant que telle mais qui en quelque sorte l’annonce, afin de saisir l’état de la question au début du – VIIe siècle et de disposer ainsi d’une référence pour la lecture des premières générations de philosophes. On considère généralement que l’effort d’abstraction dont Hésiode a fait preuve restait limité par l’obligation de faire de la métaphysique dans le langage de la théologie panhellénique. En fait, comme souvent, quand on creuse la question on est obligé d’avouer que la séparation que l’on voulait établir (entre Hésiode et les philosophes) reposait sur de fragiles fondations :
Il est facile de lire la Théogonie d’Hésiode comme une construction métaphysique aussi riche que celle de Platon par exemple.
L’usage de l’onomastique théologique comme lexique conceptuel lui est commun aux premières générations de philosophes jusqu’au – IVe siècle : la grande majorité des noms de déesses et de dieux sont forgés à partir de « sèmes » caractéristiques des concepts de la philosophie.
Hésiode construit un champ sémantique de type conceptuel sur la seule base des relations généalogiques, donc des alliances et des héritages. C’est un choix qui ne le distingue pas particulièrement des philosophes, dont les systèmes conceptuels trouvent leur cohérence dans le choix d’une logique particulière liant les concepts entre eux selon un certain modèle (par exemple, le modèle de la propriété foncière commande, chez Anaximandre, toute la dialectique de l’illimité et du limitant). On peut en outre noter que dans le Banquet, Platon utilise lui aussi la généalogie pour expliquer la nature d’Éros : enfant de Poros et de Pénia (Voie et Pauvreté) conçu lors d'un banquet divin dédié à Aphrodite.
Hésiode établit la réalité de ce qu’il exprime dans le rapport analogique de la musique, de la religion, de la politique et de la morale : ce qu’Hésiode exprime est ce qui régit l’efficience musicale, religieuse, politique et morale, « simultanément » pourrait-on dire. Il faut avouer que ce n’est pas la voie qu’ont choisie les philosophes grecs, qui se sont attachés à distinguer les domaines du savoir et à les traiter chacun pour soi. Toutes les tentatives de synthèses philosophiques générales ont bien sûr dû recomposer avec l’analogie hésiodienne, mais on pourra toujours « reprocher » à Hésiode de n’avoir pas traité de chaque domaine pour lui-même, ou en tout cas convenir qu’il ne pouvait pas le faire au – VIIe siècle.
Condenser le savoir pour le faire entendre alternativement à des publics séparés (les musicien.ne.s, les officiant.e.s du culte, les notables, les citoyens vertueux et leurs épouses) ou l’étaler devant un public mêlé amateur de tout ce que les autres disent et font, ce sont les préoccupations caractéristiques de deux époques et de deux stades très différents de la cité grecque, grossièrement celui du modèle oligarchique et celui du modèle démocratique, celui du – VIIe siècle et celui du – Ve siècle, largement préfiguré au – VIe siècle. Hésiode ne se distingue finalement des philosophes que par le temps historique, faible frontière que je me permettrai d’abolir pour donner plus de consistance à mon souhait de faire d’Hésiode une référence pour la philosophie, à la limite antérieure de celle-ci, dans une société qui présente l’intérêt d’être différente de celle où se déploie la philosophie, notamment quant aux rapports de sexe et de genre.
Au – VIIe siècle, Sparte domine culturellement la Grèce. H-I Marrou décrit l’éducation que chaque famille donne à ses enfants des deux sexes : éducation sportive et musicale, largement exploitée dans le cadre des fêtes politiques, où les familles concitoyennes se donnent leur jeunesse en spectacle ; les filles y tiennent une place importante. Une même contrainte esthétique s’impose aux jeunes des deux sexes (il faut paraître beau ou belle, individuellement ou en groupe, autant dans la vie de tous les jours que lors des spectacles de danse, les chorales et les compétitions gymniques). La pression psychologique qui résulte de cette contrainte montre que celle-ci est d'ordre initiatique : il s'agit de discriminer les enfants qui feront de bons citoyens et de bonnes épouses de citoyens, de celleux qui porteront préjudice à la Cité. En tant qu’épouses, les femmes spartiates disposent de la plus grande latitude dans la gestion des affaires domestiques : c’est à cela que les jeunes filles se préparent à l’adolescence, tandis que les jeunes garçons entament leur initiation spécifiquement masculine. Celle-ci les entraîne, une fois adultes, sur le champ de bataille et leur vie est orientée par la guerre, même au milieu des fêtes publiques et privées où les aèdes chantent ses beautés autant que celle de la jeunesse qui s’y prépare. Les femmes règnent sur l’économie, les hommes sur la guerre. La politique est l’instrument qui permet de reproduire cet état des choses. Œuvre de son temps, la Théogonie d’Hésiode reflète-t-elle cet équilibre entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes, équilibre asymétrique qui est établi par les hommes et qui se justifie d'homme à homme, mais qui offre un espace de liberté aux femmes, moyennant une contrainte forte sur les mariages ? Ceux-ci, dans le système plutôt figé caractéristique de l'oligarchie politique spartiate, sont en effet destinés à allier deux familles sur le plan social et économique. Ce qui est enseigné à une fille par sa mère sera appliqué pour le profit d’une autre famille que la sienne ; en contrepartie, cette autre famille donnera une fille éduquée qui deviendra l'épouse de son fils. L'éducation féminine est bien un investissement pour les familles, qu'un mariage libre ne permettrait pas de rentabiliser.
Au – VIe siècle, Sparte commence à perdre son hégémonie culturelle, tandis que l’Ionie et la Sicile (terre d'immigration ionienne sous l'effet de la pression perse) produisent les premiers philosophes.
À Sparte l’éducation des filles et des garçons ne donne plus la prééminence à la musique mais à la gymnastique. La pression esthétique devient une pression éthique au sein d’une Cité de plus en plus recentrée sur son aristocratie. Celle-ci cherche à se différencier physiquement du reste de la population. Il ne s’agit pas ici de déformations osseuses réalisées dès la naissance, ni de stigmates imposés dans un rite d’initiation, mais d’une déformation par l’éthique du corps masculin ou féminin (qui doit être endurant, insensible, etc.). Une femme au corps endurci engendrera un enfant qui saura endurcir son corps. Même si les musicien.ne.s ont peu à peu été exclu.e.s de Sparte ou s’en sont volontairement exilé.e.s, on peut se demander si la philosophie naissante a retenu quelque chose de cette politique résolument viriliste qui estime essentiel que la même pression éthique s’exerce sur les hommes et sur les femmes, au motif que les enfants d’une femme héritent de son tempérament. Sparte inaugure en tout cas une éducation de plus en plus contrôlée par l’État, notamment par le biais de l’expulsion des professeur.e.s de musique.
Alors que décline le centre de l’aire culturelle hellénique, la périphérie prend son essor. L’exemple de Sappho est bien connu, qui, à la suite d'autres musiciennes de Lesbos, crée une école pour riches adolescentes. Si une longue tradition masculine a perpétué sa seule mémoire, il est cependant acquis que la partie asiatique de la Grèce a vu éclore au – VIe siècle des groupements dédiés aux Muses et faisant fonction d’enseignement supérieur pour une clientèle masculine et féminine aisée. Des écoles philosophiques, exclusivement masculines, s'ouvrent sur le même principe. Celleux qui émigrent en Sicile développent un système culturel similaire. Un enseignement supérieur donc, un peu plus tôt pour les jeunes femmes, un peu plus tard pour les jeunes hommes (du fait du service militaire, toujours long : rappelons que les mariages grecs unissent un homme presque mûr à une femme encore jeune). L’enseignement primaire pour les filles et pour les garçons s’en trouve renforcé, parce que les élites urbaines voient dans l’éducation culturelle le meilleur moyen de briller. Dans ces Cités économiquement favorisées, où l’oligarchie peut se permettre d'élargir ses sphères d’alliances, c’est en effet la valeur de l’éducation qui fait la différence. Éducation de plus en plus politiquement promue comme ciment culturel d’une Cité qui s’achemine vers la démocratie.
Le – Ve siècle est marqué par les crises politiques qui touchent les oligarchies, dont les clivages internes conduisent à la tyrannie (ou au totalitarisme spartiate), qui débouche le plus souvent sur la démocratie. Le prestige qu’Athènes a acquis dans la seconde guerre médique favorise la diffusion de son mode de gouvernement. La cité attire les personnes cultivées au – Ve siècle comme Sparte les attirait au – VIIe siècle. Polarisée par son opposition à Sparte, elle n’est malheureusement pas l’héritière des périphéries du – VIe siècle : si elle en adopte la philosophie, elle en rejette la tradition d’éducation féminine. En pleine croissance et d’idéologie démocratique, Athènes attire de riches migrants cultivés originaires de la Grèce asiatique : la société athénienne se structure autour des trois classes des citoyens, des métèques (ces résidents étrangers riches et cultivés) et des esclaves. La citoyenneté est une valeur en soi qui commande la logique des alliances matrimoniales, très ouvertes entre familles citoyennes, alternativement ouvertes et fermées à l’égard des métèques et des affranchi.e.s (au gré des victoires et des défaites dans la guerre du Péloponnèse). L’ouverture des mariages au sein de la sphère de la citoyenneté s’accompagne de l’appauvrissement culturel des femmes, dont le statut social se rapproche dangereusement de celui de matrice à héritiers. Heureusement la Cité, par le biais des fêtes publiques, rend possible une culture féminine, à laquelle la sphère privée ne contribue plus guère, sans pour autant prendre en charge l’éducation des femmes, qui reste une transmission mère-fille, malgré l'éclatement des réseaux familiaux. Ce modèle est très athénien. D’autres Cités peuvent être plus avancées, mais leur rayonnement est moindre. Il sera intéressant de relire l’œuvre d’Aristophane à la lumière du contexte démocratique athénien.
Le – IVe siècle se caractérise par la perte progressive d’autonomie des Cités face au modèle impérial qui s’impose graduellement du fait de l’accès de la Macédoine au rang de puissance dominante à très grande échelle (avec le renversement de l’empire perse par Alexandre). Athènes reste la capitale de la philosophie et, de fait, c’est le – IVe siècle que l’on connaît le mieux, parce qu’il a vu fleurir les écoles philosophiques qui ont marqué l’Europe pour de longs siècles : Cyniques, Académie de Platon, Lycée d’Aristote, Jardin d’Épicure, Portique des Stoïciens. Après les années de crise, les Cités grecques vont devenir les actrices principales de l’éducation des filles et des garçons, avec un déséquilibre important entre les filles (cantonnées à l’école primaire) et les garçons (pouvant bénéficier d’un enseignement secondaire, toujours public, et d’un enseignement supérieur associatif : les associations pour le culte des Muses que sont les écoles philosophiques). Seules les filles de familles riches et cultivées peuvent désormais accéder, par exception, à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur – délivré par des hommes pour des hommes – au rang desquelles les filles des maîtres d’écoles philosophiques, mariées à leurs successeurs. J’aurai l’occasion d'établir quelles écoles philosophiques sont le plus aptes à délivrer un message non sexiste et présentent dès lors un intérêt pour les femmes.
Pour montrer à quel point la culture de l’époque pouvait être mise au service d’une idéologie sociale ou politique concernant directement les femmes, je voudrais citer un passage de la troisième pièce tragique de l’Orestie de l’Athénien Eschyle, Les Euménides, jouée aux Grandes Dionysies en – 458. Il s’agit du procès d’Oreste. Athéna est la juge. Apollon témoigne en la faveur du héros tragique, assassin de sa mère Clytemnestre et poursuivi par les Érinyes – qui vont devenir des Euménides.
Le Coryphée (une Érinye ndlr) – Vois donc de quelle façon tu soutiens son innocence (celle d’Oreste ndlr) ! C’est le sang de sa mère, celui qui coule en ses veines, qu’il a répandu sur le sol : et il habiterait Argos, le palais paternel (d’Agamemnon, où il est assassiné par Clytemnestre, et où elle est assassinée par Oreste ndlr) ! À quels autels publics sacrifierait-il donc ? Quelle phratrie lui permettrait d’user de son eau lustrale ?
Apollon – Écoute encore ma réponse, et vois la justesse de mon argument. Ce n’est pas la mère qui enfante celui qu’on nomme son enfant : elle n’est que la nourrice du germe en elle semé. Celui qui enfante, c’est l’homme qui la féconde ; elle, comme une étrangère, sauvegarde la jeune pousse, quand du moins les dieux n’y portent point atteinte. Et de cela je te donnerai pour preuve qu’on peut être père sans l’aide d’une mère. En voici près de nous un garant, fille de Zeus Olympien et qui n’a point été nourrie dans la nuit du sein maternel : quelle déesse pourtant saurait produire un pareil rejeton ? Pour moi, Pallas, ma sagesse saura par ailleurs faire grands ton peuple et ta ville ; mais j’ai dès cette heure conduit ce suppliant au foyer de ton temple, pour qu’éternellement il te soit fidèle, que tu aies des alliés, déesse, en lui et en ses fils, et qu’à jamais même fidélité te soit gardée encore par les fils de ses fils.
(…)
Athéna – C’est à moi qu’il appartient de prononcer la dernière. Je joindrai mon suffrage à ceux qui vont à Oreste. Je n’ai point eu de mère pour me mettre au monde. Mon cœur toujours – jusqu’à l’hymen du moins (Athéna fait partie des quelques déesses éternellement vierges) – est tout acquis à l’homme : sans réserve je suis pour le père. Dès lors je n’aurai pas d’égard particulier pour la mort d’une femme qui avait tué l’époux gardien de son foyer. Pour qu’Oreste soit vainqueur, il suffira que les voix se partagent. Faites vite tomber les suffrages des urnes, juges à qui est commis ce soin.
Les juges de la Boulè qui ont voté (pas ceux qui dépouillent) ont opportunément voté à parts égales pour et contre Oreste. Ils sont quittes à l’égard d’Apollon comme des Érinyes. Oreste est libre et Argos s’alliera à Athènes (durant les guerres médiques). Les Érinyes passent un pacte avec Athéna et deviennent des Euménides, bienfaitrices « jardinières » de l’Attique, sarclant l’Injuste et laissant le Juste prospérer.
L’argument décisif repose sur la réduction de la maternité à l’allaitement (intérieur au sein, puis extérieur au sein), et des mères aux nourrices (qui, depuis longtemps, sont partie prenante de l’économie domestique grecque : à Sparte au – VIIe siècle, les nourrices athéniennes étaient très prisées). Cette double réduction est fondamentalement misogyne. La caution d’Athéna (qui n’est née de Zeus que parce qu’il a avalé son épouse Métis qui était enceinte d’elle) est un troisième critère de misogynie militante. Athènes au – Ve siècle laissait s’exprimer de tels discours (sous une forme certes euphémisée : celle de la plaidoirie d’Apollon, exemplum de l’art rhétorique mis à la mode par les Sophistes) dans une grande fête publique où sont conviés tous les citoyens et leurs épouses. Il ne sera pas inutile de mesurer l’écart entre Eschyle et Aristophane, entre le début et la fin du – Ve siècle, avant et après la guerre du Péloponnèse. Quant à la philosophie athénienne de la période, essentiellement représentée par l’Ionien Anaxagore (intermédiaire entre Eschyle et Aristophane, ami de Périclès et d’Euripide), nous ne pourrons malheureusement pas l’utiliser, du fait de la pauvreté de ce qui nous en reste.