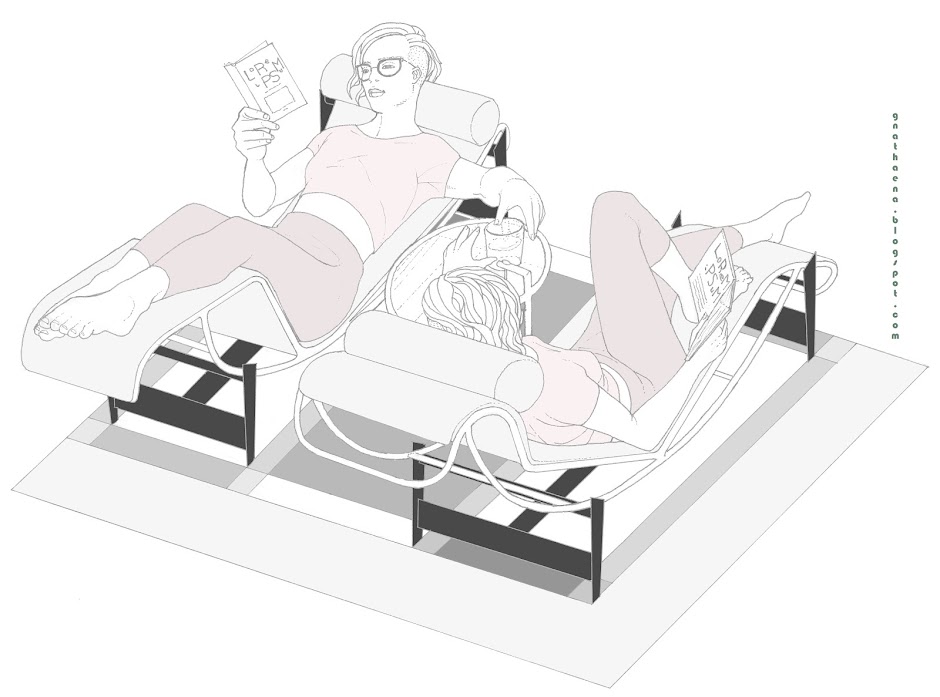Sources :
Rutebeuf (1245-1285), Œuvres complètes, Le Livre de Poche, collection Lettres gothiques, 1990
Angèle de Foligno (1248-1309), Le livre des visions et instructions, Le Seuil, collection Points Sagesses, 1991
Jean de Joinville (1224-1317), Vie de saint Louis, Classiques Garnier, 1995
Philippine de Porcellet (1244-1316), Vie de sainte Douceline, in Les troubadours, œuvres poétiques, Desclée de Brouwer, 2000
Articles liés :
Paola Tabet – 'Fertilité naturelle, reproduction forcée', 2020
Femmes illustres #3 / Foucault #1 Sorcière, possédée, hystérique : la longue chaîne de la résistance féminine aux stratégies de domination politique et culturelle en Europe et en France en particulier, 2020
À cause des anges… : le christianisme primitif était-il masculin ? 2021
Ce terrible été, entre tempêtes et canicules, je l’ai vécu dans la douleur, il m’a fallu trouver vite un refuge frais et apaisant où m’abriter quelques minutes aussi régulièrement que possible : ce fut ma réserve de livres du XIIIe siècle, qui me soutient dans les moments les plus difficiles. Le meilleur ouvrage que j’ai pu lire pour ce que j’avais a été le Roman de Jaufre, clairement le meilleur roman de chevalerie du Moyen Âge, sur une matière bretonne. J’ai découvert de vraies merveilles, dont le côté positif l’emportait toujours sur l’inévitable côté négatif. C’est ainsi que je me suis penchée sur le Livre des visions et instructions d’Angèle de Foligno, ouvrage que j’avais lu alors que je travaillais à mon mémoire de maîtrise consacré à la mystique féminine. Avoir relu Angèle après avoir lu les œuvres complètes de Rutebeuf et relu la Vie de saint Louis de Joinville, le tout à la lumière de mes articles sur Christine de Pisan et sur Saint-Paul, a fini de me convaincre du lien que je trouve maintenant évident entre la domination masculine et la religiosité féminine. La lecture de la Vie de sainte Douceline (1214-1274) par sa disciple Philippine de Porcellet, n’a fait que renforcer mon sentiment.
Le conte sacré de Marie l’Égyptienne
Dans sa Vie de Sainte-Marie l’Égyptienne, Rutebeuf raconte comment une femme de 29 ans se trouva exclue de l’église de la Croix à Jérusalem, où la foule des croyants venait célébrer la Passion, comment elle comprit que cette exclusion était due à ses péchés (à douze ans elle avait fugué à Alexandrie pour vivre une vie de plaisirs, dix-sept ans durant), comment elle s’adressa à la Vierge Marie et reçut d’elle la consigne de rejoindre une forêt de l’autre côté du Jourdain pour y faire pénitence de son péché d’avoir ignoré Dieu et pour qu’enfin elle y termine sa vie et soit ravie au plus saint des cieux. Et c’est bien le programme que suivit l’héroïne de cette histoire « édifiante ».
« Elle avait la peau noire comme le pied d’un cygne, sa poitrine devint moussue à force d’être battue par la pluie. Ses bras, ses longs doigts, ses mains étaient plus noirs, à tout le moins, que de la poix ou de l’encre. Elle se taillait les ongles avec ses dents. On aurait dit qu’elle n’avait pas de ventre parce qu’elle n’y mettait jamais de nourriture. Ses pieds étaient crevassés par-dessus, blessés par-dessous autant qu’ils pouvaient l’être. Elle ne se gardait pas des épines et ne cherchait pas à suivre les sentiers. Quand une épine la piquait, joignant les mains, elle priait Dieu. Elle s’est imposée si longtemps cette règle que plus de quarante ans durant elle alla nue. Deux petits pains, pas bien gros, voilà de quoi elle vécut des années. La première année ils devinrent aussi durs que les pierres d’un mur. Marie en mangeait tous les jours, mais un petit morceau seulement. Ses pains sont finis, elle les a mangés : ce n’est pas pour cela qu’elle a quitté les bois, faute de nourriture. Elle ne demande pas d’autre gourmandise que les pousses d’herbe du pré, comme les bêtes dénuées de parole. Elle boit l’eau du ruisseau sans avoir de récipient. Il n’y a pas de quoi regretter le péché dès lors que le corps s’attache à faire une pénitence aussi dure. » (vv 452-485).
Peu avant de terminer sa vie, Marie rencontre Saint Zozimas, sorti de son monastère au temps du carême pour méditer en ermite dans un lieu éloigné. Celui-ci reçoit sa confession et lui donne les sacrements, puis, après un an, retournant la voir, la trouve morte et l’enterre en chrétienne.
« Alors elle a levé les yeux au ciel et, ravie de par Dieu, fut emportée là d’où elle venait, elle a salué la très douce Vierge ainsi que son glorieux Fils : que d’elle il lui souvienne ! – Dieu, dit-elle, toi qui m’as créée et qui as placé une âme dans mon corps, je sais que tu m’as aimée, toi qui as entendu ma prière. Je veux quitter cette vie. Je vois venir ta compagnie, je crois qu’ils viennent me chercher : je te recommande mon corps et mon âme. – Elle s’est alors étendue à terre, telle qu’elle était, presque nue. Elle croisa les mains sur sa poitrine et s’enveloppa de ses cheveux. Elle a fermé, comme il convenait, les yeux et la bouche. Dans la joie éternelle, sans peur du diable, Marie avec Marie s’en est allée. » (vv 1117-1140)
L’histoire de Marie l’Égyptienne était bien connue au Moyen Âge, mais jusqu’au XIIe siècle on ne la connaissait que par l’intermédiaire de celle de Zozime dont elle constituait un épisode. Au XIIIe siècle, les choses s’inversent, et dans la Légende dorée de Jacques de Voragine (1266) il y a bien un article sur Marie l’Égyptienne mais pas sur Zozime, qui n’est mentionné que comme adjuvant de l’histoire de la sainte. Ce renversement est caractéristique d’une tendance de fond, liée à l’ouverture des ordres mendiants (Franciscains et Dominicains) aux femmes du siècle, par le biais notamment des béguinages. En réaction à cette innovation, les lettrés érigent Marie l’Égyptienne en modèle de la conversion féminine séculière, modèle a priori inappropriable par les femmes, très entaché de masculinisme puisque, comme ce sera le cas chez le très misogyne Jean de Meung, avec Marie, la femme du siècle est mesurée à l’aune de la prostituée dite « libre », qui se prostitue non par nécessité mais par goût. Rutebeuf, qui n’aime pas les béguines à cause de la tiédeur de leur foi (1), leur oppose une femme physiologiquement et spirituellement « chaude » à laquelle elles ne peuvent a priori absolument pas s’identifier.
(1) On peut lire chez Rutebeuf une formulation en vers des critiques que l’on adressait communément aux béguines parisiennes, dans Les ordres de Paris, IV, vv 37-48.
Et pourtant, l’histoire de Marie l’Égyptienne parlait aussi aux femmes, nobles et bourgeoises, du XIIIe siècle, non pas parce qu’elles se sentaient souillées d’un désir sexuel sans frein du fait de la déficience de leur nature, mais parce qu’elles souffraient d’avoir été réduites ou de devoir l’être, en tant que femmes, au statut de matrice pendant les premières années de leur vie adulte (souvent dès douze ans, âge de Marie l’Égyptienne au moment de sa fugue à Alexandrie). C’est leur statut de mère forcée qui leur posait problème. Et de fait certaines femmes du XIIIe siècle (nobles ou bourgeoises) sont parvenues à se reconstruire un statut choisi de mère dans la foi après avoir souffert ou pour éviter d’avoir à souffrir celui de mère reproductrice. C’est d’elles que je voudrais parler dans cet article.
S’approprier le modèle de Marie l’Égyptienne n’était pas hors de portée des femmes, il fallait simplement l’appréhender au second degré, non pas comme une leçon sur la chasteté, mais comme l’exemplification d’une conversion féminine séculière entendue comme un « réveil », comme la prise de conscience du péché séculier par excellence, l’oubli de Dieu, sous sa forme passive (simple indifférence) ou sous sa forme active (impiété, dévoiement volontaire d’autrui). Qu’il soit passif ou actif, ce péché, que l’on peut qualifier de « théologique », est toujours mortel. N’est-il pas marqué du sceau du pire scandale qui pût être : le jugement, la condamnation, le supplice du Christ par des hommes qui ont alors représenté l’humanité tout entière, cette humanité à laquelle participent tant les hommes que les femmes ? La conversion commence comme un réveil : « Christ a été tué ! ». Et, paradoxe, Christ, assassiné par l’humanité, non content de ne pas la renier, l’a reconnue comme sienne et l’a sauvée de la mort ! Le péché théologique trouve son paradigme dans l’oubli de la Passion. Marie l’Égyptienne est une « pécheresse théologique passive » quand elle vit sa vie alexandrine dans l’inconscience de ce que le Christ est mort en Croix ; elle est une « pécheresse théologique active » quand elle séduit les pèlerins du chemin de Croix et les détourne de leur réveil. Que la source de sa vie pécheresse soit ceci ou cela n’importe pas, la sexualité débridée est une parabole commode dont peut bien se passer qui sait entendre. L’important, c’est que Marie l’Égyptienne figure l’oubli de Dieu passif et actif au féminin – et que ses tribulations sont celles que doivent immanquablement emprunter les femmes qui veulent rompre avec la servitude qui leur est socialement promise et vivre une vie choisie, dans la religion puisque l’Église le permet.
Angèle, une mystique accomplie
Je parlerai d’abord d’Angèle de Foligno, qui brille d’une lumière toute particulière tant elle rend transparente l’alchimie qui s’opère sous l’impulsion du sentiment du péché théologique chez une femme. D’une famille suffisamment en vue pour qu’elle pût être mariée (jeune) au seigneur de Foligno, bourg proche d’Assise, Angèle a vécu sa vie d’épouse et rapidement de mère avec le sentiment de la perdre. Les décès de sa mère puis de son mari puis de ses fils (sans doute la peste) lui rendent sa liberté. En dépit des inévitables récriminations de son entourage, Angèle décide de vendre le château et d’en donner l’argent aux pauvres (en forme de don aux frères mineurs pour leurs activités de soutien aux pauvres). La mendicité étant interdite aux femmes, elle se tourne vers Assise et sa communauté franciscaine, qui finit par accepter de l’accueillir avec sa suite de dames converties à ses vues. Elle passe alors à l’acte et se dépourvoit de ses biens.
Le Livre des visions et instructions expose la vie intime d’Angèle, ou plus exactement le progressif établissement de son intimité choisie. L’ouvrage a été écrit par le frère Arnaud, « fils » d’Angèle (c’est-à-dire placé sous son autorité de « mère » de même que l’ensemble des moines du monastère qui l’a recueillie depuis qu’ils ont vu en elle la disciple par excellence de François), peu avant qu’elle ne meure, et complété après son décès. Il est introduit par deux prologues du frère Arnaud ; leur succèdent 70 chapitres : 67 sont des discours d’Angèle adressés aux lecteurs (avant tout au frère Arnaud et à l’ensemble de la communauté), les 3 derniers sont consacrés par frère Arnaud à la mort d’Angèle. Quelques points méritent d’être soulignés :
Angèle n’a jamais souhaité livrer son intimité, reconstruite par ses soins – avec l’aide de Dieu – : c’est parce que frère Arnaud n’a eu de cesse de réclamer qu’elle la livre pour l’édification de la communauté qu’elle a fini par céder ;
mais c’est essentiellement parce qu’elle maîtrise son histoire propre qu’Angèle accepte de la livrer : la plupart des autres mystiques ne sont pas parvenues à ce stade (elles en restent à : « quand j’écris « j’ai joui », je jouis encore »), et le récit de leur vie est nécessairement celui d’un témoin plus ou moins proche ou d’un hagiographe compilateur plus ou moins inspiré répondant à une commande ;
frère Arnaud exprime de nombreuses fois son incapacité à transcrire les paroles d’Angèle, à les comprendre et parfois à les entendre, souvent à en suivre le flot ;
dans l’ensemble attribuer les 67 premiers chapitres à Angèle et faire de frère Arnaud un (piètre) secrétaire est correct : Angèle a en l’occurrence relu et amendé le texte ;
l’enjeu n’était pas neutre : soumis aux plus hautes autorités franciscaines, l’ouvrage a passé l’épreuve de la censure et a pu être transmis jusqu’à nous.
Les 18 premiers chapitres sont autant de « pas » sur le chemin d’une intimité protégée, inaccessible à la pression de l’entourage. Cela commence avec la conscience du péché et le sentiment de crainte (d’avoir offensé Dieu) et de tristesse (de se penser damnée), la première expérience véritable de la confession (marquée par les sentiments d’amertume, de honte et de douleur) et de la pénitence qui s’ensuit (« vide de consolation, pleine de douleur »). Comme il n’était d’usage de se confesser qu’une fois l’an durant le carême, c’est ensuite vers elle-même et vers des intercesseur.e.s spirituel.le.s qu’elle se tourne. Méditant sur sa faute, Angèle a la révélation de la miséricorde divine, moment important qui, s’il s’accompagne d’un redoublement de pleurs et d’une pénitence « sévère » (qu’Angèle refuse de décrire), ouvre sur la conscience de la gravité de l’oubli de Dieu. C’est après avoir prononcé sa propre condamnation qu’Angèle comprend que, marquée par le péché le plus lourd, elle en souille toute la création. Elle invoque alors la Vierge Marie et tous les saints, et supplie les créatures offensées par sa faute.
« Tout à coup je crus sentir sur moi la pitié de toutes les créatures, et la pitié de tous les saints » (...) « et je reçus alors un don : c’était un grand feu d’amour, et la puissance de prier comme jamais je n’avais prié ». (Sixième pas)
Les six premiers pas ont ainsi permis à Angèle d’accéder à la pleine conscience du péché par excellence, et ils la conduisent très logiquement à la Passion, grand œuvre de l’impiété absolue dont a fait preuve l’humanité. Prenant sur soi cette humanité pécheresse, Angèle en assume le crime tout en s’enflammant du regret de l’avoir commis. À ce feu, elle consacre son corps et fait vœu de chasteté (entendue comme purification continue du corps). Cette nouvelle étape est importante : tout s’est passé jusqu’ici dans une intimité secrète où Angèle s’isole au milieu de ses proches. Elle se sent maintenant prête à suivre la voie de la Passion qui s’est ouverte à elle, mais elle ne le peut encore, à cause de ces proches.
« J’étais encore avec mon mari ; c’est pourquoi toute injure qui m’était dite ou faite avait un goût amer (elle cesse de s’habiller, de s’alimenter, de se coiffer selon ce qu’impose son rang ndlr). Cependant je le portais comme je le pouvais. Ce fut alors que Dieu voulut m’enlever ma mère, qui m’était, pour aller à lui, d’un grand empêchement. Mon mari et mes fils moururent aussi en peu de temps. Et parce que, étant entrée dans la route, j’avais prié Dieu qu’il me débarrassât d’eux tous, leur mort fut une grande consolation. Ce n’était pas que je fusse exempte de compassion ; mais je pensais qu’après cette grâce, mon cœur et ma volonté seraient toujours dans le cœur de Dieu, le cœur et la volonté de Dieu toujours dans mon cœur. » (Neuvième pas)
Nous avons là un récit de libération, libération des rouages d’une machine à aliéner l’individu au féminin. Il est terrible de voir que la mère en fait partie aux côtés du mari et des fils : trois générations pour contraindre une (jeune) femme mère forcée et l’obliger à ne pas être ce qu’elle avait à être (définition aristotélicienne de l’essence individuelle) et qu’elle n’a pu être que par la grâce de Dieu, dans la destruction du dispositif aliénant de l’entourage familial.
Les pas suivants consistent à passer progressivement de la Passion exercée à la Passion subie, de s’identifier moins aux criminels qui ont assassiné le Christ, qu’à Jésus dans sa chair. Un dialogue parvient ainsi à s’engager entre Jésus lui-même et Angèle autour du vécu de la Passion. Comme chaque point du corps du Christ est sacré, il y a autant de sacrilèges que de points du corps du Christ violentés. Le moindre poil arraché est pour Angèle le sujet des plaintes et des douleurs les plus vives. Et Jésus ne manque pas de lui offrir de longs parcours de sa chair meurtrie. La souffrance partagée devient le support de l’amour le plus intime que s’échangent Jésus et Angèle. Les 18 pas sont franchis quand de surcroît Angèle parvient à se débarrasser de ses biens, encore une fois contre l’avis de tous, Franciscains compris. Le geste n’est pas anodin, la libération qui l’accompagne intensifie l’intimité d’Angèle jusqu’à l’extase, que révèle ce petit « cri » si caractéristique de la mystique féminine.
« Tel était le feu dans mon cœur qu’aucune génuflexion ou qu’aucune pénitence ne me fatiguait. Et pourtant je fus conduite vers un plus grand feu et une ardeur plus brûlante. Alors je ne pouvais plus entendre parler de Dieu sans répondre par un cri (de délectation ndlr), et quand j’aurais vu sur ma tête une hache levée, je n’aurais pas pu retenir ce cri. Ceci m’arriva pour la première fois le jour où je vendis mon château pour en donner le prix aux pauvres. C’était la meilleure de mes propriétés. À partir de ce moment, quand on parlait de Dieu mon cri m’échappait, même en présence de gens de toute espèce. On me crut possédée. Je ne dis pas le contraire ; c’est une infirmité, disais-je ; mais je ne peux pas faire autrement. Je ne pouvais donner satisfaction à ceux qui détestaient mon cri : cependant une certaine pudeur me gênait. Si je voyais la Passion du Christ représentée par la peinture, je pouvais à peine me soutenir ; la fièvre me prenait, et je me trouvais faible ; c’est pourquoi ma compagne me cachait les tableaux de la Passion. » (Dix-huitième et dernier pas)
S’ouvre alors une série de 34 chapitres consacrés aux visions d’Angèle sur la voie de la Passion. Leur succèdent 15 chapitres qui sont des lettres ou des extraits de lettres d’Angèle à ses « fils » : les « instructions » dont il est question dans le titre de l’ouvrage. La voie de la Passion trouve son point de départ dans l’Amour contrastant avec le Péché et s’accomplit dans la Maternité, une maternité choisie, qui se réalise dans l’instruction pratique plutôt que dans l’enseignement théorique. Quelques points de repère ne sont pas inutiles pour retracer le voyage d’Angèle.
La force de l’intimité conquise par Angèle peut se mesurer à l’aventure qui lui est arrivée sur le chemin d’Assise. Voulant prier Saint-François pour qu’il lui permette de vivre dans la réelle pauvreté, le Saint-Esprit lui apparaît au moment où elle parvient à la grotte qui marque l’étroit chemin du bourg. Ce qu’Il lui promet : l’invincibilité d’une intimité désormais imperméable à ce qui n’est pas de l’ordre de la solide liaison amoureuse d’Angèle et de Dieu.
« Je vais te parler pendant toute la route ; ma parole sera ininterrompue, et je te défie d’en écouter une autre ; car je t’ai liée, et je ne te lâcherai pas, que tu ne sois revenue ici une seconde fois, et je ne te lâcherai alors que relativement à cette joie d’aujourd’hui ; mais quant au reste, jamais, jamais, si tu m’aimes. » (Vingtième chapitre)
L’Amour divin comme réponse au péché, cela reste contradictoire. Les méditations d’Angèle la conduisent dans les « coulisses » de l’Amour, dans le Non-Amour qu’est l’Indifférence absolue, d’où sourd un Amour virginal qui ne connaît plus le péché ni la rémission du péché, qui ne connaît donc plus la justice divine, qui aime jusqu’à l’humanité criminelle dans le moment pourtant terrible de la Passion.
« Après avoir contemplé la volonté de Dieu, sa puissance et sa justice, je fus ravie à une plus grande hauteur où je ne vis plus rien de tout cela, et le mode de vision fut changé. Je vis une unité éternelle, inexprimable, dont je ne puis rien dire, sinon qu’elle est le tout bien. Et mon âme, dans le délire de sa joie, ne distinguait plus l’amour et contemplait l’inénarrable. J’étais sortie de la première vision, j’étais entrée dans l’inénarrable : avec mon corps ou sans mon corps, je l’ignore pleinement. Tous les états que j’avais connus étaient moins grands que celui-ci. Cette vision laissa en moi la mort des vices et la sécurité des vertus. J’aime tous les biens et les maux, les bienfaits et les forfaits. » (Vingt-quatrième chapitre)
Il me semble que le point d’orgue des pérégrinations d’Angèle se situe au moment où elle a la révélation de la Vierge. Là, tout ce qui, auparavant, était marqué par la violence (jusque dans la joie ressentie), c’est-à-dire par la disproportion entre Celui qui donne et celle qui reçoit, s’harmonise soudainement dans un ultime sursaut de violence. Les révélations éparses antérieures semblent simultanément prendre corps dans l’unité de la relation de Marie à Jésus, et de Marie et Jésus à Angèle. La Vierge avait souvent servi d’intermédiaire aux vœux d’Angèle, mais arrive le jour où Elle devient source de révélation, de prise de conscience : « une femme aussi ! ». Le christianisme n’est pas seulement une affaire d’hommes. N’était-ce pas parce qu’elle se savait femme que la voie choisie par Angèle a été si violente ? Violence de compensation d’une nature déficiente et pécheresse. La révélation de la Vierge dit le contraire, au moment même où la violence s’absolutise, où il n’y a absolument plus rien à faire qu’à mourir. Morte, Angèle peut (doit) en l’occurrence renaître, et renaître femme débarrassée des fausses illusions sur les femmes.
« Ce jour-là je n’étais pas en prière : je venais de manger, et je me reposais. Au moment où j’y pensais le moins, je fus ravie en esprit, et je vis la Vierge dans la gloire. Une femme pouvait donc être placée sur un tel trône et dans une telle majesté ? Ce sentiment m’inonda d’une joie ineffable. Cette gloire était possible à une femme : cela est, et je l’ai vu. Elle était debout, priant pour le genre humain ; l’aptitude qui vient de la bonté et celle qui vient de la force donnaient à sa prière des vertus inénarrables. J’étais transportée de bonheur à la vue de cette prière ; et pendant que je regardais la Vierge, tout à coup Jésus-Christ apparut près d’elle, revêtu de son humanité glorifiée. J’eus la notion des douleurs que cette chair avait souffertes, des opprobres qu’elle avait subis, de la croix qu’elle avait portée ; les tortures et les ignominies de la Passion me furent mises dans l’esprit. Mais voici ce qu’il y eut de merveilleux : le sentiment des tourments inouïs dont j’avais connaissance, et que Jésus a soufferts pour nous ; ce sentiment, au lieu de me briser de douleur, me brisait de joie. Transportée d’un bonheur inénarrable, je perdis la parole, et j’attendis la mort. Et j’éprouvai une peine au-dessus de toute peine : car j’attendis en vain. La mort ne venait pas, et je ne parvenais pas immédiatement, puisqu’elle refusait de briser mes liens, à l’Inénarrable qui était sous mes yeux. Cette vision dura trois jours sans interruption. Je mangeais, quoique très peu ; mais, languissante de désir, je ne pouvais pas parler : j’étais renversée, prosternée, surmontée. Si j’avais quelque chose à faire, je le faisais ; mais il ne fallait pas nommer Dieu devant moi, car ma joie devenait alors absolument insupportable. » (Quarante-quatrième chapitre)
C’est alors qu’Angèle peut se reconsidérer comme mère. Le moment clé en est sa vision de Saint-François, qui bénit ses « fils ». Mais Angèle ajoute que ses « filles » aussi ont reçu la bénédiction, de Dieu et de sa Mère. (Quarante-neuvième chapitre) Son intimité, Angèle la partageait plus volontiers avec ses « filles » qu’avec ses « fils ».