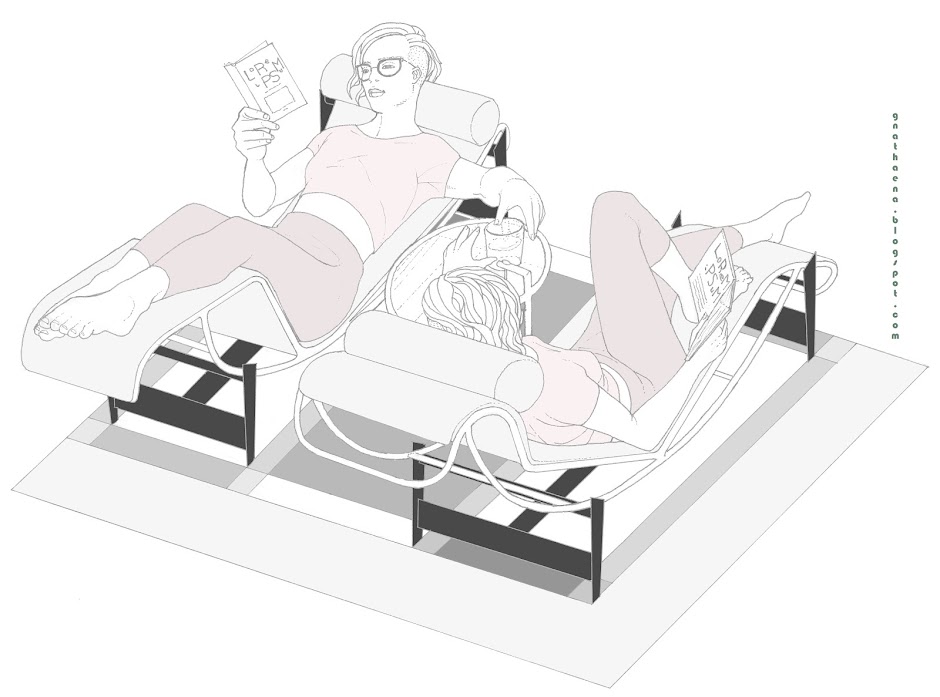Source : Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Louis Chevalier, Plon 1958, réédition LGF 1978.
Classes laborieuses et classes dangereuses est l’un de ces titres éloquents qui marquent les esprits : il semble condenser tout le contenu de l’ouvrage en une formule choc et nous exempter ainsi de sa lecture. C’est là où le trait de génie de l’auteur tourne au désavantage de l’œuvre. Régulièrement cité pour appuyer une certaine vision marxiste de la lutte des classes (le prolétariat est politiquement dangereux aux yeux de la bourgeoisie qui en redoute le potentiel insurrectionnel), l’ouvrage de Chevalier ne dit rien qui autorise une telle interprétation. Pire, ce texte de sciences historiques fondamental n’est non seulement pas lu, mais il est mal lu ou lu trop rapidement quand il l’est : l’on saute le détail de sa méthodologie, pourtant essentiel, et l’on néglige ses conclusions qui paraissent évidentes et usées, qui ne le sont pourtant que depuis que Louis Chevalier les a établies suite à un patient travail d’étude et de synthèse des sources démographiques et littéraires.
Le résumé que je propose aujourd’hui pourra paraître excessivement long, mais cette longueur est cependant le seul moyen d’éviter ce double malentendu et, par ailleurs, de montrer que derrière un bon titre il y a souvent une œuvre meilleure encore, qui, comme telle, offre des outils d’analyse et de compréhension possiblement employables dans d’autres contextes que celui auquel elle se rapporte, bref, qui demeure actuelle.
La méthodologie retenue
Le terrain d’études particulier qu’est la ville de Paris, dans la première moitié du XIXe siècle, permet de construire une méthode d’investigation tout à fait originale, avec dans l’ordre :
l’utilisation des données démographiques de l’époque, justifiée par le fait déterminant d’une croissance démographique dont l’intensité n’a jamais été, en France, aussi forte dans un périmètre aussi resserré ;
l’emploi des sources littéraires de l’époque, à condition qu’elles correspondent aux données démographiques, pour donner de la chair au fait déterminant auquel nous n’avons accès que par l’abstraction mathématique ;
la distinction, par l’étude de ces sources, de ce qui relève des faits (qu’expose généralement à son insu l’auteurice littéraire) et de ce qui relève de l’opinion sur les faits, ce qui ouvre sur une analyse critique des médias ;
la distinction, par l’étude de la littérature et des médias, de ce qui, dans les faits, relève de la cause et des effets ;
la mise en relation de la cause et des effets, et la mise en avant des politiques publiques qui ont été portées pour atténuer ces effets ;
la mise en évidence de ce qui, dans les effets, relève de « la vie à son stade critique », où elle verse dans la mort ou la folie : pour Louis Chevalier, c’est cette crise biologique qui fait l’histoire sociale.
1) La croissance démographique
Comptant environ 548 000 habitants en 1801 et 1 053 000 en 1851, Paris a vu sa population quasi doubler en 50 ans. En 1789, le nombre d’habitants était de 524 000, chiffre qui n’avait pas beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle. La ville étant dimensionnée pour une population d’un demi-million d’habitants, le doublement de ce chiffre dans une durée inférieure à la durée moyenne de vie d’une habitation ou d’un équipement, ne pouvait que faire entrer Paris en crise. La mutation de son économie, en introduisant les usines dans la ville, a accentué le phénomène, mais ni l’économie, ni d’ailleurs la politique n’ont représenté des causes déterminantes pour son histoire urbaine.
« Non seulement la population s’est considérablement accrue et en un petit nombre d’années, mais cet accroissement s’est produit dans le cadre d’une vieille ville qui ne s’est pas transformée au même rythme et qui n’a pu le faire. (…) Même si nous ne savions rien de l’histoire de Paris, au cours de ces années, même si nous n’avions déjà entendu dans les documents littéraires le bruit de ce grand remue-ménage, même si nous décidions de continuer notre jeu de théoricien aveugle et sourd, nous pourrions considérer qu’une telle expansion – par sa masse et sans égard au renouvellement ethnique qu’elle suppose – n’a pas pu ne pas poser de difficiles problèmes. »
Avant 1860, date de l’extension administrative de Paris dans ses limites actuelles, il y avait 12 arrondissements, numérotés, non en spirale comme aujourd’hui, mais d’ouest en est, d’abord au nord de la Seine (arrondissements I à IX) ensuite au sud (arrondissements X à XII). Louis Chevalier travaille à cette échelle de l’arrondissement et même, si possible, à celle des quartiers constitutifs de chaque arrondissement (48 quartiers en tout), voire des rues.
En 1801, la densité de la population est très différente selon les arrondissements et surtout selon les quartiers. De manière générale, ce sont les quartiers du centre qui sont les plus denses, le centre pouvant (pour de multiples raisons) être localisé précisément au niveau des halles sur la rive droite. Or la croissance très rapide et très forte de la population de 1801 à 1851 n’a pas modifié la topographie de la densité. Les quartiers les plus saturés sous l’Empire (IIIe : Saint-Eustache, Montmartre, Mail, IVe : Marchés, Banque de France, Ve : Bonne-Nouvelle, Montorgueil, VIe : Porte Saint-Denis, Lombards, VIIe : Arcis, Saint-Avoye, IXe : Cité, Île Saint-Louis, Hôtel de Ville, XIe : École de médecine, Sorbonne, XIIe : Saint-Jacques) ont connu un afflux toujours plus important de population, sous la Restauration comme sous la Monarchie de Juillet.
La densité générale passe ainsi de 159 hab./ha en 1800, à 307 hab./ha en 1846 (elle est aujourd’hui de 250 hab./ha hors bois de Vincennes et de Boulogne). Or elle était en 1800 de 1500 hab./ha dans le quartier des Arcis (!), où elle passe à 2430 hab./ha (!!) en 1846. Suivent les quartiers des Marchés, des Lombards, de Montorgueil, de la Banque de France, de Saint-Avoye, de la Porte Saint-Denis et de Bonne-Nouvelle qui dépassent tous 1000 hab./ha en 1846. Chevalier a la bonne idée de convertir ces chiffres en nombres de mètres carrés au sol par habitant : 7 m²/hab. dans le quartier des Arcis, 8 dans le quartier des Marchés. L’on y vit les uns sur les autres, dans des bâtiments qui reçoivent sans cesse de nouvelles surélévations, jusqu’à mettre leur structure en péril.
De 1801 à 1851, le solde naturel (naissances – décès) est positif, mais ne contribue que secondairement à la croissance démographique, largement liée au solde migratoire (immigrations – émigrations) : ce solde est positif de 9000 habitants par an en moyenne durant la période (+ 450 000 habitants en cinquante ans…). Si l’on ne considère que l’immigration, celle-ci représente 22 000 nouveaux habitants par an (je renonce ici à l’écriture inclusive, je reviendrai sur l’immigration féminine), 22 000 nouveaux venus ne connaissant pas la ville et voués pour près de la moitié à y rester jusqu’à la mort.
D’où viennent-ils ? Pour l’année 1850 (dont les données étaient accessibles en 1958, contrairement aux années antérieures), ils arrivent d’abord du nord de Paris (Seine-et-Oise, Seine inférieure), en second lieu des départements du Nord et de la Moselle (à peu près dans les mêmes proportions) ; ensuite d’Auvergne et de Bourgogne ; puis du Limousin et du Centre ; enfin du département du Rhône. Les Bretons n’investiront Paris que tardivement, au début du XXe siècle.
Quel âge ont-ils ? De 1801 à 1851, la part des moins de 15 ans et celle des plus de 60 ans ne cessent de diminuer (malgré l’attractivité parisienne pour le grand âge, du fait des institutions hospitalières, lieu de fin de vie inévitable pour les pauvres parisiens et pour ceux des départements limitrophes) au profit de celle des adultes de 15 à 59 ans, les plus solides du point de vue de la santé. La baisse relative des enfants indique la présence croissante de célibataires, autant qu’une augmentation de la mise en nourrice des nouveaux nés parisiens dans la campagne proche (familles bourgeoises) ou lointaine (classes « moyennes ») de Paris.
À quels milieux appartiennent-ils ? Deux sous-groupes d’adultes émergent : les moins de 30 ans et les plus de 40 ans. Les premiers et une partie des seconds représentent l’immigration domestique (au sens large, incluant tous les métiers de service), ouvrière et artisanale, l’autre partie des seconds représente l’immigration bourgeoise, celle qui revient de ses peurs des changements de régime politique. On remarque l’attraction qu’exercent sur une partie des moins de 30 ans « les professions les plus avantageuses, les moins pénibles, celles que l’évolution économique rassemble dans les quartiers des affaires, du luxe, du plaisir, alors que les quartiers de l’est et du sud se trouvent abandonnés à des tâches plus rudes et à d’autres catégories d’âges. »
Les statistiques de l’époque permettent de suivre l’évolution de la population des garnis de 1831 à 1851. Les garnis sont les logements des habitants les plus mobiles et les moins stables professionnellement, les plus humbles et les plus dangereux aussi (selon la police, qui y réalise des campagnes de contrôle régulières). Cette population ne cesse de croître de 1831 à 1846, passant de 23 150 à 50 007, bien plus vite que la population parisienne dans son ensemble. De 1846 à 1851, elle chute a contrario plus vite, le choléra y ayant fait plus de victimes. Il faut encore noter qu’en 1836, les femmes représentaient 15 % de cette population, 17 % en 1846, 21 % en 1849, après l’épidémie de choléra qui les a moins durement frappées que les hommes, et donc, dans toute la période, moins d’1/5 de la population des garnis, qui constituent bien des espaces masculins de précarité, concentrés en majorité dans les quartiers du centre.
Les femmes pauvres occupent préférentiellement les garnis de l’ouest parisien bourgeois (en lien avec la domesticité), mais aussi ceux de quelques secteurs du centre : la Cité et la Porte Saint-Denis (en lien cette fois avec la prostitution). De manière générale, l’immigration jusqu’en 1840 est nettement plus masculine que féminine, au point de rompre avec la répartition des sexes traditionnelle à la population parisienne (53 % de femmes et 47 % d’hommes, comme dans toutes les grandes villes). Ce n’est qu’à partir de 1851 que ce rapport est rétabli, mais avec un déséquilibre entre l’ouest (53 % et plus) et l’est (48 % à 50 %). De fait, de 1836 à 1851, l’immigration féminine se tourne de préférence vers les quartiers bourgeois plutôt qu’ouvriers. Les femmes adoptent une stratégie sociospatiale qui est celle des jeunes en général (dont elles font majoritairement partie). Chevalier note que les jeunes femmes qui choisissent le centre plutôt que l’ouest parisien, optent pour la voie la plus prometteuse mais aussi la plus risquée : établies d’abord dans les quartiers des théâtres, elles déménagent ensuite dans celui des banques, où elles sont logées aux frais de leurs riches amants, mais finissent le plus souvent leur carrière dans les garnis de la Porte Saint-Denis.
2) Les sources littéraires
Cet aperçu démographique reste relativement désincarné, même si l’on devine les effets de cette pression continue exercée par l’afflux de population sur le fonctionnement urbain et sur la population elle-même. Les chiffres indiqués ci-dessus n’étaient pas réservés aux seuls spécialistes : dès cette époque, ils sont régulièrement publiés et lus avec passion par un public qui découvre que l’on peut prendre la mesure du corps social. La majorité des écrivain.e.s en prennent connaissance, certain.e.s se livrent à des calculs plus ou moins compliqués et formulent des hypothèses sur les transformations de Paris. Iels en font alors la toile de fond de leurs romans ou autres productions (comptes-rendus de visites de quartiers, pamphlets politiques, etc.). Toustes ont la certitude qu’il se passe quelque chose en relation avec l’augmentation de la population parisienne, dont les pouvoirs publics prennent mal la mesure. Louis Chevalier ne s’intéresse pas aux idées que les auteurices se font de la réalité historique de leur temps (elles se fondent sur des concepts inadaptés parce qu’hérités du XVIIIe siècle), mais à ce qui, dans leur prose, déborde de cette réalité à leur insu. Le choix du corpus à étudier est déterminé autant par leur attention à caler le tableau social de leurs récits ou réflexions sur les données statistiques de l’époque, que par leur capacité à intégrer, sans le vouloir, des éléments de description de la réalité au cœur du processus de transformation de Paris.
Ce qu’il faut lire :
Honoré de Balzac, notamment La fille aux yeux d’or, 1835 ; Eugène Sue, Les mystères de Paris, 1842 ; Victor Hugo, Les misérables, 1862 (notamment les livres de la partie IV consacrés à Gavroche). Il faut lire ces textes en tenant compte du fait que, pour ces auteurs, la criminalité et le travail sont deux choses distinctes (comme le sont le mauvais et le bon pauvres depuis le XVIIe siècle). Or le fait prégnant, les statistiques criminelles le constatent, c’est la montée de la violence dans les classes populaires : le crime n’est qu’un aspect de la misère (mot de Victor Hugo), qui s’étend à des proportions inconnues jusque-là et qui lie intimement classes laborieuses et classes dangereuses.
Les enquêtes sociales, surtout, qui ont alimenté les écrivain.e.s : Claude Lachaise, Topographie médicale de Paris, 1822 ; Alexandre Parent du Châtelet, Recherches et considérations sur la rivière de Bièvre, ou des Gobelins, et sur les moyens d'améliorer son cours relativement à la salubrité publique et à l'industrie manufacturière de la ville de Paris, 1822, Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris, 1824, Recherches sur l’influence des émanations putrides sur l’altération des substances alimentaires, 1831, Les chantiers d’équarrissage de la ville de Paris, 1832, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, 1832, Rapport sur les améliorations à introduire dans les fosses d’aisance, 1835 ; Eugène Buret, De la misère et des classes laborieuses en Angleterre et en France, 1840 ; Louis René Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, 1840 ; Honoré-Antoine Frégier, Des classes dangereuses dans la population des grandes villes, 1840.
3) L’opinion publique
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les désordres sociaux étaient régulièrement attribués au vagabondage. Il suffisait d’expulser les mendiants et de fermer les portes de Paris pour se penser en sécurité. Dans la première moitié du XIXe siècle, la bourgeoisie continue d’attribuer les désordres croissants dans la ville aux immigrants, en les imaginant séparés des « vrais » parisiens, riches ou pauvres.
Eugène Sue, issu de la noblesse d’Empire, a d’abord ce type de préjugé. Dans ses Mystères de Paris, il entend mettre en scène les « sauvages » (expression tirée de sa lecture du Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper, publié en 1826), qui hantent la capitale après l’avoir investie du dehors, vivant dans ses bas-fonds une vie à part, une vie criminelle. En approfondissant son sujet, en consultant une documentation de plus en plus sérieuse et fournie, en recevant un courrier de plus en plus abondant de son lectorat, Eugène Sue se voit forcé d’évoluer dans son projet : non, les immigrants ne sont pas des « hommes libres » qui cultivent l’amoralité dans les catacombes (sic) de la capitale, d’où ils ne sortent que pour commettre des actes délictueux. À peine arrivés, ils sont pris dans le système des interactions caractéristiques des quartiers parisiens, dont l’identité est plus forte que la leur. Ils y subissent une acculturation accélérée et, face aux conditions de vie dramatiquement précaires, sombrent plus ou moins rapidement dans l’alcool, la violence, la maladie, la mort. Il ne s’agit plus de crime mais de misère, d’une misère agrippée à Paris et que l’afflux de population ne fait que renforcer car elle en résulte et s’en nourrit.
En lisant les Mystères de Paris, le peuple (petits commerçants et artisans, ouvrier.e.s, sans emploi) prend conscience de sa réalité (l’œuvre, publiée par le Journal des débats, connaît un vif succès et fait l’objet de lectures collectives) : il se met à enquêter sur lui-même et correspond activement avec l’auteur (on parle de milliers de lettres), le corrigeant et le soutenant tout en même temps. Le Journal des débats, qui assure le transit de la correspondance, crée ainsi, à l’occasion de lettres témoignant de situations tragiques, un fonds de soutien aux ménages « méritants » (il faut encore distinguer bons pauvres et mauvais pauvres, mais il s’agit plus ici de rassurer les donnateur.e.s bourgeois.e.s que de procéder à des enquêtes de moralité). C’est ainsi que la capacité du peuple à se dire à l’occasion de l’écriture en continu d’une œuvre ancrée dans la réalité populaire, a permis de réformer les préjugés de la bourgeoisie et de lui faire prendre la mesure du problème : le problème n’est pas la population criminelle, mais Paris qui ne cesse d’absorber sans parvenir à l’intégrer une population en pleine croissance.
4) De l’expansion démographique aux désordres urbains
Pour la période de la Restauration, Louis Jean Marie Daubenton est celui qui expose le mieux les problèmes liés à l’habitat, dans son Rapport relatif aux entreprises de constructions dans Paris, de 1821 à 1826, publié dans les Recherches statistiques sur la Ville de Paris et le département de la Seine, t. IV, 1829. « En 1817, le nombre des maisons, y compris les hôtels garnis, était de 27 493 ; en 1827, il était de 30 000. Ainsi la population s’est augmentée en dix ans dans la proportion de 25 % et le nombre des maisons dans la proportion de 10 %. Il est donc évident qu’il n’y a pas eu trop de maisons de construites. » Pire, on ne construit pas dans le centre, mais dans la périphérie de Paris, et on ne construit pas pour les artisans et les ouvrier.e.s mais pour la bourgeoisie et la domesticité qui lui est attachée. Or de ce point de vue, on construit trop : beaucoup d’appartements restent vides et la densité y est faible, tandis qu’on s’entasse toujours plus dans le centre.
Pendant la Monarchie de Juillet, la bourgeoisie provinciale accentue son immigration et s’installe dans les quartiers périphériques, dont la construction est ainsi relancée. On essaye bien de remédier aux problèmes les plus urgents dans le centre, mais c’est en détruisant les habitations les plus vétustes, en perçant quelques rues nouvelles, bref, en comprimant un parc immobilier déjà sous haute pression. Le Journal des débats voit dans ce déséquilibre favorable à la périphérie le moyen de désengorger le centre, en répartissant mieux la population dans l’espace. Mais l’immigration populaire converge naturellement vers le cœur battant de la capitale, où l’acclimatation semble plus facile, où elle se trouve bientôt piégée, pauvre, malade, alcoolique et incapable de s’adapter à d’autres quartiers, et où la suroccupation des logements devient la règle, ainsi que les surélévations d’immeubles périlleuses.
Se loger est difficile, mais l’espace public sur lequel s’ouvrent les logements est une source équivalente de graves difficultés. La politique déployée pendant la Restauration prolonge celle de l’Empire et ne tient pas compte de l’expansion démographique. Paris investit en renouvelant les équipements concédés et en acquérant des terrains destinés à en recevoir de nouveaux dont la concession promet d’être lucrative. En ce qui concerne les équipements qui ne rapportent pas d’argent, les efforts sont orientés, non pas vers les services sociaux, mais vers la mise en scène de sa population bourgeoise : « nouvelles églises, nouveaux hôtels, nouveaux palais, nouveaux théâtres, luxueux passages agrémentant les grands quartiers d’affaires. La ville s’est aménagée en fonction du confort, du luxe et de la beauté. Par la volonté des pouvoirs publics, mais aussi par celle d’une bourgeoisie vaniteuse, gaspilleuse, tourmentée de paraître. » « Au vieux programme appartiennent également bien des travaux utiles : des ponts, des marchés couverts, des trottoirs, de nouvelles fontaines publiques, les premières installations d’éclairage au gaz, des canaux et, à partir de 1828, les premiers préparatifs de distribution d’eau à domicile. » Mais ces travaux accompagnent principalement le développement des quartiers périphériques bourgeois. Ainsi le centre aux rues étroites n’est pas adapté à la création de trottoirs qui réduisent les capacités de charroi, alors que celui-ci est en pleine expansion suite à l’augmentation de la circulation des marchandises et que le centre, reliant tous les arrondissements entre eux, en est le passage obligé. Les pouvoirs publics ne prennent pas non plus la mesure des besoins liés à l’hygiène : les servitudes d’éloignement des voiries (lieux où l'on porte les ordures, les immondices, les vidanges, les fumiers et les débris d'animaux que les pluies sont supposées emporter) et des cloaques (où aboutissent les voiries et qui conduisent les déchets vers la Seine en aval de Paris), établies aux XVIIe et XVIIIe siècles, sautent sous la pression urbaine. Parent-Duchâtelet évoque deux cas typiques à la fin de la Restauration :
Au sujet de la voirie de Ménilmontant (VIIIe arrondissement, quartier Popincourt) : « Les nombreux habitants des maisons qui avaient été construites tout autour, voyant que leurs plaintes (au sujet de la saleté de la voirie, ndlr) n’avaient pas été écoutées, expulsèrent les tombereaux du nettoiement (les bennes à ordures, ndlr) ; leurs plaintes étaient appuyées par l’état-major du 7e régiment caserné dans le voisinage. Je n’entrerai pas dans les détails sur l’alarme que cette affaire répandit dans Paris, qui se crut un moment envahi par la peste. Ces boues, ne pouvant plus être portées dans cette voirie de Ménilmontant, furent dirigées sur celle de Montreuil (plus à l’est, ndlr) qui ne tarda pas à être si encombrée que les immondices s’élevèrent de 4 à 5 mètres au-dessus du niveau de la route. Avec la chaleur intense et les orages, la fermentation incommode les restaurateurs, gargotiers et marchands de vin qui se trouvent en grand nombre dans les environs. »
Au sujet de l’égout Amelot (toujours dans le VIIIe arrondissement) : « Les vases entraînées par les eaux pluviales et ménagères s’y étaient accumulées. L’infection qui en résultait pour les habitants du quartier était d’autant plus grande que de nombreux nourrisseurs habitaient dans le voisinage ; il suffisait de rester quelques instants à l’embouchure de l’égout dans les fossés de la Bastille pour sentir monter une odeur de vacherie et d’urine d’animaux. Toutes les tentatives antérieurement faites pour opérer le dégorgement de l’égout avaient échoué ; la plupart des ouvriers avaient été asphyxiés, il y avait eu des morts. L’égout avait donc été abandonné à lui-même et avait acquis parmi les ouvriers une réputation telle que lorsqu’ils voulaient donner l’idée d’un cloaque dangereux, ils le comparaient à celui de la rue Amelot. Mais bientôt l’égout déborda ; les eaux restèrent sur le sol des rues, pénétrèrent dans les cours et les caves des maisons. »
La Monarchie de Juillet est d’emblée confrontée à la crise sanitaire du choléra de 1832. L’opinion publique fait immédiatement le lien avec la question de la salubrité. Ainsi le Journal des débats : « Des 48 quartiers de la capitale, 28 placés au centre ne comprennent que le cinquième de son territoire et renferment à eux seuls la moitié de la population. Dans 35 de ces quartiers, 180 rues contiennent 146 430 habitants ; dans ces quartiers il en est un, celui des Arcis, où chaque individu ne dispose que de 7 mètres carrés d’espace ; et dans ces rues il en est jusqu’à 73 qui renferment, terme moyen, 30, 40 et 60 personnes par maison. Ce sont ces rues qui, toutes sans exception, ont eu 45 décès sur 1000, ce qui est le double de la moyenne ; ce sont ces maisons, la plupart hautes de 5 étages, larges de 6 à 7 mètres de façade et n’ayant point de cours, qui ont donné 4, 6 et jusqu’à 10 et 11 décès, parce que nulle autre part l’espace n’est plus étroit, la population plus pressée, l’air plus malsain, l’habitation plus dangereuse et l’habitant plus misérable. » Chevalier résume la suite de l’article : « Suivent des remarques du même ordre concernant l’étroitesse et l’embouteillage des rues, la hauteur excessive des maisons nouvelles qui rendent ces rues obscures, sales et humides, le mauvais système de nettoiement, le trop petit nombre de bornes-fontaines qui fait que l’habitant de Paris dispose à peine de 7 litres d’eau (par jour, ndlr), alors que celui de Londres en a 62, enfin l’insuffisance des égouts. Tout un programme nouveau d’équipement se trouve ainsi défini. Il ne sera plus possible de l’ignorer. » Cependant les pouvoirs publics, engagés au cours de la période précédente dans d’autres travaux, contraints par un cadre budgétaire relativement figé, ne peuvent augmenter les dépenses sociales et se contentent d’actions ponctuelles. Les succès obtenus sont largement insuffisants et conduisent à la nouvelle crise politique et sanitaire des années 1848-1852.
5) L’hôpital et le secours aux indigents, l’ampleur du désastre
Les pouvoirs publics limitent leur politique de lutte contre la pauvreté pour les raisons qu’on a vues. Le système adopté depuis l’Empire est celui des listes d’indigent.e.s admis.es au secours à domicile. Sous l’Empire leur nombre s’élevait à 100 000 environ. La Restauration a rapidement ramené ce chiffre à 70 000 environ, maintenu sous la Monarchie de Juillet. De plus en plus, selon la logique du « ciblage » des besoins, ne sont plus secourus que ceux qui n’ont absolument aucun moyen de survivre hors du régime d’aide, ceux dont l’état physique est le plus précaire. Ces listes, grâce aux renseignements qu’elles contiennent, permettent d’identifier les types de populations les plus en difficulté. Ainsi, pour l’année 1836 :
Les hommes admis au secours sont dans l’ordre décroissant : les ouvriers et les journaliers de divers états, les ouvriers en bâtiment, les portiers (cf. la « maladie des portiers »), les sans état, les commissionnaires, etc.
Les femmes admises au secours sont dans l’ordre décroissant : les ouvrières et journalières de divers états, les sans état, les ouvrières à l’aiguille, les marchandes revendeuses, etc.
Ces profils sont ceux des victimes du choléra. Les 2/3 sont des immigrant.e.s. Iels sont au chômage ou travaillent soit dans l’espace public insalubre, soit dans des locaux confinés des quartiers les plus denses.
Mais la misère est telle que les institutions en charge du soutien à domicile sont rapidement débordées et doivent développer un service d’urgence sociale accueillant ponctuellement les personnes dont la situation s’est brutalement précarisée. De novembre 1830 à juillet 1831, le Journal des débats rapporte que le nombre de ces bénéficiaires, de 100 129, a progressé jusqu’à atteindre 227 399 individus, sur une population parisienne totale de 755 000 habitants, soit 30 % !
Entre les chiffres avancés par les médias populaires et ceux produits par les institutions, chacun fait le choix qui l’arrange : la bourgeoisie s’en tient aux seconds, le peuple aux premiers. En 1837, la polémique sur les chiffres est relancée : le préfet de la Seine conteste les 12 % d’indigent.e.s de la presse bourgeoise qu’il juge trop bas. Eugène Buret, économiste, sociologue et journaliste, conçoit alors une méthode pour estimer leur nombre à Paris (méthode reprise par Chevalier pour l’ensemble de la période). Il part du fait que l’hôpital est un repoussoir pour toute la population parisienne : aller à l’hôpital, c’est aller à la mort et mourir dans d’affreuses conditions. Toutes les classes sociales partagent cette opinion. Balzac et Sue confirment la chose. Son hypothèse est donc que les personnes qui meurent à l’hôpital font partie des indigent.e.s qui n’ont pas d’autre choix que de s’y rendre. Or en 1836, il y a eu 9034 décès à l’hôpital pour 24 057 décès au total, soit plus du tiers. Pour reconstituer la population indigente, il fait de surcroît l’hypothèse que celle-ci vit moins longtemps que les autres : alors qu’il meurt en moyenne par an à Paris 1 personne sur 36 environ (24 000 personnes sur 880 000 habitants estimés par Buret au vu des recensements), il meurt en moyenne 1 indigent sur 26 environ. « Ce calcul nous semble plus sûr pour obtenir la véritable population indigente, que celui basé sur le secours à domicile. Il est vrai que, d’après cette méthode d’évaluation, le rapport de l’indigence de la population s’élève au chiffre de 1 sur 4 habitants 20 centièmes, au lieu d’être seulement de 1 sur 12 habitants 32 centièmes. » Le chiffre ainsi obtenu est de 238 000 indigents. Il dépasse de loin les évaluations de la bourgeoisie et se rapproche de celles des journaux populaires.
Louis Chevalier complète : « L’application du mode d’évaluation de Buret à l’ensemble de notre époque situe la misère à un chiffre considérablement supérieur à celui des statistiques de l’indigence : 238 000 personnes en 1836 pour une population de 900 000 individus (26,4 %, ndlr) ; mais, dans les dernières années de la Restauration, près de 350 000 pour une population de 750 000 individus (46,7 %, ndlr) ; et, en 1830 et en 1831, c’est-à-dire antérieurement à la mortalité cholérique, 420 000 pour une population qui, en 1831, est de 755 000 individus (55,6 % ! ndlr). Si les chiffres s’abaissent entre 1840 et 1846 au quart de la population (25 %, ndlr), il s’élèvent à nouveau au tiers (33 %, ndlr) à partir de 1846. Misère monstrueuse en somme et en permanence : s’exaspérant aux moments les plus forts des crises et acculant à la faim, à la maladie et à la mort, près de la moitié de la population de Paris, c’est-à-dire la quasi-totalité de la population ouvrière, mais sévissant aussi en période normale et ne s’abaissant jamais beaucoup au-dessous du quart de la population totale, c’est-à-dire englobant encore une grande partie des effectifs ouvriers. »
6) La violence : lieux et comportements
Il existe à proximité immédiate de Paris un lieu qui condense l’horreur urbaine : Montfaucon, derrière la Porte Saint-Martin dans le Ve arrondissement (actuellement à proximité de la place du Colonel-Fabien). La mort y règne dans tous ses états. Un gibet royal y a été établi dès le XIe siècle. Au XIIIe siècle, il est reconstruit en pierre de taille. Au XIVe siècle, il est doté de 16 « fourches patibulaires », une par quartier de Paris, où sont pendu.e.s et exposé.e.s pendant plusieurs mois les criminel.le.s « exemplaires » (pour l’édification des foules). Au XVIIe siècle, alors que le gibet cesse d’être utilisé (par la volonté d’Henri IV qui y avait vu les corps des protestants massacrés pendant la Saint-Barthélémy), le dépôt des vidanges et des bêtes mortes se développe non loin. Ce lien gibet-ordure est ancien : les cadavres décrochés étaient entassés dans une fosse en contrebas, qui était régulièrement curée, à la manière d’une fosse d’aisance, pour bien marquer la perte d’humanité qu’entraîne l’exposition. En 1760, le gibet est démoli et reconstruit à 300 mètres de là, à proximité de la nouvelle voirie de Montfaucon, comme un symbole de la haute justice royale. En 1789, le monument est abattu et ses énormes blocs sont employés à la voirie, formant le parapet le long duquel s’arrêtent les voitures des vidangeurs : l’ordure a absorbé le gibet. Au XIXe siècle, Montfaucon devient le plus vaste espace de dépôt de déchets de la capitale ; il accueille de surcroît les chantiers d’équarrissage et bientôt des usines chimiques. En voici le tableau :
Parent-Duchâtelet, 1833 : « De cette augmentation de la population sont nées deux causes qui, agissant sans cesse concurremment, ont fait disparaître les avantages que nos pères avaient procurés de la ville et y ont produit un état de choses qui, à l’époque actuelle, approche de la barbarie et qui, soit à l’intérieur de Paris, soit dans les villages qui l’entourent, est devenu intolérable à plus de 100 000 individus. Les deux causes tiennent d’une part à l’agrandissement de Paris, d’autre part à l’augmentation de la masse des matières susceptibles de produire des émanations infectes. Les bassins seuls de cette voirie (de Montfaucon, ndlr) ont 3,2 ha de superficie, sans compter 12 arpents (environ 5 ha, ndlr) occupés par les matières sèches et les chantiers d’équarrissage ; on y apporte par jour de 230 à 244 m³ de produits de fosse d’aisance et on laisse pourrir sur le sol la majeure partie des cadavres de 12 000 chevaux et de 25 à 30 000 petits animaux. »
Chevalier complète : « Les issues (les viscères, ndlr) pourrissent sur place, entassées sur près de 1,5 m de haut, jusqu’au moment des labours, où les paysans viennent y chercher leurs engrais ; les ossements sont brûlés ; les peaux sont enlevées tous les deux ou trois jours par les tanneurs de la Bièvre. Mais dans les environs se sont installés des boyauderies et des ateliers de produits chimiques dont les eaux traversent les marais pour couler à l’air libre vers la rue Grange-aux-belles et parvenir à l’égout de la ville rue des Marais. Autour du charnier, les rats : tellement nombreux qu’il suffit de mettre les carcasses de chevaux équarris dans la journée dans un coin quelconque du clos, pour les trouver le lendemain matin entièrement dépouillées ; minant les collines voisines et faisant crouler les maisons. »
Encore Parent-Duchâtelet : « Qu’on se figure ce que peut produire la décomposition putride de monceaux de chairs et d’intestins abandonnés pendant des semaines ou des mois, en plein air et à l’ardeur du soleil, à la putréfaction spontanée ; qu’on y ajoute, par la pensée, la nature des gaz qui peuvent sortir de monceaux de carcasses qui restent garnies de beaucoup de parties molles ; qu’on y joigne les émanations que fournit un terrain qui, pendant des années, a été imbibé de sang et de liquides animaux ; celles qui proviennent de ce sang lui-même qui, dans l’un et dans l’autre clos, reste sur le pavé sans pouvoir s’écouler ; celle enfin des ruisseaux des boyauderies et des séchoirs du voisinage ; que l’on multiplie autant que l’on voudra les degrés de la puanteur, en la comparant à celle que chacun de nous a été à même de sentir en passant auprès des cadavres d’animaux en décomposition qu’il aura pu rencontrer, et l’on n’aura qu’une faible idée de l’odeur véritablement repoussante qui sort de ce cloaque, le plus infect qu’il soit possible d’imaginer. »
Nouveau commentaire de Chevalier : « Le charme de la banlieue s’en trouve détruit, ainsi que la promenade habituelle des Parisiens à Belleville, au Pré-Saint-Gervais, et sur les bords du canal de l’Ourcq. »
Conclusion de Parent-Duchâtelet, 1835 : « Montfaucon ne peut plus subsister ; la population de Paris et celle des environs le repoussent et l’opinion publique se manifeste contre lui d’une manière trop énergique ; il est pour Paris une plaie dont cette ville rougit et que lui reprochent les étrangers qui entrent dans nos murs. » Il faudra revoir l’aménagement du territoire parisien de fond en comble avant de réussir à éliminer Montfaucon, ce qui prendra des décennies.
À proximité immédiate de Montfaucon, la Porte de Combat abrite une attraction datant de 1778 et mettant en scène des combats d’animaux, héritière de ces jeux aristocratiques où l’on s’amusait à faire combattre les animaux les plus exotiques et les plus nobles. Jules Janin, dans sa nouvelle publiée en 1829, L’âne mort et la femme guillotinée, évoque ces spectacles qui n’ont plus rien de noble (des molosses massacrent brutalement un vieil âne fatigué), auxquels assistent désormais les ouvriers des ateliers d’équarrissage voisins et non plus les membres de la noblesse.
Louis Chevalier fait état de la culture populaire de la violence qui se développe à Paris durant la Restauration et la Monarchie de Juillet.
Sous la Restauration, la violence urbaine est avant tout liée au compagnonnage. Les compagnons possèdent une forte culture de groupe, qui se traduit par des combats rituels entre associations (compagnons du devoir, compagnons de la liberté, etc.) ou entre métiers au sein d’une même association. À Paris, carrefour de tous les « tours de France », ces violences sont décuplées par le nombre de compagnons qui y séjournent : les combats, qui font beaucoup de blessés et souvent des morts, se déroulent si possible extra-muros (ainsi celui qui oppose 400 bouchers à 100 boulangers). Cette violence reste en quelque sorte extérieure à la ville. Pourtant, elle inspire le monde ouvrier parisien. Michel Casseux, dit Pisseux, ouvre la première école de savate en 1825, bientôt suivie par d’autres. Il s’agit avant tout d’y apprendre à se défendre, en repérant les types d’agresseurs (notamment les domestiques qui constituent la garde personnelle de leurs maîtres…) et en appliquant des parades appropriées. Le succès est immédiat et traduit l’importance des tensions dans l’espace public.
Sous la Monarchie de Juillet, Paris a pris le dessus sur le compagnonnage : les compagnons qui arrivent dans la capitale s’y intègrent et perdent de vue les pratiques rituelles liées à leur profession. Mais s’y intégrer, c’est inévitablement chuter, dans la maladie, l’alcool et finalement le chômage. La violence urbaine ne disparaît pas, bien au contraire. Tandis que la savate reçoit ses lettres de noblesse en devenant un sport à la mode pour la bourgeoisie, le monde ouvrier abandonne les règles d’honneur qui régissaient les conflits dans la période précédente. On passe du chausson au couteau. La tension urbaine devenue trop forte ne parvient plus à se réguler. La révolution de 1848 n’est de ce point de vue que la subite convergence d’une conflictualité devenue inhérente à l’espace public.
Conclusion : classes laborieuses et classes dangereuses
Le XIXe siècle commençant nomme « classes dangereuses » la partie de la population marquée à la fois par la précarité (population en danger) et par le crime (population dangereuse). On y range le vagabondage et la prostitution, deux faces d’une même réalité précaire et criminelle (le vagabond vole, éventuellement tue, puis dépense tout à la taverne où sont rassemblées les prostituées, et ainsi de suite, selon le cycle économique propre au crime). Quant aux « classes laborieuses », elles désignent la partie de la population qui gagne sa vie en travaillant, du petit commerçant à la couturière et au manœuvre : elle a ses vices qui l’empêchent de s’élever socialement aussi vite qu’il serait souhaitable, mais elle est méritante, au vu de ses conditions de vie qu’on reconnaît difficiles, surtout à Paris, avec ses quartiers centraux aux rues trop étroites, etc.
Le siècle avançant, il devient de plus en plus compliqué de distinguer à Paris les classes dangereuses et les classes laborieuses. Le vagabondage des XVIIe et XVIIIe siècles s’est mué en flux migratoire massif où l’immigration l’emporte largement sur l’émigration. La précarité ne cesse de croître au sein des classes laborieuses, mises en danger par Paris même qui ne parvient plus à leur fournir un cadre de vie décent, qui leur impose au contraire un cadre de vie si indécent qu’il imprime à toute la population un mouvement vers le bas, de la maladie au chômage et à la mort. La violence urbaine accompagne la densification extrême de la ville ; les logements suroccupés et les espaces publics surpeuplés sont meurtriers, terrains de prédilection pour le choléra. La misère est dans tous les cas la première cause de la mort parisienne. Les formes que celle-ci prend sont multiples : règlement de compte, infanticide, suicide, féminicide (à relier au concubinage généralisé, qui régule en temps normal les relations interpersonnelles dans une population très mobile, mais ne fonctionne plus en temps de crise où les hommes, se sentant de toute part menacés dans leur honneur, placent ce qu’il en reste dans leurs concubines). Les classes dangereuses et les classes laborieuses sont devenues indiscernables.
À l’époque où écrit Louis Chevalier, même si la région parisienne connaît une croissance exceptionnelle, les problèmes que pose celle-ci ne sont plus du tout les mêmes que dans le Paris de la première moitié du XIXe siècle. La principale différence est que la région parisienne en 1958 tient ses promesses aux immigrant.e.s, qui, pour la majorité, y élèvent notablement leur niveau de vie. Par ailleurs, la menace de dysfonctionnements urbains est prise très au sérieux par les pouvoirs publics : les projets de création d’un marché d’intérêt national à Rungis, d’un boulevard périphérique et de villes nouvelles datent de cette époque. L’explosion démographique des grandes capitales du « tiers-monde » correspond mieux a priori au modèle historique du Paris du XIXe siècle. Chevalier insiste cependant sur ce qu’il appelle le « fondement biologique » de l’histoire sociale. Les transformations sociales que repère la science historique trouvent leur origine et leur fin dans la « biologie », dans l’état physique des populations, dans la qualité de leurs relations au milieu, notamment vivant. Il note alors que, dans la société française des Trente Glorieuses, de nouvelles « classes » à la fois laborieuses et dangereuses pourraient émerger si l’on n’y prend garde. Ainsi l’immigration étrangère organisée par l’État pour le travail ouvrier (en provenance d’Italie, de Pologne, du Portugal et d’Algérie), tout en étant forcée de s’intégrer en perdant ses caractères culturels propres, ne bénéficie pas des mêmes chances de progression que les Français et Françaises « de souche ». Le cas des bidonvilles est à ce titre préoccupant, car ils concentrent des populations dont les chances de progression sont nulles.
Si l’étude du Paris de la première moitié du XIXe siècle autorise Chevalier à un discours critique sur la société française des années 50, sa santé et les menaces qui pèsent sur elle, qu’en est-il donc aujourd’hui ? Qu’est-ce que la lecture de Classes dangereuses et classes laborieuses permet de dire sur notre époque actuelle ? En adoptant ses outils d’analyse et sa typologie des maux susceptibles d’affecter une population, il me semble, en 2023, en repérer 5 principaux :
Les âgismes. La méthode employée par Chevalier permet de lier précarité et mortalité épidémique. Des canicules aux Covid, les victimes de surmortalité depuis vingt ans sont principalement les personnes qui ont dépassé l’âge légal de la retraite. Cette surmortalité traduit bien la précarité de cette classe sociale. Le fait qu’elle ait été particulièrement marquée en EHPAD indique que cette précarité est liée à la décomposition des liens familiaux et au « sacrifice » des personnes les plus avancées en âge (dans une logique « ménage contre lignage »). Existe d’autre part, à un moindre degré, un âgisme concernant les jeunes. Je l’ai déjà évoqué dans un article antérieur (https://gnathaena.blogspot.com/2020/12/bourdieu-1-les-jeunes.html). Ses conséquences sont aussi d’ordre biologique, avec une évidente surmortalité et plus généralement des problèmes accrus de santé, y compris psychique.
Les relégations. Aujourd’hui des secteurs géographiques font se côtoyer le travail et le crime, pour ainsi dire indépendamment de celleux qui y habitent et de celleux qui les administrent, comme régis par un malin genius loci (cf. Pierre Sansot qui s’inspire là de Chevalier) rendant brutale l’administration, violente sa population, voyeurs les médias. Espaces bien délimités des « quartiers politique de la ville » d’un côté, espaces sans limites de la ruralité inculte de l’autre. S’il a été possible, dans les années 70, de faire table rase de pans entiers, insalubres et vétustes, des XIIe, XIIIe, XIXe, XXe arrondissements, avec un certain succès pour ce qui est de l’amélioration du cadre de vie, il n’en est pas de même des QPV, quoi que l’ANRU ait pu faire et malgré l’importance des moyens consacrés. Et ne parlons pas de la ruralité profonde, dont la réalité est plus mythique que sociologique. Ces deux types d’espaces de relégation ont en commun de ne pas permettre l’ascension sociale autant qu’ailleurs. Ils sont en outre marqués par une économie sociale sans rapport avec l’économie caractéristique de la classe moyenne, chacun.e étant surendetté.e à l’égard de toustes. Espaces de minoration, leurs habitant.e.s n’ont de droit que pour autant qu’iels se trouvent sous tutelle administrative. Crises des Gilets jaunes et crises des banlieues sont les deux symptômes du dysfonctionnement sociospatial du territoire français.
Les racismes. Confirmant les craintes de Louis Chevalier, l’immigration ouvrière amorcée dans les années 1950 a suscité la montée d’une xénophobie dans les couches les plus fragiles de la population française. Alimentée par les anciens combattants des guerres de décolonisation, elle s’est doublée d’un racisme post-colonialiste. La ligne politique de l’intégration impose aux immigrant.e.s de renier, au moins en apparence, leur appartenance ethnique, ce qui leur fait jouer le jeu du racisme qui dévalorise celle-ci. Lorsque la pression raciste croît, que les réseaux d’appartenance ne peuvent plus rester dans l’invisibilité et s’organisent pour résister, c’est l’administration républicaine qui brandit la bannière de l’intégration et qui réimpose le déni d’appartenance. Il y a clairement un cercle vicieux, que Chevalier a bien établi dans le cas des compagnonnages, dont l’intégration a signifié la désintégration.
Les féminicides. Le féminisme militant, loin de se réduire à une mode passagère, est un symptôme du renforcement de la domination masculine à l’égard des femmes. Le mouvement Me too en témoigne : il met à jour toute une époque d’exploitation sexuelle des femmes qui remonte bien au-delà des délais de prescriptions judiciaires. Cette exploitation s’est accompagnée d’une évidente surmortalité féminine dans toutes les classes sociales, que ce soit par suicide ou par assassinat. Le virilisme entretenu par le personnel politique s’oppose à la résolution de cette crise à répétition, pourtant portée par l’administration.
Les biocides. Louis Chevalier est un « environnementaliste », il pense d’abord l’être humain dans son aspect biologique, en relation avec son environnement. Les quartiers du centre de Paris du XIXe siècle sont nocifs au vivant qui s’y attarde, qu’il soit humain, animal ou végétal, témoin la brume éternelle qui plane sur la ville. Au-delà du centre, les espaces où convergent les déjections expriment la tragédie des corps, en particulier animaux. Le contexte a bien changé : les noirs nuages de pollution ont laissé place aux intangibles gaz à effet de serre, l’être humain n’est plus directement affaibli par ses propres émanations, mais son rapport au vivant est toujours le même. En conflit avec la biodiversité dans son ensemble, son paradis dépend de l’exploitation de la vie dans toutes ses dimensions. Cela signifie que la crise biologique du XIXe siècle est toujours d’actualité : séparé de son environnement, le corps humain est devenu une anomalie vis-à-vis des autres êtres vivants, soit exploités à l’extrême (animaux de boucherie disparaissant entièrement dans le processus de transformation agro-industrielle, etc.), soit rejetés et détruits selon une logique xénophobe (végétaux dits « invasifs », « adventices » / « qui vient de l’extérieur », animaux sauvages « régulés » par la chasse, etc.).
Ces maux disposent d’un mode de régulation consistant, en substance, à en faire succéder les manifestations sans qu’elles puissent cumuler leurs effets. Gilets jaunes, actionnisme écologique, protestation féministe, crise sanitaire, soulèvement des banlieues, etc. se suivent sans se donner la main. Les médias jouent le jeu de bon cœur. Si cette course-poursuite met un voile sur les tensions biologiques et topologiques sous-jacentes, celles-ci n’en existent pas moins. Leur vécu concerne d’abord un noyau dur, qu’on pourrait qualifier d’intersectionnel (le groupe formé par les femmes racisées, jeunes ou vieilles, des zones de relégation), toujours sous tension, puis d’un champ d’extension critique potentiel, qui renvoie non plus à l’intersection mais à la réunion des horizons de tension (femme racisée bourgeoise, homme blanc âgé de la ruralité profonde…), qui aboutit à former un ensemble beaucoup plus vaste.
La cause de ces maux est-elle encore d’ordre démographique ? Il est frappant que depuis un siècle ce soit la population mondiale dans son ensemble qui connaisse une croissance fulgurante (doublement entre 1927 et 1974, doublement encore entre 1974 et 2023 : les taux sont identiques à ceux de la population parisienne entre 1800 et 1850). En transposant l’analyse de Chevalier à cette échelle, l’on vérifierait aisément que cette réalité, couplée à l’incapacité des États à s’y adapter, conduit à des crises biologiques extrêmes. Les âgismes, les racismes et les biocides nationaux se nourrissent à cette source mondiale : la chose est évidente pour les pandémies, pour le climat et la biodiversité, et malheureusement pour le rejet des migrant.e.s.
Trois des cinq maux de la société française sont ainsi causés par l’incapacité de l’État à s’adapter à l’essor démographique mondial. L’incurie et l’immobilisme d’État résonnent alors avec les phobies sociétales, et rien ne se passe alors que la santé et l’écologie devraient être les premières préoccupations nationales, et que la France devrait assumer son rôle de pôle (secondaire) d’attractivité mondial.
Quant aux espaces de relégation, ils ne renvoient que de manière indirecte à la croissance démographique mondiale. Ils résultent d’abord du desserrement de l’habitat et de la fuite des classes moyennes dans le pavillonnaire périurbain, à l’instar des suburbs américains. Ruralité, centres urbains et grands ensembles concentrent celleux qui n’ont pu suivre les classes moyennes : le prolétariat et le sous-prolétariat français. Les centres urbains restant majoritairement mixtes, leur population déclassée n’y est stigmatisée que dans certains quartiers anciens, marqués par une forte dégradation. L’apparition de « mauvais génies des lieux » dans ces espaces n’est pas fortuit, elle est liée à la phobie du prolétariat et du sous-prolétariat dans une société décidée à assumer son capitalisme économique et politique, mais pas ses effets (l’exploitation de la force de travail).
Les racines des féminicides sont elles aussi mondiales : elles se déploient depuis plusieurs millénaires en même temps que la croissance démographique humaine. Celle des XXe et XXIe siècles ne les motive pas plus que celles plus anciennes. Ce mal humain est premier et commande tous les autres : tant que l’humanité minore sa moitié reproductrice, elle ne peut rien comprendre de son environnement et ne cesse de démultiplier à l’infini la logique de la minoration.
Dans l’ensemble, tous ces maux, qu’ils soient déterminés ou non par l’actuelle pression démographique mondiale, relèvent de cercles vicieux établis entre l’image sociale du groupe biologique ou topologique dévalué et les comportements à la fois du groupe, de l’administration dont il relève et des médias, qui valident cette image, lui donnent chair, lui confère une réalité que la société ne peut ensuite dépasser sans beaucoup d’effort. La France est inadaptée à cause de son incapacité à rompre ces cercles entre représentations et comportements. Cette leçon, Chevalier ne la désavouerait pas.
J’ajouterais, quant à moi, que l’on ne peut espérer guérir de ces maux qu’en rompant avec les institutions sociales qui les entretiennent. Seule la culture peut y parvenir, une culture de l’inclusion biologique et topologique, autant dire le chaos pour toustes celleux qui soutiennent et font fonctionner les institutions vicieuses de la société française.