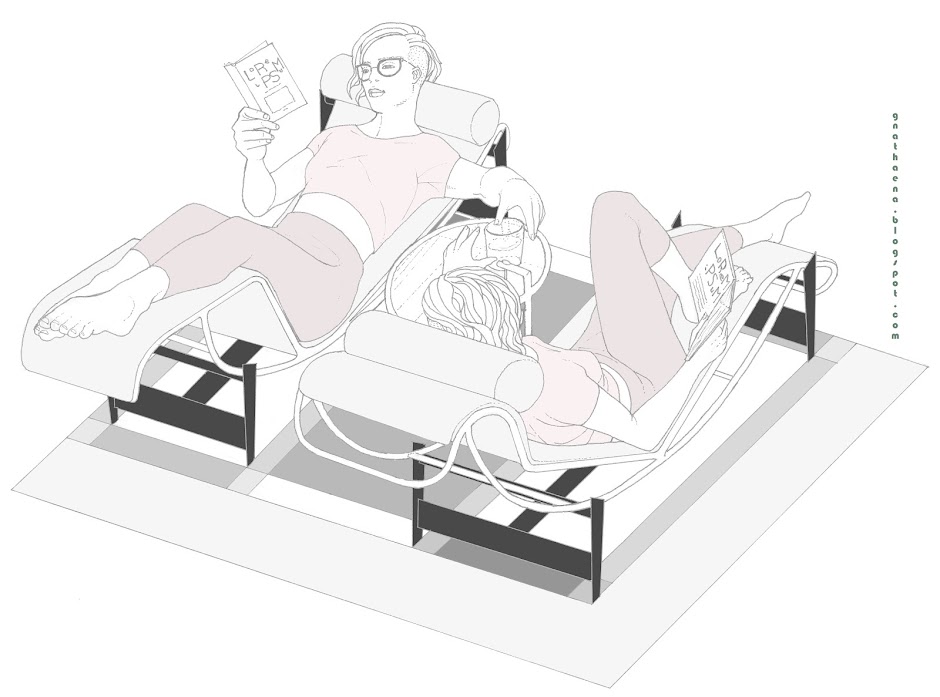Dans
ses deux cours consacrés au pouvoir psychiatrique (1973-74) et aux
anormaux (1975), Michel Foucault s'attache à montrer comment les
sociétés européennes se sont dotées de techniques
disciplinaires normalisatrices allant bien au-delà de ce que
réclamait la transformation des classes populaires en capital humain
disponible pour l'industrie bourgeoise. Elles les ont mises au
service de la performance économique, militaire, culturelle des
États, autant qu'appliquées par principe à tous les moments de la
vie des individus, en particulier les plus intimes, sans autre
finalité que d'exercer indéfiniment sur elles-mêmes
le pouvoir de discipliner. L'argument de la menace intérieure
permet de justifier auprès de l'opinion publique cette extension du
champ de la discipline dépourvue de toute utilité sociale. D'abord
vide de contenu, la menace intérieure trouve rapidement son objet
dans le contre-pouvoir qui naît et s'organise systématiquement face
au processus de normalisation, contre-pouvoir dont l'anormalité
apparaît alors à l'opinion comme monstrueuse et qu'il s'agit
d'éliminer au plus vite. Du fait de la pression excessive de la
normalisation disciplinaire, de nombreux foyers de résistance se
sont constamment allumés du XVIe au XXe siècle et ont donné lieu à
des figures toujours plus variées de l'anormal.
Avec
la sorcière aux XVIe et XVIIe siècles, avec la possédée aux XVIIe
et XVIIIe siècles, avec l'hystérique au XIXe siècle s'affirme une
résistance au féminin à trois formes successives d’application
du pouvoir normatif sur la société et
sur les corps. Dans le cas de la sorcellerie et de la
possession, les pouvoirs politiques et religieux ont été amenés à
réviser leur stratégie de normalisation, à réajuster les
techniques d'assujettissement et à transférer les cas limites à la
psychiatrie naissante.
L'hystérique, pour sa part, pur produit de celle-ci, s'est retournée
contre elle et n'a pu être
neutralisée que par l'adoption d'une ultime stratégie, qui a
consisté à se concentrer sur un sujet de normalisation plus
inoffensif et malléable : l'enfant.
Cette
gynomachie étonne, tant il est commun de se représenter la
lutte des pouvoirs sociaux du XVIe au XXe siècles comme une lutte
des classes où les femmes
tiennent infailliblement le second rôle.
L'exercice
du pouvoir normatif s'apparente
davantage au contrôle
que les hommes font peser continuellement sur les femmes depuis des
millénaires, qu'à celui
qu'ils pratiquent entre eux par épisodes pour prévenir une
dévirilisation toujours possible. S'il s'applique également
aux deux sexes (ainsi qu'aux différentes classes sociales), il les
affecte différemment, puisque les femmes, pour qui il est familier,
savent mieux y répondre, non pas pour en atténuer ou en adoucir les
effets (comme les hommes l'imaginent trop souvent), mais pour le
mettre en contradiction et le forcer à changer de stratégie.
C'est ce que l'on attend d'un acte de résistance véritable,
résistance dont les femmes semblent avoir été les fers de lance
vis-à-vis du pouvoir normatif.
➤ Les
sorcières
La
formation conjointe des États européens au cours des XVIe et XVIIe
siècles s'est accompagnée d'une pression forte sur les modes de vie
de leurs populations, encore très hétérogènes, pour les adapter
aux exigences modernes des nations en concurrence. Il s'agit
essentiellement de mobiliser toutes les ressources humaines
susceptibles de contribuer à l'essor de l'économie nationale
marchande et agricole. Cela se traduit diversement selon les régions.
Les plus éloignées du modèle d'une ruralité soumise aux polarités
urbaines sont celles qui
subissent la pression maximale.
La
chasse aux vagabonds et aux bandits de grand chemin initiée à cette
époque répond simultanément à trois enjeux : de sécurité
publique (maîtrise des routes et conquête des marges
territoriales), économique (fixation des individus dans une carrière
professionnelle) et militaire (création de l'armée royale). En
réalité, vagabonds et bandits sont des termes qui servent à
disqualifier et à criminaliser toute une population intéressée à
la guerre, formée de mercenaires toujours en transit entre deux
théâtres d'opération, jusqu'alors parfaitement intégrée à la
société et qu'on veut voir désormais disparaître. Si les
individus qu'on arrête s'avouent
tels, ils donnent corps à ces personnages créés de toutes
pièces et justifient le
processus d'éradication.
Il
en va de même pour les sorcières. Mais alors que les vagabonds et
les bandits ont encore aujourd'hui un statut légal aux implications
judiciaires immédiates, ce n'est plus leur cas. Que s'est-il donc
passé ?
Deux
grandes vagues de sorcellerie en Europe : de 1480 à 1520 et de 1560
à 1650. Entre 50.000 et 100.000 procès engagés par l'Inquisition
dans les pays catholiques, par les tribunaux laïques chez les
Réformé.e.s. Les
victimes sont à 80% des femmes, les 20% restants sont principalement
des vagabonds. Les territoires majoritairement concernés sont les
marges rurales vivant en quasi-autarcie.
Deux
motifs jouent dans la lutte contre la sorcellerie : un motif
religieux (anéantissement du paganisme et des religions
pré-chrétiennes qui subsistent dans ces marges) et un motif
culturel (unification des modes de vie locaux autour d'un ordre
social chrétien urbain). L'Église est l'instrument essentiel
de cette lutte et de cette homogénéisation. Elle est en effet, à
cette époque, en train de resserrer son
emprise sur la population citadine, par le maillage des paroisses et
un meilleur suivi par les prêtres de leurs ouailles (notamment grâce
à l'instauration du confessionnal, moyen de contrôle d'une terrible
efficacité !). Elle est à la pointe des techniques de
gouvernement des individus et des familles, et se met au service des
États en formation pour s'en rendre indispensable.
La
colonisation des marges européennes va y susciter des
troubles socio-économiques profonds.
La
sorcellerie est exactement corrélée
à ces troubles ; elle en marque les points culminants : tout procès
de « sorciers » et de « sorcières » est en effet le résultat de
la lente montée d'une tension qui s'empare de villages entiers et
qui se cristallise dans l'accusation portée contre elleux. Si tant
de femmes sont visées, c'est parce qu'elles sont parvenues à tenir,
dans ces régions marginales, un rôle de premier plan dans le
gouvernement des familles et l'élaboration de leurs stratégies
économiques et symboliques, rôle que le clergé entend désormais
remplir de façon exclusive. C'est aussi parce qu'elles tentent de
s'opposer à son implantation, qu'elles perçoivent comme la première
étape d'une ouverture socio-économique de leur communauté, dont
l'autarcie garantit leur position dominante. Par
ailleurs, si ces femmes font l'objet d'une accusation relevant
du droit ecclésiastique et non pas civil, c'est que rien dans ce
dernier ne permet de les priver de prérogatives
qu'elles ont établies dans un cadre juridique coutumier qui leur est
tout aussi désavantageux qu'à toutes celles de leur sexe. Seule la
mort peut les leur arracher.
Il
est certain que la christianisation des régions marginales,
loin de servir le profit national ou la mécanique économique des
États en formation, a été détournée localement pour modifier les
hiérarchies sociales existantes. Les « épidémies » de
sorcellerie ont été avant tout des épidémies de guerre sociale
localisée, à mettre en regard des guerres de religion, leur
pendant du côté des villes (la dualité religieuse ayant attisé
les conflits internes des grandes familles).
La
réalité sociale qui se cache derrière la figure de la sorcière
aux XVIe et XVIIe siècles est polarisée, d'une part, par la
matriarche, veuve relativement aisée qui décide en fine stratège
des successions et des mariages, ordonnant de cette façon la
communauté de l'intérieur, et, d'autre part, par la vieille retirée
au fond des bois, guérisseuse et savante des choses sauvages, qui
donne sa limite extérieure à la communauté. Entre ces deux pôles
se distribue toute une société de femmes vivant sous la loi des
hommes, mais les gouvernant
dans les faits, et qui ne pouvait que disparaître avec
l'ouverture sur une société urbaine moins égalitaire.
L'instrumentalisation
locale de l'accusation de sorcellerie, du fait des graves désordres
consécutifs (guerres intestines), a contraint les tribunaux,
totalement dépassés, à relâcher la pression. En dépénalisant la
sorcellerie, les États ont renoncé à prendre pied dans les
communautés rurales marginales par le biais de
leurs conflits internes et à s'immiscer directement dans les
préséances symboliques locales entre les sexes. La
reconnaissance juridique de la sorcellerie est devenue le symptôme
et le symbole des
cercles vicieux entre les pouvoirs locaux et centraux.
C'est grâce à ce lien indissoluble forgé au XVIIe siècle entre la
sorcière-criminelle et le chaos social / la défaite des pouvoirs à
toutes les échelles, que ses arrière-petites-filles ont perdu leur
aura maléfique et peuvent aujourd'hui vivre en paix.
Bien
que chaque État ait effectivement abrogé les dispositions
juridiques concernant les sorcières, les accusations de sorcellerie
n'ont pas cessé pour autant dans des communautés qui avaient pris
le pli de résoudre leurs tensions dans la violence qu'elles
généraient. Ils ont pu continuer ainsi d'y être présents, au
moins négativement, en tranchant ces accusations par le moyen de la
requalification du délit en maladie mentale et par l'internement de
la sorcière pour motif de trouble à l'ordre public. C'est ainsi
qu'on retrouvera à l'hôpital la sorcière pathologisée et «
désorciérisée », parmi les hystériques.
➤ Les
possédées
Si
les sorcières incarnent la résistance féminine aux marges des
États en formation, les possédées représentent celle qui émerge
en leur cœur disciplinaire, c'est-à-dire dans
l'Église urbaine close sur elle-même, dans les couvents des
villes grandes et moyennes, plus précisément à la tête de ces
couvents, car les possédées se recrutent d’abord parmi les
supérieures ou les prieures qui entraînent à leur
suite les autres religieuses.
Il
ne s’agit plus ici de l’intrusion d’un pouvoir central dans les
jeux de pouvoirs locaux, mais de l’intensification de la discipline
au sein d’établissements a priori préparés à la recevoir. La
possédée, femme cultivée, toute acquise
aux techniques nouvelles de la direction spirituelle, est
convaincue que seule sa
transformation radicale peut éliminer la faiblesse
intrinsèque que l’examen de conscience ne cesse de lui révéler,
ces petits accès de colère, ces petites exigences quant au respect
des rituels, ces petits plaisirs mondains
que tolèrent encore les couvents urbains, et surtout ces élans
de l’amour-propre qui ne se laissent jamais déceler qu’après
coup derrière les actes les plus charitables. La possession est la
forme prise par cette transformation radicale de soi, exigée par la
direction de conscience, mais qui s’avère désastreuse pour
l’Église.
Elle
a en effet au moins ceci de commun avec la sorcellerie qu’elle
corrèle toujours avec le chaos social. Mais si l’accusation de
sorcellerie est le point d’aboutissement d’un trouble
communautaire exacerbé par la présence du pouvoir central, l’aveu
de possession, la convulsion qui porte à son maximum l’un de ces
petits écarts révélé par l’examen de conscience (la jouissance,
la colère, bref, la longue série des péchés), est le point de
départ d’un trouble épidémique capable d'infecter tout ce
qu'approche la possédée : ses compagnes, son directeur de
conscience et les différents ordres religieux dans leurs prétentions
à régler les problèmes internes à l’Église (chacun doté de
son exorciste attitré). Comme le dit Foucault à propos du cas de
Jeanne des Anges à Loudun, la convulsion fait comparaître un
ensemble de forces qui cherchent à s’emparer du corps de la
possédée et, par son intermédiaire, de celui de ses consœurs :
les forces de péché (le diable sous ses multiples aspects) et les
forces de vertu (directeurs de conscience et exorcistes avec leurs
communautés derrière eux), le tout évidemment dans l’urgence la
plus grande et sans que jamais l’Église ait pu se doter d’une
technique efficace pour juguler le phénomène.
Les
dégâts peuvent être considérables, comme à Loudun, où l'Église
s'est vue contrainte, pour sortir de la crise, de juger et brûler le
premier confesseur de Jeanne des Anges, où le second s'est retrouvé
lui-même victime de cette épidémie de possession, où les ordres
disposant d’exorcistes se sont accusés mutuellement d’incompétence
devant les autorités ecclésiastiques les plus hautes.
Jeanne
écrit son autobiographie pour satisfaire aux demandes réitérées
de son évêque, qui espère en tirer un enseignement utile à
l'Église, mais elle n’y dévoile de sens que pour elle-même, pour
sa propre trajectoire de vie. La direction de conscience apparaît
dès lors comme un coût partagé formidable pour un bénéfice
purement individuel, tout l’ordre collectif se dissolvant dans la
mise en ordre de ce désordre personnel, dont celle-là seule, dans
sa composante disciplinaire, s’était inquiétée.
La
multiplication des cas de possession dans les couvents a obligé
l’Église à faire évoluer sa stratégie de gouvernement de ses
troupes et, sans abandonner l’objectif disciplinaire, a employer
des moyens propres à les éviter. Quand ces mesures se sont avérées
insuffisantes, elle a renvoyé la possédée, comme l'avait été la
sorcière, à la psychiatrie. Et c’est encore à l’hôpital que
l’on retrouvera la convulsive pathologisée et « dépossédée »,
parmi les hystériques.
Tandis
que la future institution laïque de l’asile psychiatrique se débat
avec les hystériques, l’Église choisit de laisser subsister de la
folie en son sein, car après tout, la mystique, forme plus subtile
de la possession, moins hantée
par les petits péchés, a produit les œuvres les plus
lyriques du christianisme moderne. C’est ainsi une folie douce
qu’elle admet au XIXe siècle, celle de l’enfant témoin de
l’apparition de la Vierge Marie, folie suffisamment précise pour
qu’elle soit rare et de toute façon sans danger.
➤ Les
hystériques
On
a souvent comparé le phénomène hystérique à une épidémie, dont
les ravages, s'amplifiant dans la seconde moitié du XIXe siècle,
auraient brusquement cessé au début du
suivant. Idée fausse selon Foucault, qui évoque les
évènements qui se sont déroulés à la Salpêtrière comme une
série d'affrontements et de tentatives d'assujettissement
engageant les patientes
et leurs médecins. Il n'y a pas eu d'épidémie mais bien une
bataille de l'hystérie, celle-ci étant l'ensemble des
phénomènes de lutte qui se sont déroulés au sein de l'hôpital et
en dehors, autour de ce nouveau dispositif médical de la clinique
neurologique, qui se met alors en place sous la direction de Charcot.
L'intensité et la fréquence des manifestations qui y furent
enregistrées résultent purement et simplement du cadre favorable
que celle-ci lui offrait : de ce point de vue, l'hystérie, celle
observée à la Salpêtrière, peut être assimilée à une maladie
nosocomiale.
1)
Héritiers en cela des aliénistes du XVIIIe siècle, les psychiatres
contemporains de Charcot classent l'hystérie parmi les névroses, au
même titre que l'hypocondrie, l'épilepsie ou la convulsion, et la
voient comme une « mauvaise maladie », peu déchiffrable
corporellement, facile à simuler et moralement répréhensible.
Falret, dans ses Études cliniques, s'en fait encore l'écho
en 1890 :
«
La vie des hystériques n'est qu'un perpétuel mensonge. Elles
affectent des airs de piété
et de dévotion*, et parviennent à se faire passer pour des
saintes*, alors qu'elles s'abandonnent en secret aux actions les plus
honteuses, alors qu'elles font dans leur intérieur, à leur mari et
à leurs enfants, les scènes les plus violentes*, dans lesquelles
elles tiennent des propos grossiers et quelques fois obscènes*. »
(*
Quand je vous parlais de parenté entre possédées et hystériques
!)
À
partir de 1870, la neurologie balbutiante efface cette
disqualification épistémologique et morale, arrache l'hystérie à
la psychiatrie et la range du côté des maladies neurologiques, des
« vraies maladies » qui relèvent de la science médicale. Pour
pouvoir être mise sur le même plan qu'une maladie organique,
l'hystérie doit présenter une symptomatologie stable. Charcot va
demander à ses patientes de fournir à la fois des symptômes
suivis, existant en dehors de toute crise, et des crises régulières
dont le scénario soit bien typique. Il
construit ce scénario sur le modèle de la crise épileptique.
Il établit aussi la nouvelle technique d'examen neurologique,
reposant sur la consigne / l'injonction. Le neurologue se place donc
dans une situation de pouvoir et son autorité se trouve au
cœur du dispositif, qui comporte cependant un fort risque de
résistance de la part des malades, qui peuvent ne pas vouloir
et feindre de ne pas pouvoir. Heureusement l'hystérique a un intérêt
à répondre positivement à ces consignes : de cette manière, elle
change de statut, passe de la folle qui simule à la malade digne de
considération et entretient la dépendance du médecin à son égard.
C'est dans ce supplément de pouvoir, gagné sur le corps médical,
que va se précipiter tout le plaisir des hystériques, qui vont
fournir des symptômes en quantité et en durée, autant et davantage
qu'on en voulait. Un exemple parmi d'autres tout aussi frappants,
avec cette patiente de la Salpêtrière qui connaît plus de dix-sept
mille crises en quinze jours !
Pour
tenter de contourner sa malade et ne plus dépendre d'elle, le
médecin perfectionne le dispositif neurologique de l'injonction avec
une méthode de
déchiffrement clinique, qui lui permet de distinguer ce qu'il entre
de volonté et d'éventuel trucage dans la réponse comportementale
de la patiente.
2)
Néanmoins la fréquence et l'étendue des phénomènes hystériques
rendent leur contrôle difficile, voire impossible. Pour y remédier,
Charcot recourt à l'hypnose et à la suggestion. Si l'hypnose permet
de déclencher des crises à volonté, tout en isolant un unique
symptôme, d'autant plus facile à enregistrer et à étudier, elle
ne permet pas de les authentifier. Ce sera le rôle dévolu aux «
hystériques naturel.le.s » que sont les victimes de blessures à la
tête présentant des troubles neurologiques. De cette épreuve les
hystériques sortent victorieuses : certaines d'entre elles
parviennent en effet à manifester des symptômes strictement
identiques à ceux des accidenté.e.s,
en particulier toutes ces infimes variations comportementales qui
caractérisent la paralysie nerveuse d'une partie du corps, que les
médecins ont eu soin de détailler dans leurs traités. Par une
généralisation rapide, Charcot en déduit qu'elles ont cette
faculté remarquable de simuler involontairement la destruction d'une
zone de leur cerveau, quelle qu'elle soit, faculté qui est en même
temps une maladie, puisqu'elle ne peut être contrôlée que par la
volonté du médecin – maladie idéale qui donne prise à tout le
champ des pathologies neurologiques accidentelles possibles.
L'hystérique devient
la partenaire du médecin
dans la découverte et la prévision des dysfonctionnements
neurologiques accidentels...
Charcot
parvient à insérer ce qui est, à son sens, une avancée
scientifique majeure dans les rouages de l'économie de son temps, en
répondant à une demande insistante de la part des assureurs, qui
veulent pouvoir mesurer l'ampleur des effets des accidents du travail
sur leurs victimes. Charcot fait l'hypothèse de l'existence d'un
choc post-traumatique : un.e ouvrier.ère peut avoir évité de
justesse un accident du travail et souffrir de séquelles
neurologiques ; le cerveau croit que le corps a perdu l'un de ses
membres, d'où une paralysie qui suit de quelques jours l'accident
évité. Il propose également une méthode de contrôle, car les
hystériques, ces « vraies simulatrices », nouvelles
pythies, savent départager le vrai choc post-traumatique du faux. On
convoque simultanément le ou
la paralysé.e et quelques hystériques que l'on va hypnotiser. Après
un récit circonstancié de l'accident, si la paralysie
résultante de l'une des hypnotisées est en tout point semblable à
celle de l'accidenté.e,
alors iel ne simule pas. Cette confrontation est également
profitable à tou.te.s : aux assurances, aux assuré.e.s, aux
médecins et aux hystériques, qui deviennent ainsi une instance de
vérité distinguant la maladie de la simulation et renforcent leur
pouvoir sur le corps médical.
3)
La contre-offensive clinique est immédiate : la neurologie va
chercher à s'émanciper de cette emprise, ainsi qu'à écarter
l'accusation, de plus en plus répandue, qu'elle forge les symptômes
de toutes pièces. L'hystérie est une maladie trop idéale, il faut
parvenir à la délimiter, à en repérer notamment la genèse.
Charcot procède à une enquête de type disciplinaire : il va
demander à ses patientes de raconter leur vie et surtout leur
enfance dans les moindres détails. Dans son idée, en effet,
l'hystérique se distingue des victimes d'accidents du travail en ce
qu'elle a subi, pendant l'enfance, un traumatisme profond qui l'a
rendue capable de reproduire n'importe quel choc post-traumatique. À
cette énième démonstration d'autorité du médecin, ces femmes
vont opposer une ultime contre-manœuvre : elles vont raconter et
mettre en scène leur vie sexuelle depuis leur plus jeune âge.
Ce
type de contenu, qui va dans le sens de la disqualification
originaire de la névrose hystérique, du fait de son caractère
sexuel, qui lui enlève son statut de maladie, n'arrange guère
Charcot, qui va le taire ou le travestir. Face à ce corps sexuel que
font émerger les patientes de la Salpêtrière en lieu et place du
corps neurologique recherché, les attitudes de la postérité
vont être très différentes : soit
la disqualification morale et pathologique pour les classes
populaires, soit la prise en charge psychanalytique pour la
bourgeoisie. Foucault conclut sa leçon sur le pouvoir psychiatrique
par ces paroles mélancoliques :
«
En forçant les portes de l'asile, en cessant d'être des folles pour
devenir des malades, en entrant enfin chez un vrai médecin,
c'est-à-dire chez le neurologue, en lui fournissant des vrais
symptômes fonctionnels, les hystériques, pour leur plus grand
plaisir, mais sans doute pour notre plus grand malheur, ont donné
prise à la médecine sur la sexualité. »
Freud,
en effet, va pour ainsi dire prendre au sérieux le discours des
hystériques, sur lequel il va déployer des trésors herméneutiques
pour conclure que, s'il est faux à la lettre, il est vrai dans l'intention :
il y a bien eu choc post-traumatique, mais lié à une résistance à
l'interdit de l'inceste, que chacun.e pourtant doit pouvoir non
seulement accepter mais aussi transmettre. L'hystérique est
réduite au statut de mineure « attardée » refusant la soumission
à l'ordre sexuel masculin (cf. le cas célèbre de Dora),
dont la vie en société implique également l'acceptation et la
transmission. Loin cependant de restaurer une quelconque substance à
l'hystérique hors de l'hôpital, Freud la fait disparaître en
l'identifiant à la névrosée et au névrosé en général,
c'est-à-dire la majeure partie de la population (le reste étant
composé de psychotiques), qui peinent à passer à l'âge adulte
pour rejeter certaines conditions de ce passage.
➤ Après
la femme, l'enfant
La
résistance des femmes au pouvoir disciplinaire est une réalité à
laquelle ont dû faire face
deux de ses principales institutions : l’asile et l'Église.
Dans
le cas des hommes, les choses sont différentes : les grandes figures
masculines de l'anormalité que sont le vagabond et le bandit, ont
pour fonction de tracer les limites extérieures de la société
normative ; ils sont pleinement intégrés à la société qui
les exclut. Ce n'est pas le cas des sorcières, des possédées
et des hystériques, qui ne remplissent plus cette fonction et vivent
donc en paix depuis que l'enfer social psychiatrique a cessé de
reconnaître leur existence.
Si
les hommes ne sont pas en
mesure de renverser le système de l'intérieur, peut-être
parviennent-ils du moins, en adoptant indéfiniment le rôle
anxiogène assigné au vagabond, au bandit, ainsi qu'à la kyrielle
des monstres que s'est attaché à construire, au cours des XIXe et
XXe siècles, le prolifique tandem justice-psychiatrie, en
particulier le schizophrène, sa dernière création en date, figure
redoutable dont aujourd'hui encore il fait régulièrement ressurgir
la menace, à épuiser à long terme, à force d'accumulation, le
système disciplinaire.
Toujours
est-il que le pouvoir disciplinaire, à travers son bras armé qu'est
la « fonction psy » (psychiatre, psychologue,
psychanalyste...), a renoncé à s'attaquer de front aux adultes.
Face
à un.e adulte, un.e psychiatre voit d'abord l'enfant qu'iel a été,
avec ses petits troubles, ses petites méchancetés, ses petits
désirs, etc., qui auront conduit au crime au sujet duquel iel est
convoqué.e devant la cour d'assises, ou bien qui pourraient y
conduire, lorsqu'iel intervient à titre d'expert.e dans le cadre
d'une procédure d'enfermement préventif réclamée soit par
l'autorité préfectorale, soit par la famille.
Un.e
psychanalyste, de son côté, voit plutôt en l'adulte un être
enfermé dans les interdits de son enfance (bloqué à tel ou tel
stade, anthropophage ou incestueux) et qui consulte pour se
renormaliser, le travail
psychanalytique consistant à découvrir et à se saisir de ce
qu'une enfance déséquilibrée a jusqu'ici empêché d'obtenir (une
vie pleine, consacrée à la famille et à l'enrichissement
dans la compétition, sources de toutes les joies saines !).