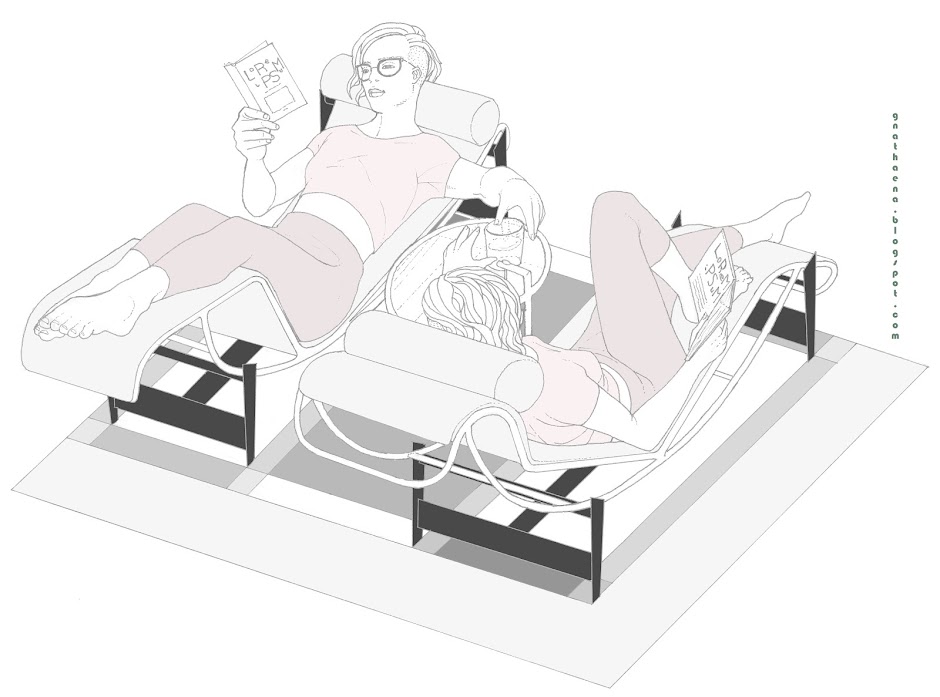Le
ciment de la grande majorité des institutions masculines
indo-européennes est la délégation par les individus d'un
groupe, à l'un d'entre eux, de ce qui, dans leur capacité à
diriger, concerne le groupe
dans son ensemble.
Deux
critères, qui ne se trouvent pas
toujours réunis, d'hérédité et de compétence déterminent
cette délégation, critères dont la possession caractérise
également l'être divin.
La
délégation a pour fondement une conception religieuse, dans
laquelle les hommes d'un groupe, par un transfert
magique de puissance, font don de leur surcroît de virilité
à l'un d'entre eux, qui leur fait ensuite bénéficier de sa
surpuissance cumulative.
Pour
le bénéficiaire de la délégation, dire « je », c'est alors dire
« nous », c'est étendre son individualité à l'ensemble du
groupe.
Ce
type de délégation a cours autant dans les regroupements ludiques
(chasse, jeux) que dans les troupes guerrières, les groupes
professionnels et les assemblées politiques, où chaque chef
de famille / clan prend la parole, s'appuyant sur une autorité qui
dépend du poids de ses différents réseaux masculins (de guerre, de
chasse, de jeu et de métier). Le vote consiste à évaluer
quelle parole a le plus de poids, le poids de la parole dépendant
non pas de son contenu, mais de la puissance et de la qualité
des réseaux de celui qui la prononce. L'élection du chef de
l'assemblée correspond donc à la reconnaissance de ce que l'un des
chefs de famille / clan a plus de poids que les autres.
La
représentation masculine étant fondée sur la délégation, elle
est initialement occasionnelle (Untel pour le groupe à telle
occasion), ou instituée temporairement (Untel pour le groupe durant
telle période), et éventuellement transmissible (Untel pour
le groupe durant telle période, parce que son prédécesseur l'a
souhaité), mais dans ce cas avec l'approbation des individus du
groupe.
En
interne, le représentant politique a une fonction de juge qui statue
sur les affaires courantes, en externe, une fonction honorifique de
représentation auprès des étrangers à la communauté, mais en
aucun cas il ne dirige et ne donne de direction à l'action,
contrairement au délégué du groupe de chasseurs, de joueurs et de
guerriers. Les choses vont évoluer avec le temps et le roi
indo-européen finira par être à la fois représentant du peuple et
chef de guerre.
Ce
système de délégation et de représentation, qui transfère la
puissance des membres d'un groupe à un chef local, à un roi, à un
dieu (selon que le groupe est local, tribal ou inter-tribal),
repose sur la fidélité
masculine, fidélité d'un homme envers un autre homme ou
envers un dieu.
La
structure de la foi, dont
dérivent les diverses formes
de fidélité (chasse, guerre, jeu, métier), est apparentée à
celle du don. D'abord exclusivement
masculine, la foi met en rapport deux hommes : le dirigeant et
le dirigé. Elle s'appuie sur une conception commune de
l'individualité comme capacité à se diriger et à diriger les
groupes auxquels on appartient, ainsi que comme capacité à déléguer
cette dernière capacité dans le but de renforcer la capacité des
groupes à se diriger. Elle est motivée, du côté du dirigeant,
par le pouvoir, et du côté du dirigé, par l'attente d'un service
en retour. Cette structure se réalise :
dans
le fait, pour un individu, de placer en un autre individu sa
capacité directrice groupale, se soumettant dès lors, en tant que
membre du groupe, à sa direction,
dans
le fait, pour l'individu en qui cette capacité directrice est
déposée, de démultiplier sa puissance directrice de façon à
pouvoir dire « nous » pour
« je »,
dans
le fait, pour l'individu qui délègue ainsi sa directivité
groupale, de bénéficier d'un retour au moment où le besoin s'en
fait sentir.
L'ensemble
constitue le mécanisme de la foi. Fragiliser l'un des rouages de ce
mécanisme, c'est fragiliser la foi, c'est la mettre à l'épreuve.
Le christianisme peut être considéré à cet égard comme
une épreuve de la foi par
fragilisation de tous ces rouages jusqu'à un point limite (un
seul bénéficiaire à la délégation, durée indéterminée
de la délégation, attente indéfiniment différée du
retour et, surtout, crainte d'être manquant dans tous les moments de
la fidélité envers le bénéficiaire). Le christianisme
diffère également de la fidélité ancienne, en liant le retour
qu'attend le fidèle à l'évènement de sa mort : « Je place ma foi
en Toi, Tu me diriges, Tu me dois une mort heureuse. »
☞ La
fidélité lie avant tout un individu à un autre individu : elle
n'est donc pas constitutive d'une communauté, mais elle permet à
une communauté de se consolider par son intermédiaire. Ainsi,
la troupe guerrière est un groupement masculin fondé sur la
rivalité guerrière ; mais la rivalité guerrière ne suffit pas à
la consolider ; il lui faut un ciment liant personnellement les
membres du groupe entre eux ; la fidélité de chaque guerrier envers
le chef de la troupe est ce ciment, ce qui fait qu'une
troupe guerrière ne tient que par son chef et que, sans lui,
elle se désagrège (la rivalité conduisant immanquablement au
conflit et à la rupture). Si une troupe guerrière ne subsiste que
par la fidélité de chaque guerrier envers son chef, elle ne la
sollicite pas outre mesure, car entre le chef et les guerriers doit
subsister une forme de rivalité, soit une trace de rivalité
ancienne (à l'époque où le chef n'était qu'un membre comme les
autres de la troupe guerrière), soit une rivalité naissante (pour
le temps où le chef devra être remplacé).
Cette
mise en retrait relative
de la fidélité par rapport à ce qui structure profondément la
collectivité, la rivalité, est tout à fait caractéristique des
groupements masculins « au premier degré » (de guerre, de
chasse, de jeu, de métier). Les groupements politiques, qui sont «
au second degré », c'est-à-dire qui rassemblent les chefs des
groupements « au premier degré », se construisent au contraire sur
la base de la primauté de la fidélité, dont bénéficie
par ailleurs chacun de ses membres, et mettent au second plan la
rivalité masculine, canalisée par le mécanisme formel du vote et
de l'élection.
Les
groupements politiques ont néanmoins fortement évolué avec la
montée en puissance des cités notamment démocratiques.
LA
FIDÉLITÉ POLITIQUE À ROME ET À ATHÈNES
À
Rome,
À
Rome, la fidélité a concerné les dieux et les hommes de pouvoir
(rois, chefs des grandes familles, empereurs). De même qu'un dieu
est d'autant plus puissant qu'il a plus de fidèles (et de meilleure
qualité), de même un homme est d'autant plus influent qu'il a une
clientèle plus large.
La
clientèle est une relation juridique bien définie : le client doit
un service au patron sur le plan militaire, politique et juridique,
et le patron doit offrir à chacun de ses clients un lopin de terre
pour pourvoir à sa subsistance (quoique ne lui permettant pas de
vivre décemment).
La
République, à l'exemple de la monarchie, a considéré la fidélité
comme une chose sacrée (sa transgression est sanctionnée de
la façon la plus dure qui soit : la privation de tout droit), tout
en exacerbant sa dimension politique (les fidèles faisaient campagne
pour leur patron). Sous l'Empire, la fidélité a principalement
revêtu une dimension symbolique (cf. Mécène et sa clientèle de
poètes), mais son assouplissement a permis à l'aristocratie de
développer ses liens avec la plèbe, notamment avec les marchands
dans le cadre d'alliances politico-économiques. C'est sans doute ce
qui a permis in fine à l'aristocratie italienne médiévale
de devenir capitaliste : ne touchant pas elle-même au commerce, mais
accompagnant politiquement (et militairement) le développement
commercial, elle a fini par investir dans des entreprises
commerciales sans pouvoir
exercer la profession de marchand, ce qui est
au fondement de la posture capitaliste (investir mais ne pas
exercer).
En
Grèce,
La
Grèce, elle aussi, a connu le clientélisme, mais les cités
démocratiques, en étendant l'assemblée politique à l'ensemble des
citoyens, ont été amenées à faire évoluer la fidélité typique
du clientélisme. Entre fidélité clientéliste et fidélité
démocratique, la différence significative est celle-ci :
dans
le clientélisme, des hommes dont le rang social est élevé et qui
sont en rivalité entre eux, s'entourent de nombreux fidèles qui
devront les suivre dans leurs campagnes électorales et militaires
ou dans leurs luttes judiciaires, et qui, dans le premier et le
dernier cas, exceptionnellement dans le second, devront s'affronter
entre eux pour la primauté de leur patron, en échange de quoi il
reçoivent heredium,
service juridique et service religieux ;
dans
l'assemblée des cités démocratiques, les paroles énoncées en
séance, rivales les unes des autres, reçoivent un certain nombre
de suffrages ; celle qui l'emporte, emporte immédiatement
l'obligation, pour l'ensemble de l'assemblée, de la suivre, mais
elle est aussi simultanément elle-même dans l'obligation de rendre
des comptes, lors d'une séance ultérieure de l'assemblée, selon
les mêmes règles de votation.
La
fidélité clientéliste lie des personnes ayant chacune leur propre
intérêt à s'associer, quand bien même l'association est
asymétrique : le patron étant celui qui commande et le client celui
qui obéit. La fidélité démocratique lie moins des personnes que
des actes de langage. De façon superficielle, on peut dire qu'au
sein de l'assemblée, des orateurs en rivalité sont départagés par
le vote, et que le vainqueur reçoit en récompense la fidélité de
l'ensemble de l'assemblée au projet qu'il présentait, en échange
de quoi il devra rendre des comptes de la réalisation de son projet
et des bénéfices que la cité aura pu en tirer. Cette première
façon de voir les choses a le mérite d'être encore compréhensible
à la lumière du clientélisme, même si les éléments en jeu ici
et là sont organisés de façon différente. Le fait pourtant que
tout ne se passe, dans les cités démocratiques, qu'à l'assemblée,
tend à indiquer que la fidélité en jeu est avant tout une affaire
de parole. Cela est confirmé par le fait que c'est très rarement
l'orateur qui dirige la mise en œuvre du projet, dont il a été le
promoteur, et qui est appelé à rendre les comptes de l'entreprise
dans une assemblée ultérieure.
En
réalité, l'assemblée démocratique est un monde clos de jeux de
langage :
ce
n'est pas une personne (l'orateur) qui persuade, mais sa parole ;
la
parole de l'orateur se cultive comme un art de faire, l'enseignement
oratoire a explosé en Grèce avec la généralisation des
assemblées, et d'autre part les logographes rédigent des
discours-type pour en faire commerce : c'est la parole qui compte,
et l'orateur ne vaut que pour sa capacité à bien prononcer la
parole qui doit être dite, quitte à ne pas l'avoir inventée
lui-même ;
la
rivalité oratoire concerne bien sûr la façon de s'exprimer, mais
aussi le contenu : les sophismes sont des armes subtiles qui peuvent
se retourner contre celui qui les emploie, quand l'adversaire
parvient à les démonter ; les projets sur quoi portent les prises
de paroles sont décrits de façon à résister aux critiques,
l'orateur concentre l'attention du public sur l'argumentation en la
faveur de celui qu'il défend et sur les louanges promises à la
cité dans le cas où l'assemblée déciderait de le mettre en œuvre
;
la
victoire d'un discours sur ses rivaux est sanctionnée par un vote,
acte de langage particulier qui exprime la fidélité du public aux
discours prononcés ; le public y est en fait réduit à une
capacité individuelle de juger entre des discours concurrents,
capacité mise en action à l'occasion de la confrontation de
discours et s'accomplissant dans le vote ;
le
discours qui l'a emporté en suffrages devient la feuille de route
de la cité, et en premier lieu de ses magistrats ; l'action qui
s'ensuit disparaît dans la réalité non verbale avant de
réapparaître au moment de la remise des comptes ;
la
promesse relative à la réalisation du projet n'est pas une
promesse de gain de pouvoir ou d'enrichissement par rapport aux
cités concurrentes, mais une promesse de louanges de la part de «
la Grèce entière » ; la réalisation de la promesse n'est pas
laissée à l'appréciation de chacun, elle fait l'objet d'un débat
en assemblée, où entrent en conflit éloges et blâmes, de sort
qu'in
fine
le service est jugé rendu quand l'éloge a été préférée au
blâme.
LA
FIDÉLITÉ MISE À L'ÉPREUVE : INTERPRÉTATION INDO-EUROPÉENNE DE
L'ESCLAVAGE
C'est
la structure de la fidélité qui a permis aux peuples indo-européens
de comprendre et de s'approprier l'une des pratiques commerciales les
plus originales des civilisations sémitiques.
La
guerre rituelle pratiquée en Mésopotamie entre principautés a la
particularité de se conclure d'un côté par la reconnaissance de la
souveraineté du vainqueur et le versement d'un tribut, de l'autre
par la prise de l'armée ennemie et son intégration à la
principauté victorieuse sous le statut de captifs placés au service
du roi ou d'autres particuliers ; ce statut inclut le droit à être
racheté par sa communauté d'origine, si celle-ci en fait la demande
expresse par l'intermédiaire d'un « commerçant », terme qui
semble désigner un agent de la principauté vaincue, doté
d'équivalent monétaire par les familles des captifs, et chargé de
payer leur libération ; ce droit à être racheté implique
d'autres droits visant à préserver l'intégrité de la personne du
captif (cf. pour plus de détails le code
de Hammurabi, vers -1850). Cette très ancienne pratique
semble avoir eu pour conséquence une certaine habitude, au moins
dans les cercles royaux, de disposer d'esclaves, suite aux campagnes
militaires lointaines, au retour desquelles une majorité de captifs
n'avaient guère de chance d'être rachetés.
C'est
sans doute sur cette base que s'est développée la piraterie
phénicienne, les Phéniciens jouant d'abord le rôle de
transporteurs maritimes pour les émissaires égyptiens ou
mésopotamiens chargés de délivrer les captifs durant les conflits
entre les deux grandes puissances, puis celui d'intermédiaire
diplomatique se chargeant du rachat et du transit des captifs, puis
celui de fournisseur de captifs enlevés dans les marges de la
civilisation (îles et pourtours de la mer Égée) et dont le rachat
est exclu.
Certains
peuples indo-européens, Hittites et Perses, ont adopté ces
pratiques, sans les interpréter outre mesure, parce
qu'elles se trouvaient déjà là.
Les
Grecs, victimes de la piraterie phénicienne, et coupés du modèle
politique sémitique à cause
du renouvellement brusque de leur population (« invasions
éoliennes, ioniennes, doriennes »), ont de leur côté été
obligés de fournir un effort d'interprétation. Cet effort se mesure
à la distance qu'il y a entre la piraterie phénicienne et une
pratique germanique singulière relevée par Tacite impliquant la
fidélité, qui fut sûrement partagée par les nouvelles populations
grecques, et à partir de laquelle celles-ci purent donner sens à la
piraterie (et donc la pratiquer à leur tour).
Il
existe chez les Germains de l'époque de Tacite une pratique
consistant pour un homme à se dépourvoir volontairement de sa
liberté au profit d'un autre homme, et pour celui-ci à rendre aussi
vite que possible le captif à ses proches. Cette pratique, si elle
ressemble structurellement
à la captivité guerrière sémitique (privation de liberté puis
rachat), n'a pas du tout le même sens.
La
pratique germanique a pour source la rivalité ludique de la «
maison des hommes ». Les jeux y font en général intervenir adresse
et hasard ; certains jeux, comme les dés, sont censés relever du
hasard pur ; le hasard, par définition, ne dépend que des dieux,
et, dans le cas des dés, les lois statistiques manifestent
l'impartialité des
dieux (un grand nombre de lancers tend à égaliser les résultats
possibles). On distingue ainsi les parties de bon augure, où
chacun a autant perdu que gagné, ce qui prouve que le groupe est en
faveur auprès des dieux, et les parties de mauvaise augure,
où le balancier tarde au point que l'un des joueurs se trouve acculé
à la mise de ses ultimes richesses personnelles ; lorsque c'est le
cas, lorsqu'un joueur a tout perdu face à un autre joueur, il doit
miser sa liberté de se diriger lui-même, car alors, s'il perd à
nouveau, il n'est plus considéré comme une personne, ce qui évacue
la malédiction divine sur l'ensemble du groupe des joueurs, cette
évacuation laissant néanmoins une trace, une souillure qui touche
le vainqueur, tenu de garder auprès de lui le vaincu, couple qui
manifeste la démesure et la
punition potentielles du groupe, le vainqueur ayant trop gagné
et le vaincu trop perdu. La souillure est alors évacuée par le
rachat du vaincu par sa famille ou ses amis auprès du vainqueur,
rachat au montant qui aurait dû être honoré par le vaincu si sa
richesse personnelle avait été plus grande et pour que le jeu
puisse continuer « normalement »,
rachat qui réhabilite du même coup le vainqueur, qui de tyran
latent, dirigeant des êtres dépersonnalisés (pour les Germains, on
ne peut légitimement diriger que des hommes libres) devient
simplement un homme favorisé par le sort.
Cette
pratique s'inscrit dans le cadre structurel de la fidélité : elle
la met à l'épreuve pour la restaurer in extremis. En effet
la fidélité n'est plus fidélité, lorsque la délégation de la
capacité à diriger est totale, lorsqu'elle s'étend à la capacité
à se diriger soi-même, quand bien même elle serait volontaire ou
conforme à l'honneur, car alors il y a dépersonnalisation, autant
dire émasculation, et il n'y a plus de réciprocité possible
(délégation contre service
rendu), car seule une personne en tant que telle peut attendre
quelque chose de son patron. Cette situation critique qui met en
question la fidélité se résout finalement par l'intervention d'un
tiers appartenant à l'entourage du vaincu.
☞ La
compréhension de l'esclavage par les Indo-européens passe par le
fil rouge de cette pratique de rachat par un tiers de celui qui a
trop donné lors d'une joute collective.
L'Odyssée
témoigne d'une évolution dans la gestion des problèmes que peut
poser la fidélité : le rachat par un tiers n'est plus lié à une
délégation totale de directivité, mais à un refus
de délégation partielle.
Dans un épisode bien connu, les prétendants menacent les
clients de la maison d'Ulysse de les saisir pour les vendre, non pas
ici à leurs proches, mais à des étrangers, car ne leur étant pas
fidèles, ils ne peuvent leur apporter mieux que de l'argent.
Ce
qui reste une menace chez Homère devient bien réel avec la montée
en puissance des cités. Les cités tendent en effet à se constituer
en États indépendants les uns des autres, et la fidélité
devient le ferment de l'union civique (autour de divinités
souveraines). Les territoires qui n'appartiennent pas en propre à la
cité ou qui n'appartiennent pas à des cités alliées sont
considérés comme des territoires ennemis. La confrontation entre
cités ennemies, alimentée par le besoin de disposer d'un espace
vital suffisant, se traduit par des razzias,
y compris humaines.
Cette
pratique pose un double problème : comment intégrer les citoyens
vaincus restés fidèles à leur cité et comment gérer la souillure
inhérente à la destruction d'une société toute entière ? La
solution consiste ici à dépersonnaliser les vaincus, en les
déportant et en les séparant les uns des autres, puis à les
vendre, non pas à leurs proches (captifs eux aussi), mais aux
citoyens et aux établissements publics (comme les mines) de la cité
victorieuse, qui ont le devoir
de les racheter. On mesure la distance qu'il y a avec les
pratiques sémitiques : en Grèce, ce sont les vainqueurs qui
s'achètent les vaincus, alors qu'en Mésopotamie (comme chez les
Germains), ce sont les vaincus qui s'achètent aux vainqueurs. Qu'il
s'agisse des Germains ou des Grecs, l'achat libère et le
vainqueur et le vaincu : l'esclave grec possède un statut qui le
soustrait à sa dépersonnalisation, il est membre à part entière
de la cité, même s'il y occupe la place la moins honorable. Il peut
désormais jouir notamment d'un pécule, esquisse de reconquête
personnelle, puis surtout être libéré et accéder à un statut
d'hôte, voire in fine devenir citoyen. Malgré
sa dépersonnalisation, l'esclave conserve une valeur, liée à sa
capacité à intégrer une nouvelle société. C'est cette valeur
conservée qui va déterminer le prix à payer lors de son rachat.
Le
cas des femmes est à signaler. Exclues des relations de fidélité
qui sont au fondement de la vie politique citoyenne, on ne les
suppose fidèles à leur cité que lorsque celle-ci a été vaincue
et qu'il s'agit de les vendre.
☞ La
consolidation des États grecs centrés sur une cité a eu pour
conséquence la dépendance de l'économie domestique à l'égard des
esclaves, d'où la création de marchés dédiés, la pratique d'un
commerce d'esclaves à longue portée. Les Grecs rejoignaient ainsi
les Phéniciens, mais par un
tout autre chemin.
LA
FIDÉLITÉ ET L'ÉCONOMIE MARCHANDE
L'activité
commerciale grecque est à l'origine de l'économie au sens moderne
du terme. Elle s'est établie, dans le monde indo-européen, sur
fond d'esclavage, interprété comme processus de revalorisation de
celui qui a perdu toute valeur dans la ruine de sa cité. Son
lieu propre, là où elle trouve sa marchandise, est un non-lieu,
celui de la démesure du vainqueur et de la dépersonnalisation du
vaincu, non-lieu temporaire, hautement risqué sur le plan religieux.
Mais c'est de ce non-lieu que peut se créer de la valeur économique,
et c'est cela qui anime le cœur du champ économique, au prix d'un
contact assumé avec la souillure et d'une défaillance du langage
pour le nommer. Le commerce n'avait auparavant aucun lieu propre. Il
était toujours associé à des pratiques sociales plus larges
(alliances notamment).
☞
En faisant de la
création de valeur son principe directeur, le commerce
pouvait amorcer la constitution d'un champ économique autonome.
L'expansion
du champ économique sur cette base n'a pu se réaliser qu'à partir
du commerce lointain des biens de luxe, des valeurs étrangères, ces
biens seuls pouvant soutenir la comparaison avec des hommes. Il s'est
ensuite étendu aux biens qui permettent au marchand de réaliser une
forte plus-value du fait de la séparation des territoires de
production et des territoires de consommation. Dans ce passage d'un
territoire à un autre, il y a une perte du sens social originel de
l'objet, charge aux acheteurs de lui redonner ensuite un sens,
c'est-à-dire une valeur.
Les
opérations financières, modifiant le principe de création de
valeur propre au commerce lointain, ont forgé celui de génération
de valeur, où la valeur ne se crée pas à partir de rien, mais
multiplie une valeur préexistante (« l'argent fait des petits »).
Dépositaire
de ces deux principes, le champ économique se trouvait doté d'un
cœur stable et pouvait songer à son expansion.
La
notion de créance, économique à l'époque moderne, sociale dans
l'Antiquité et magique chez les Indo-européens de l'époque
pré-historique, dérive de celle de fidélité. À l'origine,
elle est donc liée à un échange en deux temps entre un homme et un
dieu. Le premier temps est celui du placement du *kred-, unité
individuelle de force que fournit un homme à un dieu de façon à
augmenter ses chances de vaincre dans ses combats célestes. Le
second temps est celui de l'assistance du dieu à l'homme qui a placé
en lui son *kred-, tout comme dans la fidélité est attendue du chef
un retour. Le créancier apparaît ainsi à l'origine comme le fidèle
d'un dieu. Mais lorsque le champ économique s'empare de la notion de
créance, l'accent est mis sur la dette qu'elle implique, sur
l'obligation qui résulte du crédit, obligation juridique placée
dans l'ombre du châtiment. L'économie marque en cela sa
différence avec la religion, puisqu'il est inconcevable qu'un
dieu soit l'obligé d'un homme.